
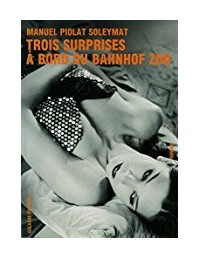 Suspendu à l’incidence d’un geste emmuré dans un conditionnel passé qui le condamne à ne rêver que de l’irréel et de l’hypothétique, le récit de Manuel Piolat Soleymat réussit avec brio une encore plus grande performance, celle du mélange harmonieux des genres, passant avec désinvolture du discours narratif romanesque à l’incantation du poème en prose et à l’exercice haletant du dialogue dramaturgique. Relatant l’incident bouleversant d’un geste fou par lequel Léonce Janssen quitte en pleine nuit «son antique demeure familiale» pour aller danser jusqu’au matin «dans les quartiers de la ville basse», Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo (Éditions Galaade, 2011) fait partie de ces livres inclassables dont l’unicité repose justement sur leur capacité à tenir en haleine des lecteurs invités à fréquenter plutôt le plaisir issu de la contemplation du verbe que le geste qui découle de sa substance. Poème du désir, de la passion et de l’excès, de l’obsessionnelle tentation du départ, de la clandestinité et de l’ivresse, des «autres façons d’exister», d’une folle envie de «se mêler à d’autres manières d’apparaître», il est en même temps l’expression tragique d’une liberté impossible, enfermée dans les carcans des conventions et des règles établies. L’auteur, quant à lui, se complait à exercer le droit le plus noble du Narrateur-Roi, celui «d’inventer des pans entier de mondes».
Suspendu à l’incidence d’un geste emmuré dans un conditionnel passé qui le condamne à ne rêver que de l’irréel et de l’hypothétique, le récit de Manuel Piolat Soleymat réussit avec brio une encore plus grande performance, celle du mélange harmonieux des genres, passant avec désinvolture du discours narratif romanesque à l’incantation du poème en prose et à l’exercice haletant du dialogue dramaturgique. Relatant l’incident bouleversant d’un geste fou par lequel Léonce Janssen quitte en pleine nuit «son antique demeure familiale» pour aller danser jusqu’au matin «dans les quartiers de la ville basse», Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo (Éditions Galaade, 2011) fait partie de ces livres inclassables dont l’unicité repose justement sur leur capacité à tenir en haleine des lecteurs invités à fréquenter plutôt le plaisir issu de la contemplation du verbe que le geste qui découle de sa substance. Poème du désir, de la passion et de l’excès, de l’obsessionnelle tentation du départ, de la clandestinité et de l’ivresse, des «autres façons d’exister», d’une folle envie de «se mêler à d’autres manières d’apparaître», il est en même temps l’expression tragique d’une liberté impossible, enfermée dans les carcans des conventions et des règles établies. L’auteur, quant à lui, se complait à exercer le droit le plus noble du Narrateur-Roi, celui «d’inventer des pans entier de mondes».
Quelle est la genèse de votre livre et comment interpréter son titre plein de mystère?
L’impulsion première d’un livre est assez mystérieuse. Pour moi, souvent, tout commence par une analogie, une sorte d’association libre. Je veux dire par là que je suis en train de lire un texte, c’est le cas le plus courant, mais cela peut aussi être lorsque je suis dans un musée, ou lorsque j’assiste à une représentation de théâtre, mais c’est vraiment plus souvent lorsque je suis en train de lire, et alors une phrase, une image, une perspective, l’ampleur d’un style me frappe, me happe. Se fait alors jour, en moi, une sorte de reconnaissance. De familiarité bouleversante. Je dis bouleversante, car cette impression de se retrouver ainsi au sein d’une œuvre d’étrangère, d’être à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de soi, d’une certaine façon, comme augmenté, cette impression me bouleverse. Un jour, alors que j’étais accueilli dans un cours, à La Sorbonne, devant des étudiants qui avaient à leur programme, dans le cadre d’un module sur les dramaturgies contemporaines, la lecture de Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo, une question m’a été posée sur la raison profonde, intime, qui me poussait à écrire. Je ne l’avais jamais envisagé de la sorte, mais je me suis alors surpris à répondre, sans même y réfléchir, comme une réponse évidente qui sommeillait en moi, que j’écrivais «pour faire humanité commune». À la réflexion, cette réponse, quoi que sans doute un peu romantique, me semble assez juste. Et c’est exactement ce qui m’émeut dans le phénomène de reconnaissance dont je viens de parler. Cette sensation d’avoir en commun un même «fond d’humanité», de se sentir inspiré et poussé par l’œuvre d’un(e) autre artiste. C’est donc ce qui est arrivé lorsque j’ai lu Abrégé d’histoire de la littérature portative, d’Enrique Vila-Matas, et plus précisément l’une des parties de ce roman intitulée Bahnhof Zoo. L’impulsion dont j’ai parlé a surgi. La conscience d’un texte à écrire, qui serait — non pas d’un point de vue de sa narration, bien sûr, mais de sa portée inconsciente — comme un prolongement possible de ce livre. C’est la raison pour laquelle, comme une sorte de tribut, et pour garder active, vivante, la forme de transmission qui m’avait été faite, j’ai choisi un titre directement issu de Bahnhof Zoo («J’ai toujours aimé prendre à la lettre les récits de Klee dans son journal de navigation. J’ai toujours aimé à croire qu’en effet la Mort est arrivée au petit matin, en squelette et en faux, curieuse de voir ce qui se passait dans ce sous-marin et que là, trois surprises l’attendaient.»). Comme vous le dites, ce titre est assez mystérieux. C’est en partie pour cela que je l’ai choisi : pour cette forme de mystère, comme une piste lancée au-delà même du monde auquel mon livre cherche à donner naissance. Pour sa beauté aussi. Je l’ai trouvé beau, d’une beauté expressive, irradiante, qui m’a beaucoup aidé à conserver un lien organique avec les idées qui m’étaient venues en lisant le roman d’Enrique Vila-Matas. Ce titre n’a aucun rapport direct avec les thèmes et les lignes narratives de mon livre. J’ai l’ai choisi comme on donne un prénom à un enfant, sous le coup d’une évidence, qui ne s’est d’ailleurs par la suite jamais démentie. Simplement pour ce qu’il était et provoquait en moi : comme un hublot qui ouvre sur des paysages et des existences inattendus, depuis le Bahnhof Zoo — sous-marin qui, dans Abrégé d’histoire de la littérature portative, parcours le monde sans quitter les eaux du port de Dinard.
Si je comprends bien, votre démarche se veut, en quelque sorte, comme une réplique par laquelle vous rendez la pareille à l’écrivain espagnol souvent décrit comme «un voleur de noms» et dont l’œuvre abonde en «références littéraires qu’il n’est pas indispensable de décrypter pour les goûter». Cette démarche vous conduit à une sorte de greffe bénéfique qui nourrit l’univers narratif de votre ouvrage «comme un prolongement possible de ce livre», comme vous l’écrivez vous-même. Quel est donc ce thème qui nourrit la substance de votre propre corpus narratif et comment s’est-il construit?
Une réplique, peut-être, mais qui ne repose pas du tout, me semble-t-il, sur les mêmes procédés et les mêmes ambitions littéraires. L’univers d’Enrique Vila-Matas a simplement été, pour moi, une sorte de source initiatrice, inspiratrice. Je veux dire que quelque chose dans l’inconscient d’Abrégé d’histoire de la littérature portative, ou plutôt dans l’invisible de ses soubassements, est venu révéler le chemin personnel qui allait mener à mon livre. Comment ? Je ne le sais pas. Je crois que mon imaginaire s’est mis en marche, voilà tout. Ainsi, lorsque je parle de prolongement, je ne veux pas dire que Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo est une continuation du livre d’Enrique Vila-Matas, mais plutôt une émanation contingente, avec ses caractéristiques et son identité propres. L’une de ces caractéristiques est d’ailleurs que je l’ai écrit en essayant de faire en sorte qu’un maximum de lecteurs puisse se l’approprier, voyager à l’intérieur des territoires qu’il propose, qu’il déploie. Pour cela, j’ai toujours veillé à ouvrir le plus possible l’éventail des sens et des interprétations auxquels il peut conduire. J’ai cherché à écrire un roman plurivoque et polyphonique. Un roman dont les lignes et les panoramas ne racontent pas seulement ce qui me traverse et me compose, mais aussi ce qui traverse et compose les autres. Car finalement, nos vies et nos expériences — pour peu que l’on veuille bien essayer de les observer et de les comprendre en dépassant nos particularismes — ont tant en commun. C’est le sens que je voulais donner à la notion «d’humanité commune» dont je parlais précédemment. L’auteur canadien Daniel Danis dit de l’imaginaire qu’il s’agit d’un autre lieu de soi qui n’est pas soi. Que l’imaginaire ne nous appartient pas, qu’il appartient à l’humanité. Que nous sommes tous, à notre mesure, le réceptacle de l’histoire de l’homme, et que la tâche de l’écrivain est d’en rendre compte. D’être un être sensible. D’être inquiet du monde. Je trouve cela très beau. Et très juste. D’une certaine façon, je pourrais donc dire que c’est cette inquiétude, cette forme de préoccupation, d’acuité, qui est la base de Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo. A travers l’histoire de Léonce Janssen, j’ai tenté de mettre en lumière des questions fondamentales qui m’habitent et qui, je pense, habitent beaucoup d’entre nous. J’ai voulu parler de l’absence, de l’inconnu, de la solitude, de la liberté, des sentiments mêlés et contradictoires qui nous unissent les uns aux autres. De la menace qui pèse sur nos vies. De l’ambivalence de nos aspirations profondes. De notre grandeur et de notre petitesse, qui se répondent l’une l’autre. Des impulsions et des tiraillements profonds qui font de nous ce que nous sommes. A travers l’histoire de Léonce Janssen, je crois que j’ai voulu parler du génie de l’homme, de l’être humain.
Croyez-vous que l’une de ces «interprétations», comme vous les appelez, peut trouver sens dans le désir d’une soif irrépressible et risquée vers un ailleurs incertain, souvent fatal, qui habite jusqu’à l’obsession votre héroïne, et avec elle, chacun de nous ?
C’est en effet une interprétation possible. J’ai envie de vous répondre que, finalement, ce que je crois ou ne crois pas à propos des différentes interprétations possible de Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo n’est pas très important. Je veux dire par là que je ne pense pas du tout que le regard d’un auteur, ce qu’il peut être amené à formuler sur ses textes, soit une sorte de vérité, de grille de lecture indépassable. En définitive, les intentions et avis d’auteur importent assez peu. Ce qui ne veut pas dire que les différents discours qu’un écrivain peut développer au sujet de son œuvre ne sont pas intéressants. Au contraire. Mais ces discours ne valent, selon moi, que pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des formes de subjectivité — certes centrales, mais jamais plus que des visions subjectives — s’exprimant sur un objet littéraire qui, une fois achevé, doit pouvoir être envisagé indépendamment des propos de son auteur. Ce qui compte donc avant tout, me semble-t-il, c’est ce que l’œuvre produit sur chaque lecteur et lectrice, ce pour quoi elle vaut — ou ne vaut pas — pour chacun et chacune d’entre eux. Je n’ai jamais cherché à maîtriser ce que j’écris, à le cantonner à quoi que ce soit, à l’inféoder à un plan, un cadre. Car j’aspire toujours à me laisser déborder par mes textes. Ecrire, pour moi, c’est en effet, avant toutes choses, partir à la découverte de ce que l’on a à écrire. Et j’aime lorsque cette chose que j’écris en vient à me surprendre, se révèle plus large, plus ample que ce que j’avais pu, dans un premier temps, imaginer. J’aime lorsque se dévoilent des aspects et des dimensions insoupçonnées. Or, ces aspects et ces dimensions peuvent vous apparaître, à vous, et se dérober à mon propre regard. J’admets tout à fait cette possibilité. Car il y a une part d’inconscient forte dans mes textes. Mais pour tout de même apporter un début de réponse à votre interrogation, j’aurais tendance à dire — mais, encore une fois, ce n’est que ma propre réflexion sur la chose — que bien sûr ce désir et cette soif irrépressible d’ailleurs sont là, mais que ce n’est pas cet ailleurs qui, pour Léonce Janssen, est incertain et fatal, mais plutôt la vie dans laquelle elle s’est laissée enfermer jusqu’alors. Je veux dire qu’il me semble que Léonce Janssen ne prend pas de risque en répondant à l’appel de cet ailleurs. Je veux dire qu’il me semble qu’elle fait simplement, même si la chose n’est, dans les faits, pas vraiment aussi simple, ce qu’elle sait au fond d’elle-même devoir faire pour elle-même. Elle se sauve, en quelque sorte. Et en se sauvant, elle affirme justement la justesse et la légitimité du chemin qu’elle a choisi de suivre.
Vous allez jusqu’à assimiler cette aventure extra-vestale à une démarche, à une tentative de salut personnel de la part de votre héroïne. Mais, alors, jusqu’où peut-on aller dans le risque et la démesure, dans une telle aventure et à partir de quel moment devient pertinente la question de Michel, votre autre personnage qui demande : «Peut-on se pencher au-dessus du vide […] sans avoir au préalable pris soin de faire changer l’ensemble des garde-corps» ? Autrement dit, où et dans quelles conditions, un destin, en occurrence celui de Léonce Janssen, peut prendre son virage définitif ?
La question de Michel, puisqu’elle vaut pour lui-même, n’a aucune raison d’être cadrée. Du moment qu’elle est pensée, qu’elle est formulée, elle devient de fait pertinente. Car, encore une fois, c’est une question qu’il se pose avant tout à lui-même. D’une certaine façon, la trajectoire de vie de Léonce Janssen l’interroge profondément. Intimement. Je veux dire qu’elle lui fait miroir. Qu’elle le concerne lui, dans sa propre vie, dans les choix qu’il a pu déjà faire, comme dans ceux qu’il pourrait être amené à faire. S’il lui demande de préciser, de caractériser les conditions de la liberté dans laquelle elle s’est engagée, c’est pour tenter d’envisager dans quelle mesure il pourrait, lui-même, faire un pas de côté pour sortir de la voie communément admise. A travers cette question, il renvoie à ses propres peurs. Sa propre retenue. A son manque d’audace et d’esprit d’aventure. Il renvoie aussi aux appels et aux désirs qui sommeillent au fond de lui – appels et désirs qui font écho à ce qu’a pu, peut-être, un jour ressentir Léonce Janssen.
Des «appels et désirs» qui s’incarnent dans de véritables obsessions qui peuplent le monde intérieur de Michel. Parmi celles-ci, il y la celle qui renvoie peut-être vers «la plus tenue des incertitudes», celle de la rencontre avec Léonce Janssen. «Quel serait le monde – s’interroge Michel – si une femme telle que vous n’avait pas décidé […] de franchir le pas d’une chambre pour s’enfuir en direction des quartiers de la ville ?» Loin de renvoyer à une rhétoricité fantasque, cette question touche à la véritable place que joue dans l’histoire personnelle de chacun ce que, par habitude ou paresse, nous appelons le hasard.
Quelle place accordez-vous à cette idée de hasard fondateur dans votre récit ?
Une place centrale et ambivalente, puisque le hasard rejoint ici une forme de nécessité et d’évidence. A travers les événements de son existence qui peuvent, dans un premier temps, paraître hasardeux, Léonce Janssen écrit sa propre histoire, qui devient l’histoire du monde, l’histoire d’un monde. L’histoire du monde tel qu’il est lorsque l’on place Léonce Janssen, et c’est ce que fait le personnage de Michel, en son centre, à sa source. Si l’on s’extrait de l’idée d’une ligne temporelle sur laquelle se déplace un curseur, dans un mouvement infini et à sens unique, depuis un passé jusqu’à un avenir, la notion de hasard a du mal à s’imposer. Car, à ce moment-là, seuls comptent les faits, les bornes sur lesquelles se construit le maillage complexe de ce qui arrive ou – et cela revient alors au même – ce qui est arrivé. En effet, que l’on se place dans la réalité indépassable, macrocosmique, d’un «au-delà du temps», ou dans la fixité microcosmique, moléculaire, de l’instant, du présent absolu, le vertige est le même : celui, dans le premier cas, d’une chronologie de faits établie, d’une histoire qui a déjà eu lieu, qui tourne en boucle sur elle-même, se réinventant sans cesse à l’identique ; celui, dans le second cas, d’événements qui basculent inéluctablement, sans envisager d’avant ou d’après, et sans se poser la question du choix, du côté de la nécessité. Ce qui n’interdit pas, bien sûr, d’interroger les hypothèses qui dessinent les autres versants du monde, de l’histoire du monde. Et si Léonce Janssen n’avait pas décidé de franchir le pas de sa chambre pour s’enfuir en direction des quartiers de la ville… ? Et là, c’est un autre paradigme qui apparaît, qui naît, une autre histoire du monde. Mais une histoire du monde qui ne s’est pas imposée, qui n’a pas su résister au mouvement, non pas du hasard, mais de la nécessité. Le hasard fondateur que vous évoquez dans votre question se transforme ainsi en nécessité fondatrice. Une nécessité qui en déclenche d’autres, dans la vie de Léonce Janssen et, par ricochet, dans celle de ceux qui sont, directement ou indirectement, influencés par ses agissements. Cette nécessité dessine donc, dans ce roman, les mouvements d’un monde centré sur le destin d’une femme. Sur le destin de Léonce Janssen.
Dans cette effervescence, dans cette suite de “nécessités” et de “ricochets”, de quelle liberté disposez-vous, en tant que narrateur ? Etes-vous d’accord avec beaucoup de vos confrères qu’au cours de l’écriture le fil de la narration échappe à l’auteur et commence à voler de ses propres ailes ? Qu’en fin de compte ce n’est plus l’auteur qui décide de la suite de l’œuvre, mais ce sont les personnages eux-mêmes qui le font à sa place ?
Je tiens, tout d’abord, à préciser que je ne suis pas le narrateur de mes textes, mais que j’en suis l’auteur. Et en tant qu’auteur, je dispose d’une liberté de création totale, d’une totale maîtrise des textes que j’écris et donne à lire. Car je ne réponds, en le faisant, qu’à des impulsions qui me sont propres. Qui me traversent, venant parfois de loin. Des impulsions auxquelles je peux, selon certaines orientations que je décide de suivre ou non, donner corps ou que je peux ignorer. Mais d’un autre côté, je me sens entièrement guidé par une force d’inspiration qui me dépasse. Je veux dire que je ne suis pas loin de croire que j’écris ce que je dois écrire, ce que j’ai à écrire. Comme si, d’une certaine façon, ma voie d’écrivain était déjà tracée. Toutes les possibilités de cette voie, de ce qui constitue, finalement, un territoire d’écriture, sont à préciser et à explorer. C’est à travers cette exploration que ma liberté d’auteur s’exprime. Mais il me semble que cette quête est cadrée. Délimitée. Qu’elle ne peut sans doute pas excéder certaines frontières et certaines limites. Certaines bornes. Quant à dire que ce sont les personnages qui décident de ce que va être l’œuvre, des choses et des lignes qui vont la constituer, je ne le crois pas. Pour moi, les personnages sont mus par les règles et les mouvements du monde qui les a enfantés. Sans qu’ils aient à décider et choisir quoi que ce soit. Ce monde est contenu par le territoire dont je viens de parler. Je n’ai jamais eu l’impression que la narration d’un texte m’échappait, que les personnages prenaient le pouvoir, en quelque sorte. Pour filer une métaphore sportive, si je compare l’écrivain à un cycliste, je me sens parfois poussé par un vent favorable qui me donne des ailes, qui rend mon avancée simple et évidente, mais je n’ai jamais l’impression que quelqu’un d’autre tient le guidon et pédale à ma place.
Parlons de votre art littéraire : qualifié par la critique de «récit polyphonique sur la liberté et la transgression», votre livre impressionne par l’harmonie et la poésie du discours.
De quel côté penche votre préférence entre ces trois types de discours, romanesque, poétique ou théâtral ? Lequel parle le plus de vous en tant qu’écrivain ?
Je n’aime pas restreindre les textes à des genres. Non par principe, mais parce que ces segmentations n’ont pas vraiment de sens pour moi. J’ai envie de dire que, finalement, une seule catégorie compte, qui comprend toutes les autres : la littérature. C’est-à-dire l’art littéraire, l’art d’écrire, de donner naissance par l’écrit à des mondes qui font sens. Il me semble que dans la mesure où une œuvre est puissante, où elle nous élève, nous amène à envisager des espaces de profondeur, dans la mesure où elle correspond à une recherche artistique et non à un processus de production lié à un phénomène de consommation, elle peut aussi bien être lue qu’entendue, appartient autant au champ du livre que de la scène. Des œuvres aussi importantes que celles de Samuel Beckett, Marguerite Duras ou Thomas Bernhard, par exemple, existent aussi bien d’un point de vue poétique, théâtral que romanesque. Lorsque le comédien Jean-Quentin Châtelain et le metteur en scène Joël Jouanneau s’emparent de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas d’Imre Kertész, cette œuvre qui n’a pas été écrite pour le théâtre résonne de façon extraordinaire sur scène. Car elle est ample et universelle. C’est sur ce chemin que j’ai envie d’avancer. Lorsque j’ai écrit Trois surprises à bord du Bahnhof Zoo (loin de moi l’idée de comparer mon écriture à celle des grands écrivains que je viens de citer), je destinais aussi bien ce texte à des lecteurs qu’à des spectateurs. J’ai d’ailleurs reçu, pour cet écrit, l’Aide à la création du Centre national du théâtre. Et lorsqu’il s’est agi de publication, Emmanuelle Collas, la responsable des Éditions Galaade, m’a dit qu’ayant lu mon texte comme un roman – un roman d’une forme particulière, certes, mais un roman – elle souhaitait le publier en tant que tel. Plus tard, lorsque Blandine Masson de France Culture – en collaboration avec Lucien Attoun de Théâtre Ouvert et les réalisateurs Marc Paquien et Jacques Taroni – a procédé à l’enregistrement radiophonique de ce texte, ce dernier m’a semblé également trouver, à travers ce médium, sa pleine expression. Comme je l’ai dit, je souhaite m’adresser à l’imaginaire de celles et ceux qui se penchent sur mon écriture. A leur intériorité profonde. Aux ombres et aux zones de non-dits qui planent en eux, comme en chacun de nous. J’aimerais que se révèlent, par le biais de mes textes, des parts d’eux-mêmes qui peuvent encore rester secrètes. Cela, sans que j’aie à orienter le lien qu’ils ou qu’elles peuvent établir avec ce que j’ai écrit. Car ce lien les regarde. Une fois les derniers mots formulés, ce qui advient d’eux n’est plus vraiment de mon ressort. Alors roman, théâtre, poésie, toute cela n’a pas grande importance pour moi. Je travaille à des textes que je veux les plus larges et les plus vastes possible. Les plus indéterminés, d’une certaine façon. Bien que j’entende souvent dire qu’ils sont très singuliers. Finalement, je me rends compte que le ou plutôt les genres qui parlent le plus de moi en tant qu’écrivain, pour reprendre les termes de votre question, n’appartiennent pas au champ de l’écriture. Ce sont la peinture, la sculpture et même l’architecture. Lorsque j’écris, j’évolue à travers les mots, les lignes, les pages comme à travers des matériaux, des formes, des perspectives, des points de fuite… Mon écriture se situe davantage du côté des résonances, des vibrations, des panoramas, des creux et des espaces abstraits qu’elles contiennent, que du côté d’histoires qui valent uniquement pour ce qu’elles racontent, ce qu’elles laissent apparaître. Je crois qu’il y a toujours beaucoup de mots derrière mes mots. Beaucoup de paysages et de territoires à explorer.
Propos recueillis par Dan Burcea (02.10.2016)
Manuel Piolat Soleymat, Trois Surprises à bord du Banhnhof Zoo, Éditions Galaade, 2011, 165 p., 12,20 euros


Soyez le premier à commenter