
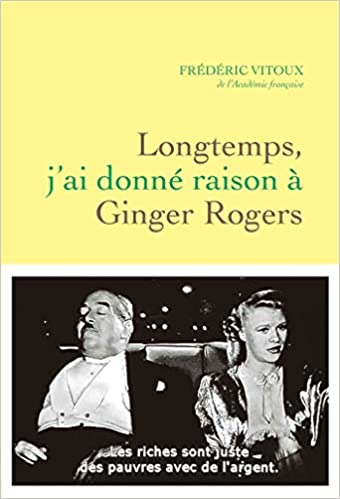 Frédéric Vitoux de l’Académie française publie Longtemps j’ai donné raison à Ginger Rogers, un récit construit au gré d’une mémoire qui refuse toute précision et toute continuité, en concédant une place éminente aux souvenirs, aux rencontres et aux êtres qui ont contribué au devenir de l’auteur. Cet aspect essentiel, relevant plutôt de la subtile mécanique intérieure, est à la mesure de la valeur littéraire de ce livre, dans son plus noble sens esthétique présent dans l’ensemble de l’œuvre vitouxienne. Un retour vers les années de l’enfance et de l’adolescence, un regard rempli de tendres regrets, une remise en question d’une exigeante bienveillance envers soi sont autant d’éléments qui traversent cette autobiographie qui mélange à la fois douceur, lucidité et indulgente rigueur.
Frédéric Vitoux de l’Académie française publie Longtemps j’ai donné raison à Ginger Rogers, un récit construit au gré d’une mémoire qui refuse toute précision et toute continuité, en concédant une place éminente aux souvenirs, aux rencontres et aux êtres qui ont contribué au devenir de l’auteur. Cet aspect essentiel, relevant plutôt de la subtile mécanique intérieure, est à la mesure de la valeur littéraire de ce livre, dans son plus noble sens esthétique présent dans l’ensemble de l’œuvre vitouxienne. Un retour vers les années de l’enfance et de l’adolescence, un regard rempli de tendres regrets, une remise en question d’une exigeante bienveillance envers soi sont autant d’éléments qui traversent cette autobiographie qui mélange à la fois douceur, lucidité et indulgente rigueur.
Dans une conférence de 1983 au Collège de France sur la création poétique, J.L. Borges affirmait, en citant Bergson, que la mémoire est faite d’oubli, car celle-ci, disait-il, choisit ce qu’elle doit ou veut oublier. Quel sens donneriez-vous à cette affirmation, alors qu’au début de votre roman vous postulez « J’ai de la mémoire mais je n’ai pas de souvenirs »?
La remarque de Borges, que vous citez, est très juste. Personnellement, je vois ma mémoire plutôt comme une sorte de bric-à-brac, de grenier dans lequel s’entassent des éléments totalement disparates, parfois inessentiels, parfois importants dans ma vie et dans un désordre et dans une discontinuité totales si bien que mes souvenirs, c’est-à-dire ce que j’arrive à extraire de ce grenier à mémoire, ce que je ressors, ce que je pourrais extraire de ce disque dur, pour utiliser une expression plus moderne, me conduisent à penser que dans la volonté, dans l’ambition d’écrire un récit autobiographique, le mot même de récit, c’est-à-dire de continuité narrative, me paraît une imposture. Je crois que tout récit, toute continuité narrative d’inspiration autobiographique relève plus ou moins du mensonge, ce qui veut dire que l’on comble les vides, que l’on reconstitue les éléments disparates de sa mémoire. Cela peut être une création littéraire admirable, mais ce n’est pas ce que pour ma part j’ai cherché à faire dans ce dernier livre, Longtemps j’ai donné raison à Ginger Rogers. L’ambition littéraire qui a été la mienne c’est d’accepter ces incertitudes de la mémoire, cette parcellisation de la mémoire en bloc de souvenirs qui peuvent revenir à moi de manière non chronologique et de tenter de m’accommoder de cette incertitude, de cette fragmentation, de ce flou.
Plus loin, en retournant vers vos années de lycéen, vous parlez même d’une « mémoire imprévisible » que vous essayez de comprendre à présent. Comment la définiriez-vous aujourd’hui ?
Cette mémoire est imprévisible en effet, en ce sens qu’en écrivant ce livre, j’ai pu faire revenir à moi des souvenirs à partir de mots, d’expressions ou de formules qui me sont restés en mémoire de manière arbitraire a priori, de sensations, d’émotions, de morceaux de musique, de réminiscences de films, tout cela a servi pour moi d’aimants qui ont attiré à eux comme des limailles des souvenirs agrégés autour de ces mots décisifs, et qui ont reconstitué des souvenirs en apparence inessentiels de ma vie. Vous mettez l’accent sur la mémoire capricieuse qui est la mienne, et je ne dois pas être le seul dans ce cas. Il me semble que tout est là. Pour moi, un récit linéaire de mes années d’enfance et de formation aurait été impossible, ou aurait ressemblé à une fiction. J’ai dû me résoudre à ces lambeaux de réminiscences, dans le désordre de mes associations d’idées, d’images ou de grappes de mots, pour tenter, le plus fidèlement possible, de les approcher, en respectant leur cadre d’incertitude. Nous savons, vous et moi (et, Dieu merci, nous ne sommes pas les seuls !), que quelques-uns des plus célèbres chefs-d’œuvre de notre littérature reposent sur ce « mensonge » -là. Et qu’importe si « Les Mémoires d’Outre-Tombe » ou « Mort à Crédit », pour ne donner que les deux premiers exemples qui me viennent à l’esprit, réinventent une enfance idéalement mise en scène dans le romantisme désolé et théâtral de Chateaubriand ou le cauchemar convulsif où se complaisait Céline !
À une échelle cent fois, mille fois plus modeste, cela va sans dire, j’ai tenté d’évoquer, sans élever la voix, quelques minuscules évènements qui ont contribué, à des titres divers, à mon éducation, ou à éclairer ma personnalité. En bref, j’ai essayé de ne pas tricher.
Vous parlez même d’une certaine inutilité à vouloir tenir un journal.
Cette tentative de fixer la mémoire de manière chronologique et narrative dans un journal est une tentative un peu pathétique, voire inutile, de conserver une chronologie à ces années passées. Pour ma part, et j’insiste là-dessus, ce qui me paraît digne d’être retenu, c’est paradoxalement ce qui est digne d’être oublié. Je tiens à cette incertitude, à ce flou, à cette brume dans laquelle se réfugient des souvenirs que j’appelle à moi par certains procédés littéraires. Ce qui m’a vraiment intéressé dans ce livre et qui fait à mon sens sa singularité, ce sont cette incertitude, cette fragmentation, cette indécision des souvenirs et cette manière dont j’ai fait venir à moi, ces souvenirs par le biais des associations d’idées, de mots, de sensations.
Vous parlez également de l’importance des rencontres dont vous avez pu bénéficier dans la vie et au fil de vos lectures. Dans beaucoup de vos livres, vous faites appel à la fiction pour reconstruire certaines figures réelles. Pouvez-vous nous en dire quelques mots sur ce rôle que prend pour vous cette liberté de la fiction ?
Toute ma vie et mes années d’enfance, toutes ces années décisives pour un jeune-homme se sont constituées à partir de lectures, de rencontres, de films vus, de souvenirs familiaux, etc. qui ont contribué à me former.
Quant à la fiction, ce qui m’a intéressé dans ce livre c’est précisément de ne pas sacrifier à la fiction. Je pense que quand on écrit un récit, une continuité narrative de son enfance, on sacrifie à la fiction, on fait un beau récit. Revenons aux deux exemples de chefs-d’œuvre que j’ai donnés plus haut, Les mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand et Mort à crédit de Céline. Même s’ils prétendent à des mémoires pour Chateaubriand ou à des souvenirs d’enfance pour Céline, tous les deux sacrifient à la fiction, parce qu’ils comblent les vides, ils se mettent en scène, ils se réinventent un personnage avec une pose qui est celle du romantisme désolé, mélancolique, de Chateaubriand ou celle de la vision cauchemardesque, convulsive, catastrophique de Céline. Ils savent bien qu’ils créent une œuvre littéraire qui ne correspond pas à leur vie-même. Tous les témoins de la vie de Chateaubriand n’ont cessé de déplorer, de dénoncer l’écart entre ce qu’il racontait et ce qu’il avait réellement vécu. Quant à Céline, le récit de son enfance, tel qu’il apparaît dans Mort à crédit est tellement déformé, tellement reconstruit de manière littéraire, que Céline avait interdit à sa mère de lire ce livre, parce qu’il se doutait bien qu’elle non seulement ne se reconnaitrait pas du tout dans le récit de l’enfance de son fils-écrivain, mais qu’elle serait en plus horrifiée par le spectacle terrible qu’il en donnait.
Ce que j’ai essayé de faire dans mon livre, c’est de parler de manière mesurée, tendre, bienveillante, légère, mais au plus juste de ce qu’étaient mes souvenirs et de ce qui était l’incertitude de mes souvenirs. Voilà pourquoi je pourrais dire qu’il n’y a pas de liberté que je prends par rapport à la fiction, même si certains personnages me font rêver, me semblent ressembler à des personnages romanesques, qui n’apparaissent que fugacement dans mon livre.
Oui, j’aime l’imagination, et vous avez raison de souligner ce mot. Beaucoup de livres que j’ai écrits partent d’éléments réels à partir desquels se construit une aventure littéraire, mais dans le cas de celui-ci j’ai voulu en rester à ce niveau d’incertitude que je chéris par-dessus tout, car il me semble beaucoup plus éloquent que des souvenirs trop nets et, par conséquent, trop mensongers.
Je ne peux pas m’empêcher d’évoquer ici la figure paternelle, abondamment présente dans votre œuvre. Entre la volonté de réhabilitation de cette figure et l’admiration renouvelée de votre père, quelle est la place que vous préfériez aujourd’hui ?
Je vais vous répondre à cette question de manière très directe. La notion de réhabilitation ne m’est jamais venue à l’esprit. Mon père a été un acteur très secondaire en tant que journaliste dans une période tragique de l’histoire de France sous l’Occupation dont j’ai parlé dans plusieurs livres, évidemment. Avec le recul historique, je ne pense évidemment pas qu’il avait fait le bon choix, mais réhabiliter, condamner, juger, gracier sont de termes juridiques qui ne sont pas les miens. Mon père a été arrêté, il a été condamné, il a fait de la prison, mais moi, je ne suis pas le juge de mon père. Je ne suis pas non plus l’avocat pour plaider sa cause. Je suis son fils. Je pense que ce n’est pas aux fils de juger leurs parents. Mon rôle est de dire que j’ai aimé mon père. Je suis assez grand aujourd’hui pour être très critique à l’égard de cette époque-là, mais je me garde d’être le donneur de leçons des combats que je n’ai pas menés. Bien-sûr, il y a eu pendant cette époque des gens qui ont mérité d’être considérés comme des salauds, des délateurs, des assassins, des mouchards, des enrichis du marché noir, que sais-je, mais ce n’est pas à moi de juger les hommes de bonne foi ou de conviction, même s’ils se sont égarés, et, a fortiori, de juger mon père. La notion de condamnation ou de réhabilitation n’est pas mon problème, mais plutôt celui d’essayer de comprendre peut-être cet homme. Je ressens aujourd’hui à quel point régnait dans mon enfance une sorte de climat un peu trouble, un peu opaque qui peut-être obscurcissait un peu ma vie par ce non-dit qui de manière très bizarre m’a marqué alors.
Et puis il y avait le caractère de mon père. Cet homme que j’ai profondément aimé était victime de sautes d’humeur certainement dues à ce qu’il avait vécu. Mon père était tantôt quelqu’un d’exalté, de violent, de vociférant sur la politique, crachant sa haine sur de Gaulle, son hostilité totale envers le communisme, animé de rancœurs qui venaient de ce qu’il avait vécu pendant ses années passées en prison, tantôt perdu dans ses rêves, très peu attentif à la réalité, qui me paraissait assez lointain et qui était aussi un romantique, un mélancolique. Dans mon livre, je raconte ces moments pas si fréquents d’intense complicité entre mon père et moi, cette sorte de bonheur délivré de la pesanteur que nous avions l’un et l’autre quand nous sortions du cinéma où nous allions tous les deux pour voir des films parfois très mauvais, parfois des policiers consternants avec Eddie Constantine. C’était un moment heureux, de bonheur entre mon père et moi. Toute cette psychologie de mon père accentuée par son passé m’a aussi marquée profondément.
J’ai voulu reconstituer la figure de mon père où ni la réhabilitation ni l’admiration ni ce qui serait encore plus détestable, l’agressivité, n’avaient pas de place. Je mesure mieux aujourd’hui cette tendresse à travers ces quelques moments de grâce, alors que la plupart du temps il était perdu dans son monde, dans ses rêveries, dans ses amertumes.
Si je peux me permettre une petite anecdote assez amusante liée au premier chapitre du livre qui s’ouvre sur un souvenir quand, tout petit, je devais avoir à peine trois ans, je suis dans un camion avec ma mère. D’après ce que j’avais pu reconstituer, ma mère m’avait amené à la Centrale pénitentiaire de Clairvaux, dans le département de l’Aube, parce que mon père ne m’avait jamais vu de sa vie. Il m’avait juste aperçu à ma naissance quelques jours avant son arrestation dans le Loiret où ma mère séjournait pendant l’été 1944. Cette hypothèse du voyage en camion me semblait la plus vraisemblable et, quand j’avais voulu reconstituer ce souvenir, mon père était mort et ma mère était dans un état de grande vieillesse, ses souvenirs étant incertains. Or, j’ai pu obtenir un livre paru il y a quelques mois, après avoir écrit mon livre, sur la Centrale de Clairvaux où il y a quelques pages consacrées à mon père. Dans ce chapitre les auteurs de ce livre sur cette prison entre les années ’35-’38 et les années ’50 où cette prison a fermé, font allusion à des lettres que ma mère avait écrites au directeur de la prison en lui demandant l’autorisation, qui fut accordée, de venir rendre visite à mon père avec son fils qu’il ne connaissait pas. J’ai été très, très ému en voyant cela, parce que d’un seul coup j’avais la preuve évidente que cette visite avait bien eu lieu. Comme je suis né en août 1944 et que mon père avait été libéré en novembre 1947, je devais donc avoir environ 3 ans, l’âge où nous avons tous nos premiers souvenirs à peu près cohérents. Mais ce qui me frappe dans ce souvenir qui est maintenant authentifié par ce document c’est que, justement, par ce caprice incroyable de la mémoire, je ne me souviens pas de la visite mais du voyage en camion qui m’amenait à mon père. Je parle dans mon livre de souvenirs imprévisibles, celui-ci en est un qui prouve qu’on ne se souvient pas de ce qui est essentiel mais de ce qui est à côté et dont il faut s’accommoder.
Vous insistez également sur la figure maternelle. Quelle place lui accordez-vous dans votre récit ?
Il m’est arrivé de parler de ma mère dans d’autres livres, en particulier dans L’ami de mon père. La complicité intellectuelle que j’ai eue avec mes parents c’est d’abord celle que j’ai eue avec mon père. Ma mère a été une bonne mère affectueuse, attentive, dévouée qui a tout fait pour ses enfants, je ne peux que chanter ses mérites sur ce plan. Mais j’avais trop souvent, de manière un peu facile, un peu conformiste, mis l’accent sur ses préjugés de classe. Elle voulait à tout prix paraître une femme de la moyenne ou de la bonne bourgeoisie, ce qui était son modèle social, malgré les difficultés d’argent que mes parents connaissaient à cause du métier irrégulier de mon père, après la guerre. Ma mère, à son mérite, a toujours fait bonne figure, a tenu à rassurer ses enfants, à leur assurer une éducation correcte, à faire en sorte que nous ne manquions de rien, même si nous devions nous serrer la ceinture, comme je le dis dans mon livre. Mais ce que j’avais trop retenu chez elle c’était ce côté un peu conformiste, ses préjugés de classe. Je m’en veux un peu, car c’est facile et pas généreux de se moquer de quelqu’un parce qu’il cherche à faire bonne figure dans la société, qu’il a des idées toutes faites sur tel ou tel sujet. Surtout qu’elle a toujours été une mère admirable pour ses enfants, pour tenir à bout de bras son ménage pendant les trois années où mon père était en prison. Elle a dû travailler dans des métiers ingrats, élever ses enfants, sans jamais se plaindre, avec beaucoup de courage. Elle a été par la suite un élément apaisant pour mon père qui était un rêveur mélancolique, parfois sujet à des colères brutales. Elle a eu l’intelligence de savoir le rassurer dans la vie, prête à développer des qualités humaines que je n’avais pas assez mises en lumière. Je m’en voulais rétrospectivement, d’autant plus que dans la vie courante je n’étais pas, comme je l’ai dit, trop indulgent envers elle. Elle savait bien évidemment que nous l’aimions beaucoup avec ma sœur et mon frère, mais elle disait souvent « ô, mes enfants, ils ne me passent rien ». C’était vrai. Je m’en veux aujourd’hui d’avoir été trop moqueur et de ne pas lui avoir manifesté mon affection et mon amour. J’ai écrit ce livre, pour me désoler aussi de cette forme de dureté, ce peu d’indulgence ou de compréhension envers elle pendant mon enfance, dans mon adolescence et dans mon âge adulte.
Retenons, si vous me permettez, deux exemples d’évocation maternelle dans votre roman, celle de la partie de bridge et celle de la plage de La Nartelle.
La Nartelle, cette plage du Var non loin de laquelle mes parents avaient une villa, était une sorte de microcosme social et je montre bien comment ma mère voulait à la fois paraître, faire bonne figure auprès des amis qui avaient bien entendu beaucoup plus d’argent qu’elle, mais en même temps combien elle était bourrée de complexes.
Parfois d’une manière qui me faisait un peu sourire, elle voulait retrouver une autorité qu’elle n’avait pas. Et je me souviens de cette partie de bridge, au cours de laquelle elle avait voulu étonner ses amies et partenaires habituelles en leur parlant avec assurance d’un film vu à la cinémathèque où je l’avais entraîné avec mon père. Il s’agissait d’un chef d’œuvre du réalisateur Howard Hawks, Seuls les anges ont des ailes, qui avait été tourné dans les années ’39 ou ’40. C’était la première fois qu’elle voyait un film à la cinémathèque. Et, en plus, elle écorchait le titre. Mais passons ! J’avais été cruel avec elle, en écoutant par hasard cette conversation et en la rapportant à table le soir même. Si vous voulez, ce n’était pas gentil, c’était encore une fois cruel, même si après nous avons tous souri dans la famille. Vous voyez, ce sont des souvenirs qui me sont revenus, semblables à des petits regrets, à des remords.
Si je parle de ma mère, de son souci de paraître, c’est parce que cette obsession de ma mère m’a marqué durant mon enfance, d’où le titre du livre une chose dont nous n’avons pas encore parlé et qu’il faudrait évoquer.
Justement, c’est le moment de dire quelques mots sur le titre de votre livre.
Oui, il s’agit d’abord d’un titre énigmatique difficilement explicable dans un livre de souvenirs, Longtemps j’ai voulu donner raison à Ginger Rogers. Pourquoi cette référence à une actrice du cinéma américain des années ’30 et ’40 qui a été la sublime partenaire de Fred Astaire dans des comédies musicales en particulier ? Cette notion de classe sociale se posait pour moi, observant ma mère, par cette simple question : est-ce que les gens riches sont des gens différents, d’une autre espèce que les autres, ou non ? Ma mère enviait ses amis fortunés qui avaient une aisance, une assurance, une élégance, une classe qu’elle n’avait pas et qu’elle aurait voulu en avoir. Ce titre, donc, fait référence à un film que j’ai beaucoup aimé de Gregory La Cava qui s’appelait La fille de la cinquième avenue. Ginger Rogers, qui joue ici un rôle dramatique, interprète une jeune dactylo au chômage à New York en pleine période de crise dans les années ’30 et qui se lie d’amitié avec un brave type qui avait fait fortune en inventant un brevet de pompe hydraulique. Lors d’une promenade dans une voiture luxueuse avec chauffeur, elle dit à cet homme : « Peut-être que les gens riches ne sont que des gens pauvres avec de l’argent ».
Pendant mon enfance, contre ma mère, oui, j’ai cru longtemps qu’au fond les gens riches étaient des gens pauvres avec de l’argent, tout simplement. Et pourtant, j’ai fini par me rendre compte que non, que peut-être c’était ma mère qui avait raison, même si elle avait tort d’être intimidée par ces gens, mais que ceux-ci étaient différent des autres. Et je prendrais ici l’exemple du grand écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, écrasé par le prestige de l’aristocratie sudiste de la famille de Zelda Sayre qui deviendra sa femme et dont les oncles étaient gouverneurs de l’État du sud, présidents de country-clubs huppés, etc. L’écrivain, qui avait pourtant gagné beaucoup d’argent avec son premier livre, se rendait compte qu’il n’aurait jamais accès à ce prestige que possédait sa belle-famille. Dans mon adolescence, j’ai été confronté à plusieurs reprises à cette différence. J’en donne quelques exemples.
Vous vous souvenez d’Angelo, le héros du « Hussard sur le toit » de Giono. Au début du roman, Angelo parle d’un duel qu’il avait remporté contre un espion autrichien et, à la question, concernant le secret de la botte qui lui avait permis d’occire son adversaire, il répond qu’elle est le produit de dix ans de pratique quotidienne et de trois cents ans de désinvolture héréditaire. Nous y sommes. Ces trois cents ans de désinvolture héréditaire peuvent être de manière imagée ce qui semble faire la différence entre les gens bien nés, les gens riches, les gens d’une caste et les autres. Je développe cela dans mon livre, non pas parce qu’aujourd’hui ça m’intéresse. Pas du tout, cela n’a plus aucun sens pour moi ni pour mes amis, tout ça c’est seulement de l’Histoire, mais parce que cela a marqué mon enfance.
Entre la discontinuité de la mémoire et la construction du récit quel a été votre travail d’écriture ?
Le livre s’est écrit exactement dans l’ordre où il se présente, c’est-à-dire que cette quête des souvenirs inessentiels est venue au fil de ce que je pêchais par mes réminiscences d’expressions, de termes. Par rapport à un récit linéaire, il a été écrit dans cette discontinuité de la mémoire vivante qui revenait à moi dans un désordre apparent. En revanche, le gros travail d’écriture du livre, qui m’a pris beaucoup de temps a été le ton, l’écriture etc. arriver d’abord à couper énormément de choses inessentielles, des platitudes ou des souvenirs trop communs, des choses qui n’étaient pas assez personnelles, bref un gros travail d’élagage, de style, pour arriver à cette simplicité ou à cette douceur de l’écriture qui ne doit pas peser, ne rien affirmer. De même que je pense que les souvenirs abrupts sont des souvenirs mensongers parce qu’ils sont trop violents, je pense tout aussi qu’il faut se méfier des mots trop forts, d’où la recherche du murmure, voire d’une distance qui dit plus que ce qui est souligné. Tout cela m’a demandé un énorme travail, tout en gardant encore une fois ce à quoi je tiens beaucoup et que j’aime par-dessus tout : cette liberté du fil narratif par le biais des digressions. J’adore les digressions qui m’aident à parler d’un personnage et qui me renvoient à quelque chose d’autre et ainsi de suite. J’aime les parenthèses que l’on ouvre, je n’aime pas les parenthèses que l’on ferme. Évidemment, dans ce livre intervient quelqu’un qui joue un rôle décisif dans ma vie. Il s’agit de Nicole, mon épouse, qui joue non seulement un rôle affectif, l’amour de ma vie, mais aussi celui d’un témoin, d’un acteur, d’un soutien et d’un complice. Cette présence est l’un des fils rouges de ce livre.
Quel regard jetez-vous aujourd’hui, à quelques mois de la publication de votre livre ?
Quand j’ai fini mon livre et quand je l’ai confié à mon éditeur, j’avais très peur, je craignais que ces souvenirs tellement inessentiels, tellement fugaces, tellement fragiles ne pourraient intéresser grand monde. Figurez-vous que j’ai été très surpris par le fait non pas que des lecteurs apprécient ce livre, cela va sans dire que j’en étais heureux, mais par le nombre de lettres ou de réponses de la part des gens émus par ce livre qui réveillaient en eux des souvenirs qui leur appartenaient. Je n’avais pas pensé qu’il aurait cette vocation d’écho ou d’éveil auprès de tant de lecteurs. Je pensais être dans le particulier absolu, dans l’intimité absolue, dans cette recherche de détails individuels, et bizarrement ce particulier a éveillé quelque chose non pas d’universel mais d’autres échos intimes chez ces lecteurs. Cela m’a profondément ému.
Interview réalisée par Dan Burcea
Frédéric Vitoux, Longtemps j’ai donné raison à Ginger Rogers, Éditions Grasset, 2020, 368 pages.

