
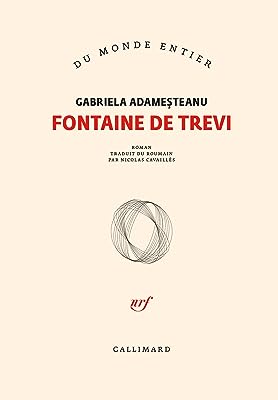 Avec Fontaine de Trevi, la romancière roumaine Gabriela Adameșteanu clôt la trilogie d’une saga familiale des Branea dont la porte-parole, endossant le rôle de narratrice et de personnage central est Letitia/Lety. Arrivée dans ce dernier volet à l’âge des bilans, où les secrets continuent à hanter ses souvenirs, elle sera amenée à naviguer sur la crête mouvante des changements provoqués par la chute du régime communiste de 1989. Fidèle à la ligne narrative portée par les deux volumes précédents, ce troisième tome maintient dans une tension bien maîtrisée le questionnement du legs familial appelé à la barre à la fois de son histoire intime et de celle des générations percutées de plein fouet par la violence des hommes et par les chimères des idéologies. Ce n’est pas par hasard que Letitia fait avec lucidité le constat que « la vérité est une bombe à retardement dont la toxicité est rémanente ».
Avec Fontaine de Trevi, la romancière roumaine Gabriela Adameșteanu clôt la trilogie d’une saga familiale des Branea dont la porte-parole, endossant le rôle de narratrice et de personnage central est Letitia/Lety. Arrivée dans ce dernier volet à l’âge des bilans, où les secrets continuent à hanter ses souvenirs, elle sera amenée à naviguer sur la crête mouvante des changements provoqués par la chute du régime communiste de 1989. Fidèle à la ligne narrative portée par les deux volumes précédents, ce troisième tome maintient dans une tension bien maîtrisée le questionnement du legs familial appelé à la barre à la fois de son histoire intime et de celle des générations percutées de plein fouet par la violence des hommes et par les chimères des idéologies. Ce n’est pas par hasard que Letitia fait avec lucidité le constat que « la vérité est une bombe à retardement dont la toxicité est rémanente ».
Cette remarque de votre narratrice sur le danger objectif de la vérité est accompagnée dans la phrase qui suit par la nécessité impérative de la proclamer. « Mais comme il m’a été difficile de me taire ! », nous dit-elle. N’exprime-t-elle pas à travers ces mots un vrai devoir de l’écrivain d’affirmer cette vérité, même si cette notion échappe à de nombreuses tentatives de la réduire à une simple définition et surtout qui semble l’éloigner de sa liberté de création ? Plus généralement, quelle place doit-on accorder, selon vous, au thème du témoignage et de la mémoire dans la reconstitution du passé de la Roumanie à travers la littérature ?
Je suis agréablement surprise qu’apparemment par un pur hasard, à travers une remarque de mon personnage, vous avez réussi à mettre en lumière la motivation qui m’a poussé à devenir écrivain. Ne pas mentir et dire la vérité sont les raisons qui m’ont incité à écrire pendant toute la période communiste. Dépourvue de tout projet politique ou social, je voulais simplement contredire le festivisme qui régnait dans l’atmosphère ambiante du régime, la fausse image qui s’était construite autour, la duplicité dans laquelle nous vivions. Je m’intéressais à la vie ordinaire des gens qui se déroulait autour de moi, à leurs problèmes, à leurs souffrances quotidiennes. J’avais commencé par aborder des sujets d’actualité, mais le présent reste toujours lié au passé. Il est impossible, du moins pour moi, d’écrire sur le présent sans aborder le passé individuel des personnages. Et à certains moments de l’histoire, le passé collectif entraîne le passé individuel dans ses cataclysmes. J’ai l’impression que le recours à la mémoire est moins important pour les écrivains nés dans des sociétés stables et démocratiques que pour d’autres comme moi, par exemple.
C’est mon père qui a éveillé mon intérêt pour l’histoire. Il enseignait cette matière et aimait énormément son métier. Nous étions dans les années 1950, à l’apogée du stalinisme, et tout le monde avait le sentiment que les récits officiels du passé étaient falsifiés à des fins politiques. En Roumanie, l’utilisation politique du passé a toujours été monnaie courante, mais pendant la période communiste, elle avait atteint de vrais sommets, car il était impossible de trouver un discours vrai dans les livres ou les médias. Les traumatismes causés par une société totalitaire ont laissé des traces sombres sur le destin des gens pendant des décennies. La jeune Claudia, un de mes personnages de Fontaine de Trevi, fuit la Roumanie violente de 1989-1990, prolongeant la période de ses études à l’étranger, incapable d’assumer des responsabilités d’adulte. Personnellement, j’ai ressenti un profond devoir de témoigner de cette période de violence collective, d’injustice et de crimes jamais punis. Je l’ai fait en tant que journaliste, mais j’ai longuement réfléchi avant de transposer cette problématique dans le genre romanesque. Dans Fontaine de Trevi, j’ai utilisé l’angle narratif de Letitia, même si elle n’est pas la voix la plus crédible, car, en tant qu’émigrée, elle ne connaît les faits racontés qu’à travers la version de son amie Sultana Morar qu’elle écoute avec peu d’empathie.
Un deuxième aspect qui me semble tout aussi important pour comprendre votre univers narratif, c’est son angle introspectif, très proche du journal intime, genre littéraire que Letitia espère pouvoir utiliser « pour retranscrire les notes de cette époque dans un roman, en les réécrivant à la troisième personne ». Que pouvez-vous nous dire concernant cette manière de penser et de réaliser le récit de fiction à l’aide de la réécriture ? Dans quelle mesure s’inscrit-elle dans l’ensemble de la tonalité et du style de la trilogie ?
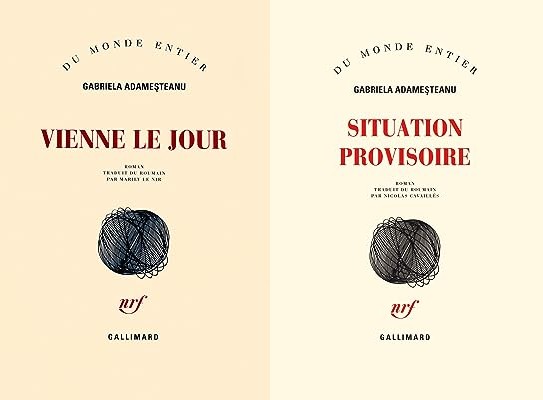 La trilogie commence avec Vienne le jour, 2009, Gallimard (Drumul egal al fiecărei zile), dans lequel Letitia raconte son histoire, de l’enfance à l’université où Petru Arcan tombe amoureux d’elle. Dès le début, j’ai utilisé la narration à la première personne et une approche introspective. Le lecteur suit une jeune fille qui grandit dans les provinces de la Roumanie d’après-guerre, élevée par sa mère et son oncle. Elle suit des études à l’université où elle finit par s’émanciper de l’autorité familiale. Elle perçoit une force extérieure qui gouverne son destin (l’arrestation de son père lorsqu’elle était enfant, les secrets de famille auxquels elle n’a pas accès). Lorsqu’elle réalise que l’histoire s’impose à elle, Letitia tente de s’adapter à l’air du temps en épousant Petru Arcan. La jeune Letitia est une narratrice plus fiable qu’à l’âge de la sénescence dans Fontaine de Trevi, car entre-temps elle a accumulé une série d’autres tentatives d’adaptation à différentes professions dans d’autres pays, toujours avec son mari, Petru Arcan, comme parapluie. Mais dans sa valise, elle transporte un passé plein de secrets, qu’elle révèle peu à peu. Pour ces raisons, j’ai décidé de ne pas écrire à la troisième personne, comme dans Situation provisoire, le deuxième volume de la trilogie. Une fois de plus, dans Fontaine de Trevi, j’ai eu besoin d’une narration à la première personne pour rapprocher le lecteur d’une psychologie féminine plus tourmentée. En vieillissant, Letitia devient confuse, déchirée entre son ancien pays, la Roumanie, et son pays d’adoption, la France, mais toujours hantée par le goût amer de l’amour trahi et les conséquences dramatiques d’une interruption illégale de grossesse qui l’avait privée de la chance d’être mère.
La trilogie commence avec Vienne le jour, 2009, Gallimard (Drumul egal al fiecărei zile), dans lequel Letitia raconte son histoire, de l’enfance à l’université où Petru Arcan tombe amoureux d’elle. Dès le début, j’ai utilisé la narration à la première personne et une approche introspective. Le lecteur suit une jeune fille qui grandit dans les provinces de la Roumanie d’après-guerre, élevée par sa mère et son oncle. Elle suit des études à l’université où elle finit par s’émanciper de l’autorité familiale. Elle perçoit une force extérieure qui gouverne son destin (l’arrestation de son père lorsqu’elle était enfant, les secrets de famille auxquels elle n’a pas accès). Lorsqu’elle réalise que l’histoire s’impose à elle, Letitia tente de s’adapter à l’air du temps en épousant Petru Arcan. La jeune Letitia est une narratrice plus fiable qu’à l’âge de la sénescence dans Fontaine de Trevi, car entre-temps elle a accumulé une série d’autres tentatives d’adaptation à différentes professions dans d’autres pays, toujours avec son mari, Petru Arcan, comme parapluie. Mais dans sa valise, elle transporte un passé plein de secrets, qu’elle révèle peu à peu. Pour ces raisons, j’ai décidé de ne pas écrire à la troisième personne, comme dans Situation provisoire, le deuxième volume de la trilogie. Une fois de plus, dans Fontaine de Trevi, j’ai eu besoin d’une narration à la première personne pour rapprocher le lecteur d’une psychologie féminine plus tourmentée. En vieillissant, Letitia devient confuse, déchirée entre son ancien pays, la Roumanie, et son pays d’adoption, la France, mais toujours hantée par le goût amer de l’amour trahi et les conséquences dramatiques d’une interruption illégale de grossesse qui l’avait privée de la chance d’être mère.
À regarder de plus près encore, l’intimité dont parle Letitia prend une dimension fortement symbolique et devient un vrai credo littéraire. « Écrire – nous dit-elle –, c’est assumer de passer nu parmi une foule de gens habillés qui commenterons en chuchotant ou à voix haute, votre nudité. » Elle évoque la célèbre phrase attribuée à Flaubert, Madame Bovary c’est moi, et finit par se poser à elle-même cette question : « Et dans mon propre roman, qu’est-ce que j’ai fait d’autre ? » Comment pouvez-vous répondre à cette question ?
J’ai hésité à définir en ces termes (certes un peu crus) le métier d’écrivain, qui bénéficie généralement d’une image positive, souvent flatteuse. Mais, d’après mon expérience, c’est un métier dur, et encore plus difficile lorsque l’on est une femme. Pour un homme, il s’agit d’un métier « bien ancré » (si je puis dire) depuis deux ou trois siècles en France. Et peut-être même pour une femme. Mais dans une littérature plus jeune, comme la littérature roumaine, où, entre les deux guerres, le roman n’a été illustré au plus haut niveau que par la romancière Hortensia Papadat-Bengescu (beaucoup de ses livres ont été traduits et ont paru en France), être une femme écrivain demandait du courage et de la persévérance. Écrire en tant que femme sur l’histoire, mais aussi sur le corps féminin, le désir, l’adultère et l’avortement (qui est aussi le sujet de l’œuvre d’Annie Ernaud) n’était pas facile, ni en 1975, lorsque mon premier livre a été publié, ni en 2018, lorsque j’ai publié Fontaine de Trevi. Ce n’est pas un hasard si, parmi les autres récompenses que j’ai reçues après la publication de ce roman, j’ai reçu le Prix Sofia Nădejde pour la littérature écrite par des femmes. Bien sûr, il y a maintenant beaucoup de femmes écrivains qui abordent des thèmes considérés comme inconfortables pour les femmes.
Revenons à l’axe thématique qui traverse Fontaine de Trevi, celui de la mémoire. Le mécanisme intime que nous avons déjà évoqué permet à Letitia de re/construire son identité à l’aide de ce que la théorie littéraire appelle « la mémoire partagée ». Tout y est : sa condition de femme, d’épouse et d’amante trahie, ses rêves et ses déceptions, jusqu’à « la honte d’un amour indicible, passé entre des draps étrangers », de femme mure ensuite qui ose parler d’une vie de couple « construite sur un mensonge » (p.335). Qui est cette femme qui, malgré tout, vit dans son for intérieur une éternelle jeunesse, un état d’âme qu’elle décrit à la fin du roman dans cette phrase saisissante : « j’ai vieilli sans jamais devenir adulte » ?
Comme beaucoup de personnes en Roumanie, Letitia a une psychologie de survivant, dépourvue d’empathie et de générosité. De l’enfance à l’âge avancé qu’elle a atteint maintenant, elle a survécu à des moments difficiles. Ce qui lui permet de tenir, c’est une vitalité alimentée par une certaine dose d’égoïsme. Un certain égoïsme, que le lecteur perçoit à la fin de Fontaine de Trevi. Letitia n’assume pas la responsabilité de ses actes, comme une adulte. Elle a construit son mariage avec Petru Arcan sur un mensonge, lui faisant croire que sa grossesse non planifiée était due à lui, et non à son amant Sorin, qui l’avait abandonnée. Bien qu’elle sache que Claudia, la fille de ses amis Morar, étudiante aux États-Unis, avait des problèmes d’argent, Letitia s’abstient de lui envoyer une petite aide financière, gardant ses économies pour ses vieux jours. À l’annonce du cancer de Claudia, Letitia rejette ses remords, les justifiant auprès d’elle-même et même auprès du lecteur.
Nous savons que votre saga des Branea dont Letitia est l’une des descendantes, accorde une place tout aussi importante à la mémoire historique. Quel rapport entretient-elle avec cette mémoire familiale ?
La trilogie est extrêmement autonome, chaque roman peut être lu sans aucun lien avec les autres. Pris dans son ensemble, c’est l’histoire intime de la vie d’une femme, au fil du temps, de la puberté et jusqu’à la vieillesse. Une vie placée sous le signe des influences de l’histoire de son pays, qui a touché certains membres de sa famille par la violence du régime. Le rapport de Letitia à la mémoire de sa famille évolue au cours de cette longue période. La Roumanie était un pays traditionnel conservateur dans lequel la famille jouait un rôle prédominant, sentiment qui a été renforcé par l’idéologie communiste. La famille était le seul endroit où les individus pouvaient espérer protéger leurs droits. En même temps, la famille était le lieu où s’exerçaient toutes les pressions. Les individus étaient soupçonnés en permanence d’être coupables à cause du présent ou du passé de leurs proches, culpabilité que j’évoque dans Situation provisoire. Dans la famille de Letitia, comme dans des millions d’autres familles, un silence lourd s’est posé sur le passé « compromettant » de certains de ses membres. Letitia sait que son père a été en prison, mais elle ne sait pas pourquoi et ne veut pas le savoir. Lorsque Letitia entre à l’université (Vienne le jour), on lui remet une fausse biographie qu’elle peut réciter sans risque de se tromper. A l’âge adulte, elle n’est pas du tout intéressée par les biographies de ses oncles, mal vues par les autorités communistes, d’autant plus que son mari, Petre Arcan, lui reproche de voir sa carrière universitaire bloquée à cause des « péchés politiques » de la famille de sa femme. Le refus de Letitia de connaître le passé de sa famille prend fin après la Révolution, lorsque la Roumanie sort brutalement du communisme et fait ses premiers pas dans le capitalisme. Letitia, elle-même changée par ses années passées en France, est obsédée dans la Fontaine de Trevi, par l’héritage (maisons et terres) de ses oncles, qu’elle rêve de récupérer.
Revenons au temps de la narration. Letitia note une phrase qui a retenu mon attention : « Plus je vieillis, moins j’ai des souvenirs communs avec mes amis de jeunesse : personne n’a retenu la même chose des moments que nous avons vécu ensemble, et les mémoires se détériorent à des rythmes différents ». Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette mémoire qui ressemble plutôt à un choix amnésique, à la carte, sélectif ? Et que dit cette amnésie de l’évolution des individus comme les Morar, par exemple ?
La phrase qui a retenu votre attention est malheureusement une vérité biologique : avec l’âge, la mémoire décline. Mais dans le roman, chaque personnage est amnésique à sa guise, ne se souvenant plus des vérités inconfortables du passé plus ou moins récent. Petru semble avoir oublié les reproches qu’il faisait à Letitia à cause de l’histoire de sa famille, les Morar ont oublié la peur ressentie pendant la période du communisme et se hissent au rang d’organisateurs de manifestations, Claudia se rend dans des universités étrangères pour oublier la mort de son amoureux, tué pendant la Révolution de 1989, Letitia, préoccupée par la récupération des biens de ses oncles Branea, ne se souvient plus de son indifférence à leur mémoire.
Ne doit-on plutôt pencher du côté de Petru, le mari de Letitia, intellectuel exilé en Occident, dont les sarcasmes envers la nouvelle société roumaine d’après la chute du régime communiste ne cessent de tirer le signal d’alarme à son épouse ? Donnons-lui la parole avec ce court extrait : « La société roumaine n’est jamais sortie du féodalisme, ni pendant l’entre-deux-guerres, ni pendant la période communiste, ni de nos jours ».
J’ai été surprise de constater, en discutant avec des lecteurs de La Fontaine de Trevi, qu’ils appréciaient Petre Arcan, le mari de Letitia, considéré comme le « raisonneur » du roman. Je ne lui avais pas accordé beaucoup d’attention dans les trois volumes de la trilogie. Dans Situation provisoire, il était le personnage plutôt négatif, un mari cocu, renfrogné, alcoolique et rancunier qui, en raison de problèmes liés à sa carrière universitaire, avait décidé d’émigrer en Occident sans consulter sa femme qui, soit dit en passant, le trompait. Jouant le rôle de l’homme qui dit des choses cyniques, il aime en fait asséner des vérités sans complaisance sur la société roumaine. Les Roumains aiment dire des choses désagréables sur eux-mêmes (la plupart du temps vraies), ce qui explique son succès. Petru Arcan reste dans l’ombre de Letitia qui, elle, perd une bonne partie de la sympathie du lecteur dans le dernier volume de la trilogie.
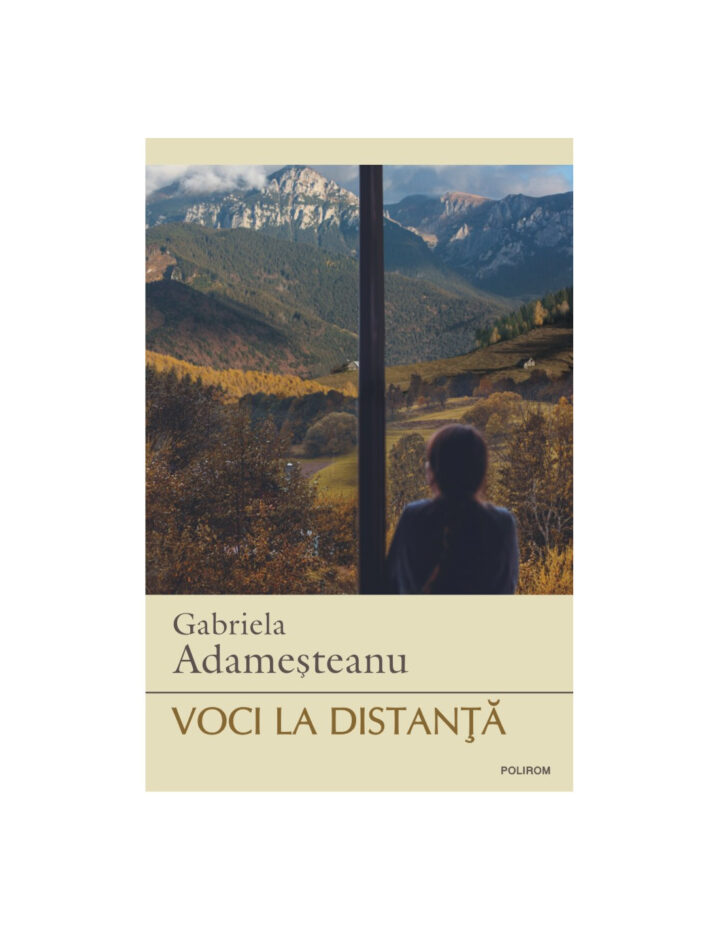 Quant à l’éternelle féodalité de la société roumaine que dénonce Petru Arcan, je suis en partie d’accord avec lui. À l’approche des élections locales de 2024, on trouve encore des maires corrompus, à la tête de leur administration depuis trois mandats, entourés de vassaux. J’ai décrit la figure d’un tel maire féodal dans mon récent roman, Voci la distanță [Voix à distance], publié en roumain en décembre 2022, et j’espère qu’il sera traduit en français.
Quant à l’éternelle féodalité de la société roumaine que dénonce Petru Arcan, je suis en partie d’accord avec lui. À l’approche des élections locales de 2024, on trouve encore des maires corrompus, à la tête de leur administration depuis trois mandats, entourés de vassaux. J’ai décrit la figure d’un tel maire féodal dans mon récent roman, Voci la distanță [Voix à distance], publié en roumain en décembre 2022, et j’espère qu’il sera traduit en français.
Nous avons évoqué au passage la famille Morar, anciens collègues et amis de Letitia et Petru. Quel sens pourrions-nous donner à leur condition après 1989 ? Sont-ils le symbole d’une société ayant connu le naufrage d’un changement trop brutal, trop rapide de régime ?
Lors de chacune de ses visites à Bucarest, au cours desquelles elle confronte ses souvenirs à la réalité du terrain, Letitia habite chez de vieux amis, les Morar. Sultana et Aurel Morar ont été victimes d’injustices pendant le régime communiste à cause des agissements de Claudiu, le frère dissident d’Aurel, mort dans des circonstances mystérieuses. En tant que parents de dissident, les Morar sont élus après la chute du régime à la tête d’une association démocratique. Le couple, honnête et naïf, s’investit corps et âme dans leur engagement civique, mais le milieu corrompu les écarte sans scrupules. Pauvres et usés par l’âge, ils sont incapables de payer les études de leur fille Claudia, une adolescente traumatisée par la violence de la révolution roumaine, qui tombe malade d’un cancer, loin d’eux et sans assurance maladie. La famille Morar est pour moi le symbole des personnes de bonne foi qui se sont noyées dans les eaux troubles de la transition vers le capitalisme.
Pour conclure, je pense que le titre de votre roman Fontaine de Trevi, est le mieux placé car il met en scène à la fois le nom du monument historique romain et « sa symbolique retorse », comme la qualifie votre narratrice. Pourquoi avez-vous choisi ce titre et quelle est la charge la plus pertinente que vous lui attribuez ?
La Fontaine de Trevi de Rome, dans laquelle Claudia a jeté une pièce lors de son premier voyage depuis la Roumanie, faisant le vœu de vivre dans le monde occidental, devient le symbole de l’émigration. Je voulais y incarner le désir de partir et l’espoir d’une nouvelle vie, qui n’est pas toujours couronnée de succès. L’obsession de l’identité, le déracinement, la tentative d’affronter et d’accepter notre passé font partie des thèmes de mon roman.
Propos recueillis par Dan Burcea
Crédits photo de l’auteure : © Cătălina Flămânzeanu
Gabriela Adameșteanu, Fontaine de Trevi, Éditions Gallimard, 2022, 522 pages (traduction de Nicolas Cavaillès).

