
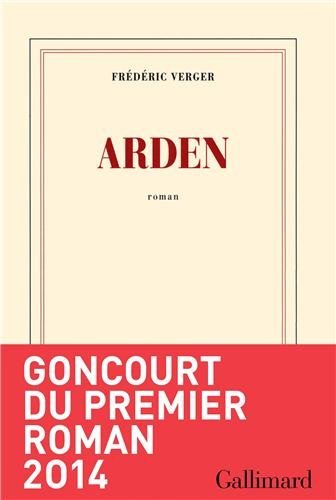 S’il fallait choisir un mot pour décrire le sentiment que procure la lecture du roman Arden, de Frédéric Verger, ce mot serait celui de délectation. Le sens très particulier pour l’art de la métaphore dont l’auteur fait preuve et la maîtrise de l’intrigue conjuguent harmonieusement un langage multicolore et une narration pleine de rebondissements et de fougue. Le tout resplendit dans la lumière d’une humanité et d’un pittoresque provenant des personnages venus d’ailleurs, d’un temps et d’un pays où le droit de rêver se réjouit d’une absolue licence. D’où vient cette histoire traversée de joies et de peurs, de rêverie voulant repousser dans ses retranchements le cauchemar de la haine des hommes? Qui sont ces personnages et quel lien cet univers romanesque a-t-il avec la réalité, alors que Frédéric Verger jure avoir tout inventé ?
S’il fallait choisir un mot pour décrire le sentiment que procure la lecture du roman Arden, de Frédéric Verger, ce mot serait celui de délectation. Le sens très particulier pour l’art de la métaphore dont l’auteur fait preuve et la maîtrise de l’intrigue conjuguent harmonieusement un langage multicolore et une narration pleine de rebondissements et de fougue. Le tout resplendit dans la lumière d’une humanité et d’un pittoresque provenant des personnages venus d’ailleurs, d’un temps et d’un pays où le droit de rêver se réjouit d’une absolue licence. D’où vient cette histoire traversée de joies et de peurs, de rêverie voulant repousser dans ses retranchements le cauchemar de la haine des hommes? Qui sont ces personnages et quel lien cet univers romanesque a-t-il avec la réalité, alors que Frédéric Verger jure avoir tout inventé ?
À toutes ces questions Frédéric Verger nous répond avec la gentillesse qui lui est si familière.
Malgré votre déclaration sur l’omniprésence de l’imaginaire, pourrait-on espérer de trouver dans cet univers secret une petite dose de réel, et, si oui, d’où vient-elle, qu’y a-t-il de personnel dans cet exercice littéraire ?
J’éprouve une difficulté étrange à utiliser mes propres expériences de façon directe dans un roman. J’aime que mon matériau possède le caractère fantaisiste, arbitraire, que peut avoir un scénario pour un metteur en scène ou un livret pour un compositeur d’opéra. Découvrir ce qu’il y a de vivant, de déchirant, dans une vision, un don arbitraire de l’imagination. Après tout, et pour prendre un exemple illustre, il ne venait à personne l’idée de demander à Mozart ce qu’il y avait de personnel dans L’Enlèvement au Sérail.
Ou, peut-être, accordez-vous toutes ces largesses au narrateur qui en profite pour consolider sa liberté et nous livrer une évocation pleine d’admiration. Pourriez-vous nous en dire plus sur cet enfant qui, tout au long de la narration, refuse de grandir et entretien une fascination fidèle pour l’oncle Alexandre et tante Iréna, dignes représentants d’une famille dispersée en Europe centrale et jusqu’en Russie au cours du XIX e siècle?
Quant à la présence du narrateur, à ses références perpétuelles à “mon oncle” et “ma tante”, elles reflètent sans doute la conviction de l’auteur qu’il n’y a en réalité aucune différence entre l’imagination et la mémoire. Le romancier qui fait semblant de se souvenir joue, plus ou moins naïvement, avec cette vérité. Une des émotions artistiques les plus pures qui puisse naître d’un récit tient précisément à cette impression que le lecteur éprouve tout à coup, comme l’auteur avant lui, que le monde invraisemblable, forgé de toutes pièces, du roman acquiert le caractère nostalgique et déchirant d’un souvenir. J’ose espérer que ce que vous appelez “une évocation pleine d’admiration” est une autre façon de nommer cette impression.
Le cadre de votre roman respire le même caractère envoûtant, se nourrissant d’abord de contes assaisonnés «d’atrocités et d’invraisemblance», et choisissant domicile en Marsovie, appelée le « Monaco des Carpates », pays imaginaire situé entre la Hongrie, la Roumanie et l’Ukraine. Ce merveilleux pays ressemble à un coin de paradis fait « de vastes étangs » et de forêts au feuillage d’argent. Au centre de ce cadre paradisiaque règne en maître le Grand Hôtel Arden, ancien sanatorium, lieu fabuleux, bâti sur un vrai mythe fondateur, celui du mariage, en 1914, de l’oncle Alex avec tante Irèna « qui lui avait offert la forêt d’Arden ».
Comment avez-vous choisi cette géographie imaginaire ?
L’hôtel et le domaine d’Arden me sont apparus en même temps que le personnage de l’oncle Alex. Les feuillages frémissants, les tentures noires de la salle à manger, la tâche d’œuf sur le plastron constituent un charme dont pour moi l’intérêt ou le charme sont indissociables. Pour le reste, les paysages, et plus particulièrement peut-être les forêts, les promenades en forêt, sont liées mystérieusement pour moi au plaisir de la fiction, sans que je sache très bien lequel du paysage ou de la fiction est la métaphore de l’autre.
Quant à la géographie, comme les gérants des hôtels de luxe d’antan je me considère partout chez moi en Europe. Mais mes clients à moi sont des livres, ou les fantômes des écrivains que j’aime, clientèle raffinée et accommodante. Et comme beaucoup sont originaires de l’Europe centrale et orientale, j’essaie que le décor leur rappelle la vie d’ici-bas. Charmante attention d’hôtelier.
L’oncle Alexandre, « l’aïeul illustre », est un « rêveur, valseur et fornicateur », il portait « un frac et un gilet rayé de diplomate », comme un « prince en exil ». À ses côtés, tante Iréna, au caractère si opposé et qui, trente ans plus tard, deviendra « misanthrope et maladive », vivant enfermée dans sa chambre obscure. Parlez-nous de ce couple « pathético-ironique ».
Ils semblent tirer un plaisir pervers à cultiver leurs différences, qui les transforment en personnages, à faire en sorte que leur mariage paraisse une monstruosité grotesque à tout le monde et d’abord à eux-mêmes. Mais l’ironie et le pathétique le plus touchants tiennent peut-être à ce que sans le savoir, et justement à cause de ce jeu, ils forment un vrai couple.
Il y a ensuite Salomon, ami de toujours de l’oncle Alexandre, figure emblématique de l’individu mal dans sa peau, dépassé par son époque, un vrai clown triste, « un barbon d’opéra ou de jeu de massacre » dans un spectacle que joue le siècle. C’est le partenaire idéal pour les rêveries d’opérettes des deux comparses.
Salomon est un homme qui ne vit que sur lui-même. En ce sens, il est à la fois le plus triste, le moins extravagant en même temps que le plus fou peut-être des deux comparses. Mais il est aussi le plus authentiquement « artiste », dans l’acception romantique du terme. C’est un homme qui, sans vraiment le savoir, n’aura vécu sa vie qu’au travers d’une histoire, celle du Hollandais Volant.
Arrêtons-nous maintenant à la vraie Histoire, celle qui passe au-dessus des destins individuels, et qui n’épargne pas la Marsovie de nos deux amis compositeurs du dimanche. La montée de l’antisémitisme est brutale et contagieuse profitant d’un climat « historico-délirant » répandu dans les journaux de l’époque, et qui ne va pas tarder à montrer son vrai visage.
Ce que nous appelons l’Histoire n’est souvent que la tentative pompeuse, pathétique et mensongère pour donner un peu de grandeur et de dignité au caractère fondamentalement absurde et dérisoire des événements, même des apocalypses les plus atroces. Au XX° siècle, les massacres les plus odieux n’ont la plupart du temps comme origine que des rêveries primitives ou des constructions intellectuelles vulgaires. C’est ce que comprend Salomon quand il se dit que ce n’est pas l’Antéchrist qui veut sa mort mais une horde de petits-bourgeois grégaires et cruels. Une vérité que les hommes ne veulent pas voir en face, surtout à une époque qui a fait de l’Histoire une sorte de religion, de théodicée. Alors les historiens sont comme des valets de pied qui couvrent d’une veste noire de bon ton les monstres qui entrent dans l’église.
Dans ce contexte, la passion des deux amis pour l’opérette se transforme en une vraie stratégie. Alexandre va l’utiliser pour sauver de l’extermination son ami Salomon, sa fille et l’orchestre juif qu’il cache dans le sous-sol de son hôtel. Quel rôle accordez-vous à l’art, à la rêverie pour faire face à la brutalité du monde ?
La stratégie de l’oncle Alex est peut-être plus obscure, moins pure que vous ne semblez le dire. Mais quel que soit le talent, ou l’absence de talent, de mes deux compères, ils sont indéniablement des artistes, non dans l’acception pompeuse ou mégalomane du mot, mais simplement parce que leur vie est toute entière occupée à recréer de façon enfantine, gratuite, le monde. L’art, la rêverie, sont des moyens pour exister de façon supérieure. Tout ce que nous prenons pour des richesses de la nature humaine ne sont que des créations de l’art, au sens large. L’art ne reflète pas l’humain, il l’invente. L’européen moyen d’aujourd’hui ressemble à un aveugle errant à l’intérieur d’une cathédrale où il est entré sans le savoir : il prend la fraîcheur, la douceur des chants, l’ivresse de l’encens pour des réalités naturelles de la vie. Mais elles ne le sont pas et disparaîtront si l’on cesse de bâtir, de chanter, de prier.
A la fin de ce voyage, j’ai envie de vous poser cette question dont les racines se trouvent dans ces mots que vous écrivez dès les premières pages du livre mais qui, à mon avis, révèlent leur sens à la fin seulement : «[…] et plus qu’une fois dans ma vie je me suis demandé à laquelle de ces deux espèces j’appartenais, espérant sans cesse, à la façon d’un voyageur qui croit à chaque détour du chemin découvrir le pays où il se rend, que les aléas de la vie me l’apprendraient un jour. Et qui dit que je n’écris pas cette histoire pour le savoir enfin». Le savez-vous maintenant ?
Non, bien sûr. La ronde incessante de la mélancolie et de l’ivresse, leur complicité mystérieuse, me semblent toujours aussi mystérieuses, essentielles. Je n’écrirais pas si elles disparaissaient.
Propos recueillis par Dan Burcea (24/04/2014)
Frédéric Verger, Arden, Éditions Gallimard, août 2013, 480 pages, 21,50 €

