
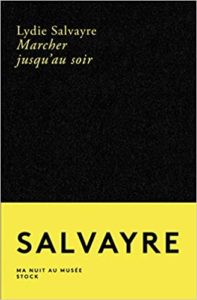 Marcher jusqu’au soir est le récit d’un défi pas comme les autres que Lydie Salvayre doit relever à l’invitation de son éditrice. Elle doit passer une nuit enfermée seule dans le musée Picasso où est donnée l’exposition Picasso-Giacometti. Rien de spécial en apparence, la seule consigne étant de raconter le vécu de cette expérience suscitée par la proximité nocturne de ces œuvres d’art. Après de nombreuses hésitations, elle accepte le pari. La voici donc installée sur un lit de campagne à proximité de la statue éclairée par « une lumière froide de parking » de L’Homme qui marche de Giacometti. Une nuit agitée s’annonce pour Lydie Salvayre où tout va être passé au peigne fin : considérations sur l’art et les musées, convictions et états d’âme, et surtout une introspection qui en dira long sur l’écrivaine et la femme qu’elle est. Entourée de ces « choses admirables », et invoquant ses auteurs préférés, elle va donner libre cours à ses réflexions sur les thèmes majeurs de son écriture, surtout sur ceux qui concernent ses origines et ses convictions autour de la vie et de la mort.
Marcher jusqu’au soir est le récit d’un défi pas comme les autres que Lydie Salvayre doit relever à l’invitation de son éditrice. Elle doit passer une nuit enfermée seule dans le musée Picasso où est donnée l’exposition Picasso-Giacometti. Rien de spécial en apparence, la seule consigne étant de raconter le vécu de cette expérience suscitée par la proximité nocturne de ces œuvres d’art. Après de nombreuses hésitations, elle accepte le pari. La voici donc installée sur un lit de campagne à proximité de la statue éclairée par « une lumière froide de parking » de L’Homme qui marche de Giacometti. Une nuit agitée s’annonce pour Lydie Salvayre où tout va être passé au peigne fin : considérations sur l’art et les musées, convictions et états d’âme, et surtout une introspection qui en dira long sur l’écrivaine et la femme qu’elle est. Entourée de ces « choses admirables », et invoquant ses auteurs préférés, elle va donner libre cours à ses réflexions sur les thèmes majeurs de son écriture, surtout sur ceux qui concernent ses origines et ses convictions autour de la vie et de la mort.
Quel est cet incroyable défi lancé par votre éditrice et comment l’avez-vous accueilli ?
Alina Gurdiel a imaginé une collection qui donnerait la parole à des écrivains enfermés pour une nuit dans un musée de leur choix. Cette collection dont le titre est Ma Nuit au Musée a été inaugurée par Kamel Daoud, et de nombreux écrivains dont les livres paraîtront ultérieurement se sont prêtés à cette expérience.
Quelles ont été les raisons qui vous ont poussée à « envoyer valser [les] dernières réticences », et accepter cette invitation ?
J’imaginais que cette proposition de passer une nuit seule face aux œuvres admirées était un luxe, une chance inouïe, une proposition à saisir car elle ne se répèterait pas deux fois. J’imaginais qu’elle me permettrait le recueillement et la rencontre avec ces œuvres. J’éprouvais déjà une admiration infinie devant l’Homme qui marche de Giacometti que je n’avais vu que sur des reproductions papier. J’imaginais donc que de le voir « pour de vrai » serait un éblouissement encore plus grand. Mais ce n’est pas du tout ce qui est advenu.
Une fois à l’intérieur du musée, vous appelez au secours votre « cœur d’écrivain » afin de vous permettre à vous « acclimater à cette froideur et à ce silence ». En quoi croyez-vous que ce cœur soit plus apte à l’émerveillement que ce que vous nommez « un cœur ordinaire » ?
Mon cœur d’écrivain serait celui qui bat avec lenteur, qui ne se précipite pas sur les choses, qui prend le temps d’approfondir, de penser, d’observer. Mon cœur d’écrivain serait le contraire d’un cœur consumériste, d’un cœur pressé, d’un cœur efficace. Je pensais donc que la solitude, le silence, la longueur d’une nuit entière auprès de l’Homme qui Marche réuniraient les conditions les plus favorables qui soient pour que s’exprime mon cœur d’écrivain.
Entourée de tant d’œuvres d’art dont L’Homme qui marche que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder, les murs de vos réticences semblent céder et avec eux une bonne quantité de lieux communs sur « le trésor marchand et le trésor artistique » de l’art. Quels sont vos sentiments à ce moment de votre séjour ?
J’éprouve une forme de colère contre moi qui, contrairement à ce que j’espérais, n’éprouve rien qu’un malaise diffus, une forme d’appréhension vague. Et cette colère m’amène à me poser un certain nombre de questions : serais-je devenue insensible à l’art, incapable d’aller à la rencontre des œuvres, sans aucune place en moi pour la beauté ? Mon cœur serait-il devenu sec comme une pierre ? Avais-je, jusqu’à présent, admiré l’Homme qui marche parce que j’avais été conditionnée à l’aimer ? Sommes-nous tous, plus ou moins, conditionnés à aimer ou désaimer telle ou telle œuvre? Sommes-nous soumis aux injonctions de ceux qui décident de la valeur des choses ? Sommes-nous en quelque sorte colonisés de l’intérieur ? L’art contemporain n’est-il pas pris en otage (et nous avec) par une poignée de financiers, une poignée de galeristes et une poignée d’artistes internationaux qui fonctionnent comme de véritables entrepreneurs et imposent leur loi au monde entier ? Cette marchandisation de l’art contemporain n’est-elle pas, d’une certaine façon, le miroir de la marchandisation du monde ? etc. etc.
Puis assez vite, je réalise que cette mise en cause d’un certain art contemporain constitue désormais un nouveau conformisme, un nouveau lieu commun ; que surtout elle n’ouvre aucune issue et se satisfait paresseusement de son impuissance ; et qu’enfin elle laisse de côté tout un pan de l’art d’aujourd’hui qui essaie d’exister autrement, dans d’autres lieux, sous d’autres formes que ce financial art.
Je vais dès lors revenir à moi, au plus intime de moi, à la façon dont s’est constitué dès l’enfance mon rapport à l’art et à la culture en général.
Ce dialogue imaginaire fait également resurgir des souvenirs jusqu’ici cachés. Celle de votre « père redoutable », par exemple ?
Oui, la peur que je ressens, à un moment de la nuit, devant les œuvres de Giacometti qui sont habitées me semble-t-il par la mort, m’amène à me ressouvenir de la peur que m’inspirait mon père lorsque j’étais enfant. C’est la première fois de ma vie que je parviens à évoquer frontalement dans un livre ce rapport douloureux à mon père que j’avais, jusqu’à ce jour, tenu secret. Et je mesure, à cette occasion, le temps infini qu’il faut quelquefois pour que des évènements qui vous constituent puissent se convertir en écriture. Presque une vie en ce qui me concerne. Presque le temps d’une vie pour regarder ma vie en face.
Un autre souvenir est celui de la phrase que vous gardez douloureusement en mémoire Elle a l’air bien modeste, prononcée dans une soirée mondaine par la maitresse de la maison. Qu’a-t-elle représenté pour vous et en quoi vous a-t-elle poussé à devenir par la suite ?
Comme vous le savez, je suis née de parents réfugiés politiques espagnols et j’ai grandi au sein d’un milieu ouvrier dans lequel la «grande culture» était totalement absente. J’ai dû faire d’énormes efforts pour m’approprier cette culture que j’ai longtemps cru inatteignable et réservée aux autres. Aussi, lorsque, devenue adulte et invitée dans un dîner bourgeois, l’hôtesse dit de moi : elle a l’air bien modeste, j’ai le sentiment que tous les efforts que j’ai déployés pour accéder à cette grande culture n’ont servi à rien, que mon origine sociale est marquée à tout jamais sur mon visage et dans mes manières, et j’en éprouve un profond sentiment de révolte.
Il m’arrive de penser que c’est ce sentiment de révolte qui m’a amenée à écrire. Il m’arrive de penser que l’on n’écrit jamais que pour convertir l’insupportable d’une situation.
Une autre évidence à laquelle vous pensez est celle de la mort : non pas à l’idée de la disparition comme fatalité, mais comme condition redoutable vers laquelle l’Homme de Giacometti se dirige et que vous partagez dans le plus profond de vous-même. Rajoutons à cela le titre de votre livre. D’où est-il inspiré et que nous dit-il sur la méditation que vous livrez sur la mort ?
On m’a diagnostiqué un cancer il y a quelques années, cancer pour lequel je suis toujours suivie. J’ai appris, à ce moment-là, que j’étais mortelle, et je vis désormais le sachant. Mais loin de m’abattre, cet inéluctable a renforcé en moi mon désir de marcher jusqu’au soir pour reprendre un vers de Baudelaire, marcher jusqu’au soir : je veux dire rester vivante jusqu’à la dernière seconde, jusqu’au dernier souffle, jusqu’au dernier battement.
Vous évoquez également l’ambition de Giacometti de « figurer la vie, le mouvement, le regard ». Vous notez dans votre carnet : « faire œuvre c’était faire l’expérience de la limite de l’œuvre, de la limite de l’homme créant l’œuvre ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce constat ?
Ce qui me touche précisément chez Giacometti c’est qu’il essaie inlassablement de saisir l’invisible d’un visage, la force et le vivant d’un regard. C’est la raison pour laquelle il fait, défait, refait, détruit, reconstruit sans cesse avec le sentiment qu’il n’y parviendra jamais, que son projet est impossible, qu’il y a de l’irreprésentable. Et que cet irreprésentable constitue la limite de son geste créateur.
On pourrait dire que le geste d’écrire se heurte à la même impossibilité : il y a toujours une part d’innommable après laquelle les écrivains courent.
Toute sa vie, Giacometti n’a fait que recommencer, comme vous le dites, ce qu’il n’arrivait jamais à considérer comme fini, ayant une certaine valeur. Que pouvez-vous nous dire de ce « raté grandiose », comme vous le nommez ?
Giacometti considérait qu’une œuvre n’était jamais finie puisqu’elle ne pouvait jamais faire concurrence au vivant. Si bien qu’il avait le sentiment de ne jamais parvenir à achever une sculpture. Il se résignait simplement à l’abandonner. Car il avait beau s’obstiner jusqu’à la démence sur un portrait, il avait beau passer des nuits entières à travailler la glaise, il avait un constant sentiment d’échec devant ce qui, devant lui, se dérobait sans cesse.
Dans une époque comme la nôtre où les hommes se sentent contraints de réussir à tout prix, de gagner, d’être performants et dominateurs la profonde modestie de Giacometti m’apparaît comme un bienfait.
Interview réalisée par Dan Burcea
Lydie Salvayre, Marcher jusqu’au soir, Éditions Stock, 2019, 224 p.

