
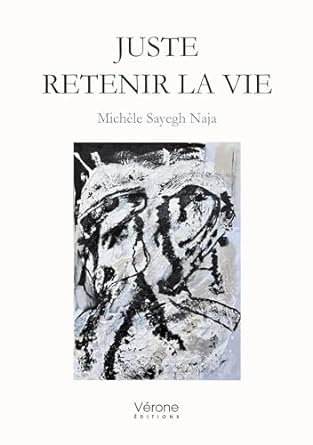 Michèle Sayegh Naja publie Juste retenir la vie, aux Éditions Vérone, un roman autobiographique d’une rare sensibilité confiant à un surprenant narrateur le rôle de chercher « à apprivoiser des petits riens pour retenir la vie », comme l’indique sa quatrième de couverture. Deux dates marquent le cours de ce récit, la révolution de 2019 et l’explosion du 4 août 2020, deux carrefours de l’Histoire qui vont décider de la vie de ses personnages, de leurs rêves et de leurs souvenirs, entre l’attachement à leur pays et le désir d’ailleurs, entre l’exile et le retour.
Michèle Sayegh Naja publie Juste retenir la vie, aux Éditions Vérone, un roman autobiographique d’une rare sensibilité confiant à un surprenant narrateur le rôle de chercher « à apprivoiser des petits riens pour retenir la vie », comme l’indique sa quatrième de couverture. Deux dates marquent le cours de ce récit, la révolution de 2019 et l’explosion du 4 août 2020, deux carrefours de l’Histoire qui vont décider de la vie de ses personnages, de leurs rêves et de leurs souvenirs, entre l’attachement à leur pays et le désir d’ailleurs, entre l’exile et le retour.
Après une contribution remarquée dans le domaine de l’apprentissage de la langue française, vous vous décidez d’écrire ce roman dont on reconnait ses fortes connotations autobiographiques. Quelles ont été les raisons secrètes – personnelles ou culturelles – qui vous ont poussée à franchir ce pas et embrasser le genre romanesque pour rendre compte du regard que vous portez sur le monde et sur la manière dont vous l’apercevez ?
Nikos Kazantzakis écrit: « Les meilleurs professeurs sont ceux qui savent se transformer en ponts, et qui invitent leurs élèves à les franchir. » J’ai donc essayé d’être ce pont. Je les ai aidés à le franchir en leur tenant la main, pour leur montrer, comme Alice Au pays des merveilles, l’autre côté du miroir. Dans le monde scolaire ou universitaire, j’ai toujours eu le souci de la transmission, pour dire à mes étudiants que la littérature est une façon détournée de raconter la vie.
Mais il y a un moment où on a envie, secrètement, de passer de l’autre côté, parce qu’à force d’analyser des romans, on a envie d’en faire partie. On ose ressembler à Icare. J’ai alors commencé à écrire en classe, pendant des réunions, sur des livres, sur un bout de papier, « des petits riens de la vie ». On commence toujours par faire semblant. Et puis, doucement, cette écriture est devenue un rituel puis une discipline.
Mais le fait de vivre au Liban réécrit nos parcours parce que l’histoire collective se greffe à l’histoire personnelle. Exilée dans mon propre pays, blessée dans ma chair par la Révolution, la crise économique et l’explosion du Port de Beyrouth, je n’ai plus pu me cacher derrière un « yalla » (en avant) rassurant. L’écriture est ainsi devenue une évidence. Et ce chemin m’a menée vers Rainer Maria Rilke qui écrit dans Pour écrire un seul vers : « il faut (…) sentir comment volent les oiseaux et savoir quel mouvement font les petites fleurs en s’ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser (…) à ses parents (…), à des maladies d’enfance, (…) à des mers, (…). Il ne suffit pas d’avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils reviennent. ». Les mots m’ont tenu la main à leur tour, pour me faire traverser un autre pont, celui qui va plus loin que le bout du crayon.
Le titre de votre livre exprime de manière concise l’urgence de s’accrocher à la vie et de refuser, comme le fait Tania, un de vos personnages, qui à son jeune âge ans vit « au rythme des pénuries ». La signification du syntagme Juste retenir la vie est sans doute plus profonde et pourrait s’étendre à d’autres aspects de la réalité que vous décrivez dans votre roman. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Je peux vous parler de la mer du Liban, des odeurs, des épices, du regard d’un enfant, des bras bronzés des chauffeurs de taxi, des rues délabrées qui résument le charme d’un pays. Ce ne sont pas des métaphores. C’est dans les parenthèses, au détour d’un chemin, que ce pays et ses secrets se révèlent.
Mais on ne vit pas comme les autres au Liban. On ne grandit pas comme les autres quand les maisons brûlent et qu’on doit apprivoiser de nouveaux draps. On ne grandit pas comme les autres quand notre vie est rangée dans une valise.
Pour ces raisons, ce livre est un cri, un désir d’invoquer la magie pour retenir les gens aimés, un pays qui s’écroule, des enfants qui partent. Je crois que ce titre est porté par l’adverbe « Juste » qui efface le superflu, alors que le verbe « retenir » renvoie à l’image d’une mère qui « tient » un pays, comme on berce un enfant. Elle s’agrippe à « ces petits riens de la vie » parce qu’elle a compris que les choses ne sont pas éternelles. Juste retenir la vie dit que l’essentiel est ailleurs et qu’il faut regarder du côté de la vie, du côté du soleil et d’une herbe désobéissante.
 Que dire de l’angle narratif inattendu choisi pour porter votre voix en tant que narratrice ? En quoi le Silo de Beyrouth mérite-t-il d’être ainsi anobli, si j’ose dire ? Est-ce que sa verticalité et sa vision panoramique ont influencé par leur symbolique votre choix ?
Que dire de l’angle narratif inattendu choisi pour porter votre voix en tant que narratrice ? En quoi le Silo de Beyrouth mérite-t-il d’être ainsi anobli, si j’ose dire ? Est-ce que sa verticalité et sa vision panoramique ont influencé par leur symbolique votre choix ?
Le narrateur est venu vers moi spontanément. Il s’est imposé en empruntant différentes facettes. J’ai voulu l’anoblir pour en faire d’abord un être héroïque, un symbole paternel. Mais il est le Silo du Port de Beyrouth, ce qui fait de lui le symbole d’un ventre nourricier, d’une « matrie », parce que le Silo est un réservoir où l’on entrepose du blé. Il est alors un symbole de paix. Il est aussi associé à l’image d’un phare par sa verticalité, ce qui renvoie à un symbole de protection. Pour aller plus loin, il est aussi omniscient parce qu’il connait les prières, les rues, les peurs des personnages ainsi que leurs rituels. Il devient donc le symbole de Dieu. Plus encore, ce narrateur est une image christique, puisque son histoire raconte une renaissance. Il est ici un symbole de vie. Mais le Silo est surtout le symbole du Liban, j’ai voulu en faire le narrateur de cette histoire pour lui donner une voix qui permettra peut-être de retrouver une « patrie » perdue.
La relation que vos personnages entretiennent avec le réel prend souvent la forme, non seulement du refus de Tania que nous venons d’évoquer, mais au désir même d’aller jusqu’à la réécriture des faits, comme c’est le cas de Michèle qui « tente de réécrire autrement l’histoire, pour ne plus être la spectatrice de cette désolation ». Plus loin, Mireille constate que « le réel et ses divagations sont étroitement liés ». Quel rôle joue cet aller-retour entre le réel et la subjectivité, et quelle place accordez-vous à cet exercice d’écriture ? Et la fiction dans tout cela ? Quelle part lui avez-vous accordé ?
Dans Juste retenir la vie, j’ai compris que les traumatismes ne disparaissent pas, qu’ils se transmettent. L’écriture de l’exil est un leurre qu’on s’invente pour tromper l’angoisse de la perte. Elle maintient l’illusion des retrouvailles. Plus qu’une consolation, l’écriture de l’exil est une forme de réparation.
C’est dans ce contexte que peut se comprendre ce vers de Baudelaire : « Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste; pars, s’il le faut ». Juste retenir la vie raconte alors ce déchirement entre la réalité et le désir de fuite. L’exil se caractérise dans ce roman par une opposition marquée entre un monde perdu (les petits pois sur le balcon de la maison maternelle, la cuisine de la grand-mère, le rouge à lèvre acheté chez Amo Elias, etc.) et un monde présent (Le temps de l’explosion, la destruction d’une ville, un œil porté comme une boule à la gorge, le roulement des valises, etc.). L’écriture de l’exil est pour moi une reconstitution souvent fantasmée et idéalisée du passé et des souvenirs pour sublimer et réparer un présent placé sous le signe de la perte.
Si le refuge dans le passé est une façon de rentrer à la maison, c’est aussi une façon de résoudre ce qui reste en suspens. Les souvenirs s’apparentent souvent à des parcours de guérison qui passent par le chemin tortueux des plaies qui font mal, pour avoir le courage de renouer avec un Liban heureux.
Arrêtons-nous un instant sur vos personnages, et surtout sur ceux des femmes. Tania, Mireille, Michèle, Myriam illustrent et accompagnent brillamment le fil narratif intense de votre récit. Sauf que vers la fin de votre roman vous dites quelque chose de surprenant (même si on commençait à s’en douter un peu…), en vous interrogeant : « Ces femmes sont-elles plusieurs, sont-elles une seule personne ? » Comment comprendre cette fusion, cette syllepse, même si le terme est ici un peu détourné pour le faire dire la multiplicité très réussie de votre construction diégétique, pour reprendre ici un terme cher à Genette ?
Je suis heureuse de vous lire quand vous citez Gérard Genette. J’ai eu la chance d’assister à ses cours au Collège de France. Mais je ne vous cache pas que je me faisais toute petite devant ce géant qui savait jongler entre l’humilité et le génie. Un jour, un philosophe qui assistait au cours lui avait posé une question et il avait répondu par cette phrase que je n’oublierai jamais : « je ne sais pas, je ferai une recherche et je vous répondrai la semaine prochaine ». Depuis ce jour, je n’aime plus le mot « Je sais », il résume et balaie tous les doutes qui me construisent. Le « Je crois » raconte cette modestie qui est aussi une force.
Pour répondre maintenant à votre question, et vous le savez mieux que moi, on défroisse nos pudeurs quand on écrit. Alors on aime les masques, on les superpose, on joue avec le lecteur parce que l’écriture est un dévoilement qu’on n’assume pas toujours. Tout crie la réalité… même la fiction. Dans le cadre d’une thérapie psychanalytique, le mensonge est aussi révélateur d’une réalité.
Dans Juste retenir la vie, l’explosion va provoquer l’éclatement des femmes. Le Silo va alors jouer le rôle d’un baume. Ses enquêtes feront de lui un trait d’union. Il sera ce pont que chaque femme va traverser pour se retrouver. Elles enjamberont ensemble les franges du tapis de la mère pour raconter peut-être l’histoire d’un même personnage.
« Sommes-nous des miroirs qui renvoient aux différentes facettes de Michèle ? » Cette phrase résume les jeux et enjeux de l’écriture autobiographique.
Le Silo, narrateur et personnage de l’ogre à la fois assassin et moribond, est en quelque sorte porteur de tant de symboles dont il serait intéressant de tenter d’approfondir quelques-uns. D’abord, celui sorti « de la Bible ou d’un roman de Dante ». Que répondre à la question que vous posez vous-même : « Le blé peut-il se transformer en sang ? ». Et surtout, comment interpréter cette double identité de l’amor et de la mort qui coexistent en son énorme bloc de pierre ?
La psychanalyse évoque l’image de la « bonne » et de la « mauvaise » mère. C’est le cas du Silo qui est à la fois placé sous le signe de la mort et de « l’amor ».
Il est d’abord une métaphore d’un pays en lambeaux, et le lecteur assiste à sa lente agonie. Il est le bouc-émissaire, celui qui doit mourir pour que renaissent les morts de l’explosion du Port de Beyrouth. Il devient alors ce symbole à la fois paternel et maternel, celui qui accueille les disparus et qui les cache dans les plis de sa robe en béton.
Avant de parler du vaste sujet de l’exil, penchons-nous sur l’attachement que vos personnages, surtout celui de Michèle, éprouve envers son pays, le Liban. Tout y est : l’enfance, ses couleurs et ses odeurs, la saisonnalité, les interrogations et le réveil au monde, la tristesse et le désespoir du départ imminent et nécessaire. Pardon de vous redemander à reproduire cet exercice, mais serait-il possible de prendre la parole à la place de vos personnages et de nous parler de votre pays que vous chérissez tant ?
Qui mieux que Nadia Tueni pour parler du Liban :
Mon Pays
Mon pays longiligne a des bras de prophète.
Mon pays que limitent la haine et le soleil.
Mon pays où la mer a des pièges d’orfèvre,
que l’on dit villes sous-marines,
que l’on dit miracle ou jardin.
Mon pays où la vie est un pays lointain.
Mon pays est mémoire
d’hommes durs comme la faim,
et de guerres plus anciennes
que les eaux du Jourdain.
Mon pays qui s’éveille,
projette son visage sur le banc de la terre.
Mon pays vulnérable est un oiseau de lune.
Mon pays empalé sur le fer des consciences.
Mon pays en couleur est un grand cerf-volant.
Mon pays où le vent est un nœud de vipères.
Mon pays qui d’un trait refait le paysage.
Il y a une figure tutélaire qui habite merveilleusement les pages de votre roman, celle du père. De lui, vous héritez l’amour des livres, la clé testamentaire de ne plus avoir peur dans la vie, le regret de ne pas avoir pu l’accompagne dans son ultime voyage. Quels sont les mots qui pourrait mieux parler de ce père tant aimé, selon vous ?
Cette question est un exercice périlleux. Comment aborder sans détours et avec pudeur la figure du père ? Je crois qu’il est pour moi l’encre de ce roman, et mon écriture s’en est nourrie. Mais l’encre ne sèche pas… pas encore.
On comprend bien pourquoi l’exil est une réalité si douloureuse. Tous ceux qui avons vécu cela connaissons la souffrance de l’éloignement qu’il engendre. Quel sens prend pour elle le fameux mot de nostalgie ? Comment vivent vos personnages, surtout Michèle, cette situation, et comment se confronte-t-elle à la réalité du pays lorsqu’elle y retourne, ne serait-ce que provisoirement, ce « renforcement de l’ancrage identitaire », comme elle l’appelle ?
Dans Le Voyage d’Alep, Salah Stétié écrit :
« Ici, tout pousse l’homme à partir. Tout l’incite à ne jamais s’attacher.
Cela commence.
Le jour se referme à regret sur l’origine. »
Parler de l’exil fait naître une émotion à « fleur de mots », parce que ce mot, comme la madeleine de Proust, fait ressurgir des images qui ont construit les personnages de ce roman.
Le mot « exil » fait partie des mots qu’elles n’aiment pas. Le [i] dans exil renvoie à quelque chose d’aigu, de pointu, comme le [i] d’une aiguille. Il rappelle le {yiiiiii} des libanais face à une situation surprenante, angoissante, inattendue. Finalement, du français au libanais, les voyelles ne mentent jamais parce que leur sonorité relève du domaine du bouleversement.
Dans Juste retenir la vie, Michèle, Myriam, Tania et Mireille essayent de caresser le mot « exil » pour l’adoucir, pour l’apprivoiser, pour l’ouvrir comme « l’Huitre » de Ponge, pour ne pas voir cette valise posée devant la porte d’entrée quand nous étions enfants, valise dans laquelle nos mères rangeaient précieusement les passeports, l’argent, et leur cuisine, parce qu’on range toujours sa cuisine dans sa valise. La mère de Michèle répétait en égyptien la même phrase : « ma mna3ref haga » (on ne sait rien) qui montrait son impuissance face à ce mot qui la désarmait aussi, parce qu’elle l’avait déjà vécu quand elle avait quitté l’Égypte.
De nombreuses années plus tard, cette valise est maintenant posée devant la porte de leur maison. Elles essayent alors de sublimer ce déracinement par des saveurs qui transmettent des valeurs, en cuisinant par exemple la « molokheyaa » de téta Marie, cette soupe d’origine égyptienne qui rappelle l’odeur des épices de la cuisine de la grand-mère… celle qui est là-bas. On écrit pour retenir cette odeur, on tente alors de redessiner une « matrie » perdue…
Enfin, je me permets de citer en conclusion cette phrase qui en dit long sur la conception qui est la vôtre sur l’acte d’écrire : « Écrire pour comprendre, mais aussi pour pardonner ». Ce n’est pas sur un quelconque exercice de thérapie que je souhaite vous interroger, mais sur votre sentiment intime qui a fait qu’à travers votre roman vous avez peut-être réussi à voir autrement autour de vous la réalité, l’Histoire, l’humanité dans sa beauté et sa souffrance, l’enfant que vous étiez et la femme que vous êtes devenue ?
Paul Eluard écrit : « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. » Et l’écriture fait partie de ces rendez-vous.
Dans le pays des mots, l’exilé est un écorché. Il respecte le silence parce qu’il le parle couramment. Raconter l’exil est alors une démarche fragile, parce qu’on parle de tendresse et de rupture, on est à la « Recherche du temps perdu ». C’est une façon de marcher vers soi. Se connaître d’abord pour reconnaître l’autre. Cette écriture témoigne d’errances, d’épreuves, de renaissances, quand ailleurs ressemble à la maison.
Dans le pays des mots, la mémoire joue un rôle essentiel puisqu’elle permet de réécrire son histoire et celle de son pays. L’exil est forcément lié à la réparation. L’auteur exorcise ce fantasme de mort dû au déracinement. Écrire l’exil permet de faire revivre le monde natal déserté.
Dans le pays des mots, je ne sais pas si on arrête de respirer quand on écrit, je ne sais pas si Marcel Proust a raison quand il dit « Vivre ou écrire, il faut choisir! » Je ne veux pas choisir, l’écriture participe à un travail identitaire que je traverse et qui me traverse.
Propos recueillis par Dan Burcea
Crédits photo pour le Silo, © journal Le Monde
Michèle Sayegh Naja, Juste retenir la vie, Éditions Vérone, 2023, 168 pages, avec des dessins de l’auteure.
Le livre peut être acheté sur commande à l’Institut du Monde arabe de Paris.

