
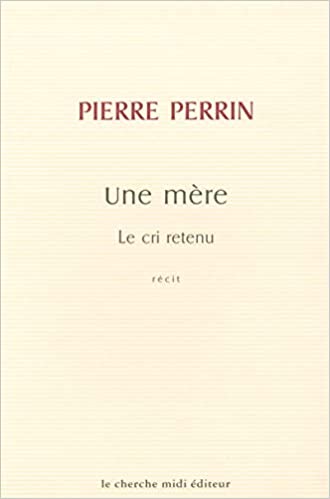 Selon Pierre Perrin, son livre Une mère – Le cri retenu est le fruit d’un silence capable de l’élever jusqu’à la lucarne qui lui permettra de toucher par le jeux de miroirs l’amplitude panoramique où se dérobe devant les yeux assoiffés de sa mémoire la figure de la mère absente. Il pourrait répéter à dessein avec Balzac qu’il n’y a rien de plus complet que le silence, pourtant son voyage reste une descente « dans le puits des années mortes », un effort de Sisyphe souterrain abritant l’écho de la voix dostoïevskienne des Carnets du sous-sol pour combler le gouffre sans fond qu’est devenue l’image de la figure maternelle qu’il tente de ressusciter.
Selon Pierre Perrin, son livre Une mère – Le cri retenu est le fruit d’un silence capable de l’élever jusqu’à la lucarne qui lui permettra de toucher par le jeux de miroirs l’amplitude panoramique où se dérobe devant les yeux assoiffés de sa mémoire la figure de la mère absente. Il pourrait répéter à dessein avec Balzac qu’il n’y a rien de plus complet que le silence, pourtant son voyage reste une descente « dans le puits des années mortes », un effort de Sisyphe souterrain abritant l’écho de la voix dostoïevskienne des Carnets du sous-sol pour combler le gouffre sans fond qu’est devenue l’image de la figure maternelle qu’il tente de ressusciter.
En effet, à regarder attentivement son sous-titre, il est question dans ce dense récit d’autre chose que de silence et de solitude. Ce cri retenu n’est en réalité qu’une secrète décoction de « paroles muettes qui attendent des lèvres pour les dire », remède contre le manque d’amour, qui ne cesse de ronger le souvenir amenuisant d’une mère « les mains sans cesse occupées », ne sachant jamais prendre dans ses bras l’enfant qui a tant besoin de se blottir contre ce cœur maternel protecteur, mais, hélas, désespérément défaillant.
Une question se pose quant au fil conducteur de ce récit qui se refuse de toutes ses forces à toute animosité ou réprimande. En ce sens, le récit de Pierre Perrin est avant tout une tentative douloureuse de restauration – comme on restaure un tableau de maître – d’un portrait maternel qu’il trouve, après tant d’années, abîmé, mal crayonné par mégarde ou par indifférence, le plus souvent par une perspective faussée qui ne demande qu’à regagner sa lumière abîmée.
Dès lors, une multitude de questionnements surgissent de ces pages écrites à l’encre des regrets mesurant bien leur impuissance devant la tombe où repose la mère. Il y a d’abord, cette supplication : « Maman permets-moi de te comprendre, par-delà ta mort ». Et il y a ensuite, comme une pièce essentielle apportée comme preuve au tribunal de ses remords cette photo prise par lui-même, la seule gardée, de la beauté timide de cette femme « d’une élégance sans manières, la tête penchée, les mains croisées, debout sous le soleil derrière la maison, des tulipes au rebord de la fenêtre ». Cette photo, « prise à la dérobée » est pour lui d’une beauté et d’une force sans pareil. Sa signature scelle davantage le frisson qui traverse l’auteur-photographe : « C’était une joie si rare qu’elle m’accordait, mais je n’ai pas su la faire sourire ».
Cette confidence en réclamera tout au long des pages suivantes un autre credo qui ramènera le discours narratif vers son thème central, celui de la capacité de l’écriture à faire tomber les murs de l’oubli et à conjurer l’absence oppressante de la tendresse maternelle condamnée à « rester sans objet ». « Je voudrais – écrit-il – qu’à défaut de vivre tu te sentes libre dans ce livre, plus que sans doute tu ne l’as jamais été. C’est ma façon de te désincarcérer. » Les mots deviennent désormais des trompettes de Jéricho censées faire tomber les murs du « silence inexpugnable » renvoyé de l’au-delà et devant lequel rien, même pas la possible résurrection à travers le rôle de personnage de fiction, n’arriverait à la rendre à la vie. « Je te parle, mère : je te secoue de tous mes mots ; j’essaie de te relever, de te serrer dans mes bras ; ton souvenir reste froid – peu importe le mien.»
Qu’en est-il de l’écrivain qui manie ses mots comme des coups de semonce dans la galerie sombre de sa mémoire, là où « le passé suppure ou bien pousse des champignons » ? Faut-il prendre cette image pour ce qu’elle dit de plus cruel et imaginer l’écrivain penché sur la feuille blanche comme un scaphandre parti « à la recherche d’une morte qu’il faut écouter, soutenir et aimer comme si elle était vivante » ? La réponse viendra une trentaine de pages plus loin, après une longue tentative de réflexion sur l’existence comme durée mémorielle : « Je crois vivante quelque part en moi ma mère ; je crois utile à d’autres notre devoir de mémoire ; et je crois que la raison est saine qui commande à ces intermittences dans ma recherche ».
C’est vers ce territoire que Pierre Perrin nous invite, pour goûter avec lui à l’absinthe de tous ses regrets d’un amour maternel manquant et d’une affection filiale prenant souvent l’habit d’une révolte vengeresse de sa souffrance inavouable et condamnée à rester incomprise, malgré l’amour paternel, lui-même consommé sous la brève existence de ce père souffrant.
« C’est vain de pleurer par contumace, à remonter le temps » – nous dit l’auteur.
Est-ce un aveu de rejeter toute possibilité de sortir du bannissement du réel, y compris de celui qui conduit l’être humain à sa détérioration ?
Tard, à la fin du récit, surgit le mot que l’on attendait pour ouvrir timidement les fenêtres de la fiction et nous y inviter à en sentir la saveur. Ce mot tant attendu, ce mot patient qui guérit tout, y compris la pudeur de l’écrivain, qui abolit la puissance dévastatrice du temps et qui sauve de l’oubli l’image maternelle n’est autre que celui de l’éternité.
N’est-pas en cela que l’auteur reconnait enfin l’existence inavouée de l’âme, tant mise sous silence tout au long de son récit ? Le fragment est si beau qu’il réclame ici le droit à être cité en entier :
« Je me demande aujourd’hui, si par hasard elle affleurait en moi, quel mot, quel geste effaceraient la herse des malheurs. Je voudrais tant la voir revenir. Je voudrais l’impossible, qu’elle s’asseye en face de moi : je lui servirais du Quart-de-chaume ou du Bonnezeaux dans un cristal gravé à son prénom ; et nous fortifierons, par-dessus nos deux bras croisés, un large et long sourire qui franchirait peut-être, à volonté et dans les deux sens, l’éternité ».
Tout est enfin dit. Ce voyage qui se fait désormais dans les deux sens permet enfin un dialogue dont on n’ose pas troubler l’intimité.
Le livre se termine avec cette promesse enfin consentie : « Pour la première fois, je crois que l’été n’est pas près de s’effacer ».
Dan Burcea
Photo de Pierre Perrin : © Rio Di Maria
Pierre Perrin, Une mère – Le cri retenu, Le Cherche Midi Editeur, 2001, 153 pages.

