
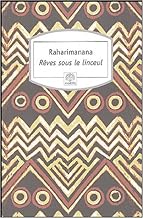 Jean-Luc Raharimanana vient de recevoir le Prix International de Littérature Francophone Benjamin Fondane 2023 des mains de Madame l’Ambassadrice de Roumanie en France Ioana Bivolaru, lors d’une cérémonie organisée ce 7 décembre dans les ors du Palais de Béhague qui abrite l’Ambassade de Roumanie à Paris. Étaient présentes des personnalités culturelles roumaines et françaises et des responsables de la Francophonie.
Jean-Luc Raharimanana vient de recevoir le Prix International de Littérature Francophone Benjamin Fondane 2023 des mains de Madame l’Ambassadrice de Roumanie en France Ioana Bivolaru, lors d’une cérémonie organisée ce 7 décembre dans les ors du Palais de Béhague qui abrite l’Ambassade de Roumanie à Paris. Étaient présentes des personnalités culturelles roumaines et françaises et des responsables de la Francophonie.
Depuis 2006, ce prix est décerné par l’Institut culturel roumain de Paris et l’Ambassade de Roumanie en France sous le patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie à des auteurs francophones mais qui n’ont pas la nationalité française.
Vous venez de recevoir le prestigieux Prix Fondane pour l’ensemble de votre œuvre. Que représente pour vous cette récompense et comment avez-vous vécu ce moment ?
C’est un prix inattendu pour moi car je n’ai rien demandé. Être récompensé pour l’ensemble de son œuvre amène forcément à regarder en arrière pour prendre conscience de ce qu’on a déjà accompli, et ce recul me fait dire qu’effectivement, il y a eu un chemin, il y a eu du travail, il y a eu des moments pas toujours évidents, il y a eu de la joie, de la peine, il y a une, voire plusieurs vies. Comment j’ai vécu ce moment ? Par l’étonnement bien sûr, et par une certaine reconnaissance vis-à-vis de l’institut culturel roumain et des jurés du Prix. J’ai surtout redécouvert l’œuvre de Benjamin Fondane, son influence considérable sur l’histoire de la pensée et de la poésie roumaine et française. Et sa vie bien évidemment, la condition juive qu’il incarnait et qu’il écrivait. J’ai été très ému d’avoir été associé à une telle figure, et j’espère le mériter maintenant et pour la suite. J’ai été heureux aussi pour la littérature malgache, de représenter l’île, mais aussi l’Océan Indien, car c’est rare qu’on braque les projecteurs sur cette partie du monde. J’espère, par l’occasion, faire découvrir un peu plus les écrits qui viennent de cette zone, car je ne suis pas seul, je ne viens pas seul. Je viens avec mes références, je viens avec mes influences, je viens avec les autres écritures et expressions qui m’accompagnent. Ainsi dans mon discours lors de la remise du prix, j’ai cité Jean Joseph Rabearivelo, le plus connu des poètes malgaches, mais je peux vous citer aussi d’autres illustres inconnus comme Andry Andraina, E.D.Andriamalala, des jeunes qui viennent de publier comme Marie Ranjanoro ou d’autres qui n’ont rien publié encore mais qui n’y sont plus très loin, Elie Ramanankavana…
Dans l’invitation que vous avez lancée pour cette occasion, vous avez écrit : « Pour la paix dans le monde, pour le partage et la tolérance, toujours, et écrire encore, créer. » Quelle place accordez-vous à la création littéraire comme moteur de ce désir de paix et ce besoin de tolérance que vous évoquez ?
Écrire suppose s’intéresser aux autres, partager les cultures. Créer, c’est jeter un regard en soi, mais aussi chez l’autre, et bâtir des passerelles, vers le nouveau, vers l’inconnu, vers le rêve et l’enchantement. C’est tout le contraire de la guerre qui est de détruire l’autre pour soi-disant construire, se défendre, etc. La guerre, c’est la fin de la conversation, la fin des échanges, c’est entretenir le cycle de la violence. Ecrire – et lire donc, dépasse en principe l’enfermement. Bien sûr, il y a des écrits qui exacerbent les identités et poussent à l’exclusion de l’autre, mais je parle ici de littérature, je parle de la mise en lumière de l’humain, de l’exploration de ses ombres, du fouillement de l’inextricable qu’il est. Ecrire, lire, rend tolérant. Car on fait un pas de côté pour laisser la place à l’autre, pour qu’il s’exprime, pour qu’il soit entendu. Car on fait un pas en avant pour rentrer dans la place préparée par l’autre pour qu’on prenne aussi la parole et lui dire qui on est, comment on pense, comment on rêve, comment on vit. Et on fait des pas ensemble pour continuer la conversation. La Paix, c’est refouler petit à petit la méconnaissance, et accepter la présence de celui qui est différent.
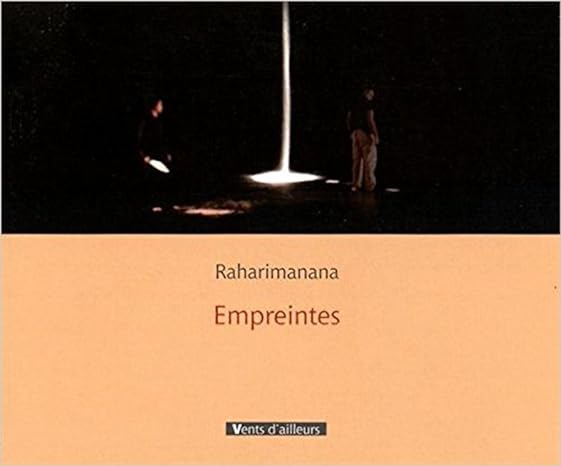 Dans cette ambiance solennelle, l’ombre tutélaire de Benjamin Fondane était sans doute présente dans ces lieux. Comment résonne aujourd’hui pour l’humaniste que vous êtes ce cri encore d’actualité dans nos consciences du poète roumain : « Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes/ nourri de pain, de rêve, de désespoir » ? Je ne peux pas m’empêcher de citer en écho ces vers qui vous appartiennent et qui expriment à une distance de plus de trois quarts de siècle la même interrogation sur l’essence de la vie : Mon cœur bat./Depuis longtemps, il battait la mesure de ma vie./Comme un son de tam-tam qui résonne dans les savanes et qui trahit la présence/d’une vie.
Dans cette ambiance solennelle, l’ombre tutélaire de Benjamin Fondane était sans doute présente dans ces lieux. Comment résonne aujourd’hui pour l’humaniste que vous êtes ce cri encore d’actualité dans nos consciences du poète roumain : « Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes/ nourri de pain, de rêve, de désespoir » ? Je ne peux pas m’empêcher de citer en écho ces vers qui vous appartiennent et qui expriment à une distance de plus de trois quarts de siècle la même interrogation sur l’essence de la vie : Mon cœur bat./Depuis longtemps, il battait la mesure de ma vie./Comme un son de tam-tam qui résonne dans les savanes et qui trahit la présence/d’une vie.
D’autres passages sur le cri peuvent être cités aussi. Oui, de rêve et de désespoir. Quand je vois l’état de mon pays, parmi les plus pauvres au monde, je désespère, mais je rêve aussi, qu’il ferait beau après l’orage. C’est aussi simple, le rêve naît dans les moments sombres. On doit y croire. Ce n’est pas seulement Benjamin Fondane, mais les autres poètes et témoins qui ont exploré les abysses, j’ai conclu après un entretien avec un vieil homme qui a vécu les massacres de 1947, que « la victime a à éduquer celui qui l’a avili », et je crois que Benjamin Fondane n’avait eu de cesse à transmettre la lumière. Ce qui est désespérant, « Le plus jamais ça », sous des formes dites insidieuses, se renouvelle d’année en année, le Rwanda, le Burundi, le Yemen, tous ces pays pauvres et en guerre, où on n’a pas besoin d’un bourreau reconnaissable pour perpétrer l’innommable. Et pour moi venant d’un pays du sud, je constate que c’est plus facile de nous exclure de ce « plus jamais ça », en qualifiant juste l’indicible en « conflits tribaux », en « haines séculaires », etc., mais non, ce n’est pas histoire de comparaison, mais de regarder notre inhumanité en face, que sommes-nous capables de faire, combien sommes-nous enclins à fermer les yeux, à clore la bouche, à détourner notre raison et à annihiler notre sensibilité ? Que dire de Gaza maintenant, précisément maintenant ? Que dire du véto des Etats-Unis pour un cessez-le-feu ? Que dire des gouvernants puissants qui se regardent sans rien décider – tout au moins au grand jour. Pourquoi les bombes ont acquis des valeurs légitimes (et pratiquement humanistes) de défense de civilisation ? Pourquoi le Capital qui tue des millions de personnes continue à être défendu comme si la survie de l’humanité dépend de lui ? Pourquoi invente-t-on une raison à l’inhumanité ?
Je fais miens ces vers dans Ulysse :
« Je ne peux pas fermer les yeux,
Je dois crier toujours jusqu’à la fin du monde :
Il ne faut pas dormir jusqu’à la fin du monde
– Je ne suis qu’un témoin. »
 Ce prix récompense, comme nous l’avons dit, l’ensemble de votre œuvre littéraire. Quelle place occupe la poésie dans cet ensemble d’expression littéraire ? Que vous apporte de plus ce genre littéraire dont on dit qu’il est le plus noble de tous ?
Ce prix récompense, comme nous l’avons dit, l’ensemble de votre œuvre littéraire. Quelle place occupe la poésie dans cet ensemble d’expression littéraire ? Que vous apporte de plus ce genre littéraire dont on dit qu’il est le plus noble de tous ?
Elle est centrale, car c’est elle qui interroge le plus le langage, c’est elle que je modèle et qui me modèle. Mes autres expressions sont juste ses extensions. La poésie me sauve du désespoir de la lucidité car elle crée du beau, et elle se partage, elle se transmet. Le partage et la transmission permet de répandre la lumière, et ainsi de durer un peu plus. C’est un voyage, c’est une utopie. Je pars toujours d’une idée poétique avant d’entamer une œuvre, même si je sais très vite s’il s’agit d’un roman ou d’une pièce de théâtre. Le point de départ, c’est toujours la vision, une vision qui cherche à illuminer, même si très souvent je navigue dans les ténèbres. La poésie guérit, rend unique la voix, et provoque une liberté et une jouissance défiant les oppressions de toutes sortes. J’insère de la poésie dans le cœur même de mes phrases, même s’il s’agit d’un roman ou d’une pièce dramatique, dans les paysages, dans les liens avec la Nature. Tout est possible avec la poésie.
Vos romans et pièces de théâtre ont également été primés. Aussi, il faut rendre hommage à cette partie importante de votre travail d’écrivain. Permettez-moi une question d’ordre général. Peut-on parler d’une thématique commune, sans exclure bien entendu des variations nécessaires, qui traverse ces œuvres ? Expriment-elles un credo littéraire qui vous est cher ?
Je pense que le chaos sans écho du monde hante mes travaux de théâtre. J’ai cette impression persistante que certains chaos n’ont pas lieu d’être entendus car l’ordre du monde repose là-dessus, je parle des pays qu’on laisse délibérément pauvres pour que le système mondial puisse continuer à vivre. Je le dis dans ma pièce Rano, rano : « ne me demandez pas mes origines, je fouillerai dans les poubelles de l’humanité
(…)
Car mes origines parlent des scandales des ans et des saletés de l’Histoire
Des massacres et des esclavages,
Des colonisations et autres bonnes occupations civilisées
Je n’y peux rien
A cette question, je ne peux vous renvoyer que dans les poubelles de l’humanité ».
C’est porter ces voix qui me préoccupent dans le théâtre, c’est représenter la tragédie que nous traversons maintenant mais qu’on feint de ne pas voir. Mais c’est aussi réveiller les lumières dans le spectateur, raviver la fleur intérieure que nous avons tous, je veux ça, qu’on sorte de mes pièces, bouleversé par la tragédie mais exalté par la force réparatrice.
Quant aux romans, les thèmes sont plus libres, l’aventure stylistique s’y épanouit bien plus aussi, et la joie de narrer emplit en profondeur ces livres, de « Nour, 1947 » à « Revenir », en passant par « Za ». J’aime raconter, j’aime tenir en haleine, j’aime propulser les gens dans un monde magique où ils se perdent et sont obligés de creuser leurs propres sillons pour s’en sortir. Mon prochain roman, à paraître en 2024 aux éditions Rivage, dont je ne peux dévoiler encore le titre, va complètement dans ce sens : une ode à la narration puisqu’il s’agit de reformuler les mythes et les contes malgaches.
Vous avez succédé à l’écrivain algérien Habib Tengour, lui aussi un auteur prolifique, touchant à tous les genres littéraires. Quel conseil donneriez-vous à la jeune génération d’écrivains francophones afin qu’ils puissent rendre compte au mieux du monde et des temps que nous vivons ?
De lire, de faire attention à l’orgueil du sachant, de travailler, travailler sans relâche, de ne pas se laisser piéger par la parole trop vite adoubée (ou critiquée) – l’effet réseaux sociaux, mais tout simplement leur dire aussi qu’il n’y a qu’eux qui peuvent dire leur monde, leur époque, que leur voix compte, de ne pas se laisser entraîner par l’ivresse de la langue française, mais que derrière cette langue, il y en a d’autres aussi, qui ouvrent à tant d’inconnu et à tant d’infini. La poésie ne meurt jamais. On croit parfois qu’elle meurt, mais ce n’est pas vrai, il faut faire confiance à la langue qui vient fouiller dans nos propres bouches des mots nouveaux.
Propos recueillis par Dan Burcea

