
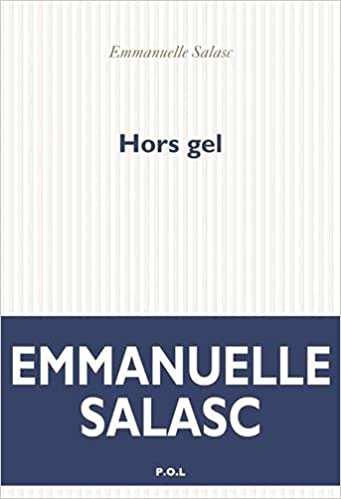 Emmanuelle Salasc publie Hors gel aux Éditions P.O.L., roman d’anticipation dont l’action se déroule en 2056. Il s’agit du 12e livre publié par cette auteure connue sous le pseudonyme d’Emmanuelle Pagano. Si, thématiquement, ce nouvel opus s’inscrit dans la lignée des récits aquatiques de la Trilogie des rives, cette fois la transparence et les clapotis des rivières sont remplacés par la menace sourde des eaux prisonnières sous l’emprise d’un glacier qui risquent à tout moment d’ensevelir dans une coulée mortelle la vallée portant encore le souvenir de la catastrophe produite un siècle et demi auparavant. C’est l’occasion pour Emmanuelle Salasc de remettre au centre de son univers narratif le thème de la peur devenue cette fois « une anxiété, le plus souvent diffuse, par moment plus aiguë : de l’angoisse pure ».
Emmanuelle Salasc publie Hors gel aux Éditions P.O.L., roman d’anticipation dont l’action se déroule en 2056. Il s’agit du 12e livre publié par cette auteure connue sous le pseudonyme d’Emmanuelle Pagano. Si, thématiquement, ce nouvel opus s’inscrit dans la lignée des récits aquatiques de la Trilogie des rives, cette fois la transparence et les clapotis des rivières sont remplacés par la menace sourde des eaux prisonnières sous l’emprise d’un glacier qui risquent à tout moment d’ensevelir dans une coulée mortelle la vallée portant encore le souvenir de la catastrophe produite un siècle et demi auparavant. C’est l’occasion pour Emmanuelle Salasc de remettre au centre de son univers narratif le thème de la peur devenue cette fois « une anxiété, le plus souvent diffuse, par moment plus aiguë : de l’angoisse pure ».
On lit votre roman comme si on escaladait les deux versants d’une montagne. Il y a d’un côté le monde réel et de l’autre, la fiction. Quels sont les éléments réels de la cartographie dont parle votre récit où on retrouve une montagne, un glacier, une vallée et une grange foraine ? S’agit-il d’une entité territoriale en soi, unitaire, ou plutôt d’une recomposition géographique romanesque ?
Il s’agit d’une recomposition romanesque, comme je l’avais déjà fait dans Les Adolescents troglodytes, où je décrivais un plateau d’altitude composé, en autres, du Vercors, où j’ai vécu 7 ans, et du plateau ardéchois, où je vis depuis une quinzaine d’années. Ici, le récit s’inspire en partie de la catastrophe de Saint-Gervais-les-Bains, survenue en juillet 1892 dans le val Montjoie, en Haute-Savoie, il y a donc un peu de cette vallée alpine, mais la grange foraine et les hautes estives des « Mauvaises Heures » viennent du val d’Azun, dans les Hautes-Pyrénées.
Qu’en est-il de ce glacier ? De quoi s’agit-il et quelle est sa vraie histoire ?
Le glacier est inspiré de celui de Tête Rousse, dont la rupture d’une poche d’eau intraglacière a provoqué la catastrophe dont je parle ci-dessus, et qui avait emporté pâtures, terres, villages et hameaux, jusqu’aux thermes, construits tout au fond du vallon, faisant environ 175 morts… Depuis les années 2010, alors qu’on croyait le glacier désormais sans risque, une nouvelle poche d’eau a été détectée : on la purge régulièrement, pour éviter une nouvelle catastrophe, et, parallèlement, on a mis en place un contrôle du glacier, ainsi que des mesures d’évacuation d’urgence en cas de menace imminente (la vallée étant beaucoup plus habitée aujourd’hui, il pourrait y avoir plusieurs milliers de morts si la poche venait à rompre). Ce petit glacier à première vue inoffensif est aujourd’hui un des glaciers les plus surveillés au monde. J’ai enquêté sur la catastrophe de juillet 1892, sur le danger actuel, avant de transposer le récit dans une zone de montagne non située géographiquement, et en transposant ce récit dans une trentaine d’années.
Si l’on se place à proximité de Lucie, votre narratrice, on constate rapidement que son centre de vie qui est en même temps le centre de l’action de votre roman se situe à une hauteur idéale pour que son regard puisse embrasser le paysage d’en haut de la montagne au plus bas de la vallée. Quelle est cette hauteur ? N’est-elle pas celle à laquelle vous vivez vous-même et avez vos habitudes ?
Lucie vit approximativement à 1500 mètres d’altitude. Pour bien comprendre, je vais tenter de résumer la situation au commencement du livre : Dans une vallée d’altitude, pendant l’été 2056, une sirène sonne, réactivant la peur ancienne de la catastrophe naturelle. L’inquiétude prend sa source en amont, dans les entrailles du glacier dominant la vallée. Peu de temps auparavant, Clémence a appelé sa sœur jumelle, Lucie, à qui elle a demandé de la cacher (elle prétend être en fuite), dans la grange isolée qu’elle habite, à mi-hauteur, au-dessus du village, juste en dessous des estives et du glacier. C’est cet entre-deux qui m’intéressait : il me fallait « coincer » Lucie et sa sœur Clémence entre le bas et le haut, il me fallait les faire hésiter entre la menace du glacier (la peur d’en haut, celle de la poche d’eau sous pression), et la menace de la vie sociale, de la vie au grand jour (la peur d’en bas, celle du réseau et de l’homme que semble redouter Clémence). Je voulais les placer entre deux risques. Par ailleurs, Clémence et Lucie sont jumelles, j’ai donc appuyé cette gémellité en les faisant évoluer dans un endroit resserré entre deux pôles inverses et semblables, le haut et le bas, entre les deux menaces, entre les estives hautes et les bergeries d’hivernage (Lucie habite précisément une bergerie de mi-estive, c’est-à-dire de saison intermédiaire, printemps, automne), entre le silence et le bruit, entre l’eau d’en haut (la poche sous pression du glacier) et l’eau d’en bas (l’eau bienfaisante des thermes).
Pour ma part, je vis à 1300 m, mais j’habite sur un plateau, tandis que Lucie habite la pente, et ça change beaucoup de choses, nous ne nous confrontons pas aux mêmes hostilités… Je ne suis pas confrontée aux risques d’écroulements, d’avalanches ou de rupture de poche d’eau intraglaciaire mais aux vents (en particulier à la Burle, le blizzard d’ici), aux congères et à la désorientation qu’elles induisent. C’est pour des raisons médicales que j’ai été obligée, à un moment de ma vie, d’habiter au-dessus de mille mètres, et puis j’ai senti que c’était mon altitude, et même mon minimum d’altitude, comme un seuil en deçà duquel je me sens moins bien…
Une question surgit à partir de tous ces détails. Comment avez-vous réussi cette reconstitution des lieux, ce monde recrée ? Quel a été votre travail de documentation, et de combien de temps avez-vous eu besoin pour cela ? Et pour l’écriture du roman ? Vous avez déclaré qu’il a connu un quarantaine de versions…
J’ai pris des notes pendant une dizaine d’années, et j’ai écrit pendant 3/4 ans, avec une quarantaine de versions, oui, contre une vingtaine habituellement… C’est dans la phase d’écriture qu’il faut rassembler et intégrer toutes les notes, ce n’est pas le moment que je préfère, le moment que je préfère, c’est la phase de recherche. Ces recherches sur le glacier de Tête Rousse, sur les laves torrentielles, le monde paysan, les nouvelles avancées technologiques soi-disant « vertes », font suite à celles que j’avais déjà entreprises par le passé. Ce livre succède, comme vous l’avez précisé à la « Trilogie des rives » qui interrogeait déjà la relation de l’eau et de l’homme, en parallèle d’histoires familiales plus ou moins complexes et tragiques. Dans ces trois romans, je m’étais penchée sur le paysage, c’est-à-dire sur la nature façonnée par l’homme, examinant au plus près les traces que cet homme laisse sur la terre : ces traces me touchent beaucoup, par leur superbe, leur ténacité, leur épouvante parfois, leur modestie. Cette attention particulière, je l’ai poursuivie dans Hors gel, en imaginant un roman de légère anticipation, dans une famille de paysans et dans un pays gouverné par les écologistes, où la nature, et plus spécifiquement la montagne, après des années de consommation pendant lesquelles elle était devenue un produit, est désormais portée aux nues, déifiée, ultra protégée, et, en apparence, contrôlée (en apparence seulement).
Toujours dans ce chapitre du réel, on note dans votre récit une ramification en trois temps narratifs : le temps de la narration, 2056, celui de 2010-2020 et celui d’il y a 150 ans. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette construction temporelle ?
La catastrophe du glacier s’est produite à la fin du 19ème siècle, et la menace s’est réactivée dans les années 10, années dans lesquelles je voulais que mes personnages soient enfants. Par ailleurs, j’avais besoin que Clémence disparaisse pendant deux ou trois décennies, pour que Lucie, sa sœur, puisse essayer d’avoir une vie (en vain). Il me fallait donc les retrouver quand cette vie est sur le déclin (tout du moins au niveau de la santé et de la possibilité, révolue, d’avoir des enfants), donc vers la cinquantaine. Et je me suis retrouvée à devoir écrire avec un présent anticipé… Au début, je me disais que c’était impossible, j’avais donc décidé de tricher avec les dates du glacier, mais il m’aurait fallu faire l’impasse sur les moyens de surveillance et de purge actuels (notamment cette fabuleuse pelle araignée et l’incroyable échographie du glacier), ce qui me semblait dommage, alors je me suis lancée dans l’anticipation. Finalement, elle m’a permis de cerner la vie de mes personnages d’une troisième menace, celle d’un climat et d’une nature à l’agonie, vainement protégés par un gouvernement faussement écologiste, quasi totalitaire, et très contraignant, menaçant lui aussi. Enfin, vers la fin de mon travail d’écriture, il y a eu la pandémie, que j’ai donc intégrée, mais dans une perspective plus large d’effondrement climatique et politique.
Nombreux sont les aspects symboliques et fictionnels sur lesquels je souhaiterais vous interroger. Vous créez pour ainsi dire un monde polysémique autour de votre thème principal qui est celui de la peur. Dans ce contexte, quel lien y a-t-il entre vos deux personnages principaux Lucie et Clémence et les paysages où elles vivent et qui les a construites ? Est-ce que, par exemple, la colère de Clémence, sa peur récurrente sur laquelle nous reviendrons, ont un lien avec la menace permanente du glacier ? Votre narratrice parle d’un lien entre la dislocation de la terre et la dislocation intime de ceux qui y vivent.
Oui, complètement, la menace du glacier, et plus largement celle que l’effondrement écologique, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les contenir (contrôle, surveillance et mesures constantes, purges d cela poche d’eau, état totalitaire, etc.), répondent à la folie de Clémence, à ses débordements. La montagne en particulier agit comme sur caisse de résonance des peurs éprouvées par les deux sœurs.
Hors gel est un roman sous-tendu par ces deux peurs : une peur ancestrale et collective, celle de la lave torrentielle que pourrait provoquer la rupture de la poche d’eau intra-glacière, sous pression, et une peur plus intime, familiale, celle d’une femme vis-à-vis de sa sœur, tout aussi violente que fragile, revenue auprès d’elle après trois décennies de disparition. La peur de sa sœur est aussi ancrée depuis longtemps dans la mémoire de Lucie : Clémence, dont l’extrême sensibilité en a fait une fille, puis une femme « invivable » – et pourtant pleine de vie – hante sa sœur. Violente, toxicomane, délinquante, fugueuse, asociale, mal aimée, Lucie n’a de cesse d’essayer de comprendre ce sœur qui la malmène et l’obsède, même disparue.
La peur, sentiment premier, universel et totalitaire, spectaculaire dans la montagne (comme l’a si bien décrit Ramuz*), lorsqu’elle s’incarne sous la forme puissante et rapide de la lave torrentielle, est aussi quotidienne, lorsqu’elle mine, insidieusement et lentement, le corps et l’esprit de Lucie. Elle conditionne nos vies, s’insinue partout, contaminant nos pensées, nos actes, nos gestes, nos liens fraternels, familiaux, sociaux, jusqu’à notre personnalité, notre raison, et bien entendu, notre paysage.
* Dans La Grande peur dans la montagne mais aussi dans Derborence.
Une autre coordonnée est celle qui relie cette menace, ces débordements à la volonté d’un contrôle total. La société écologique où se passe l’action connaît une multitude d’éléments qui renvoient vers cette tentation de contrôle permanent et total. C’est « un libéralisme [qui] a su se faire plus discret, plus présentable » dit Lucie, votre narratrice. Pourquoi ce choix de société dans votre roman ? Qu’y a-t-il d’anticipatif ou s’agit-il de quelque chose du déjà acquis dans ce monde que vous décrivez ?
J’ai expliqué plus haut pourquoi le choix de cette anticipation, et si j’ai mis en place une telle politique écologique, c’est effectivement parce qu’il me semble hautement probable que l’urgence nous fasse faire un peu n’importe quoi, c’est-à-dire semblant. Je suis persuadée que l’écologie ne sert à rien, aussi radicale soit-elle, sans changement majeur de notre système économique, et, malheureusement, on est loin d’en prendre le chemin… donc effectivement je crois qu’on en est déjà là. D’ailleurs je n’ai rien inventé, tout ce dont je parle existe déjà, même si ce n’est pas encore opérationnel ou pas encore généralisé.
La gémellité est le socle sur lequel vous construisez vos personnages centraux. Que pouvez-vous nous dire de cette relation forte, douloureuse, bouleversante entre Lucie et Clémence, ces deux êtres tiraillés entre une séparation impossible et une cohabitation douloureuse ?
La gémellité est une question qui me travaille depuis longtemps, et que j’ai déjà abordée dans Saufs riverains. Je n’ai pas de sœur jumelle mais j’ai longtemps été terrorisée à l’idée non pas d’être jumelle, mais d’avoir des jumeaux, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu’il en soit, j’avais besoin d’un lien très fort entre ses deux sœurs, une proximité irréconciliable, et une place incertaine pour l’une d’entre elle : il fallait que l’une d’elle soit en trop, d’une certaine façon. La gémellité me permettait d’installer ça, comme elle me permettait, ainsi que je l’ai dit plus haut, d’installer un paysage de contraires et d’échos.
Est-ce que le besoin d’être aimé est tout aussi central dans votre livre ? Quelle est la place du lien parents-enfants dans ce contexte ?
Il me semble que l’amour (besoin d’être aimé et d’aimer) est central dans tout, c’est l’unique réponse que l’être humain a trouvé pour répondre à la peur, et qui, est, selon moi, la seule véritable émotion, la première en tout cas. L’amour (filial, amical, amoureux) permet de relier les hommes entre eux, or l’homme est un animal social. Clémence a ceci de particulier que sa demande d’amour est démesurée (peut-être parce que sa peur est aussi démesurée), insatiable. Ses parents ne peuvent donc pas y répondre : plus ils l’aiment, et plus elle demande à être aimée. La mère de Lucie et Clémence, en particulier, joue un rôle central dans cette histoire. Sénile, elle est là sans être là, et a, semble-t-il, oublié qu’elle a une deuxième fille, née quelques heures après la première. Pourtant, pendant l’enfance et l’adolescence des jumelles, elle a tout tenté pour essayer d’endiguer sa violence et sa souffrance, en utilisant tout un arsenal de « protection » : aides sociales et sanitaires, police, justice. En vain. C’est peut-être à cause de cet échec, à cause de l’impossibilité de répondre à la demande insatiable d’amour de Clémence, qu’elle l’a apparemment « oubliée »…
Vous créez, à travers Clémence – pourtant un prénom de douceur et d’indulgence, mais peut-être que ce choix n’est pas dû au hasard, vous nous direz – un personnage d’une incroyable force tragique, douloureuse, qui contredit ce que Lucie, sa sœur, tente de nommer normalité. Aucun propos psychiatrique concernant sa personnalité dans le roman. Qui est-elle finalement ?
Le prénom Clémence a évidemment été choisie par antinomie… encore que la miséricorde est peut-être quelque chose qu’elle porte, au final, tout comme sa demande d’amour sans fin, sans fond, est peut-être une invitation au pardon. Ses parents, ainsi que la société « normale » – qui selon moi est tout aussi incarnée par la mère que par Lucie – ont peut-être quelque chose à se faire pardonner… Je me suis demandée, en écrivant cette histoire, si ce n’était pas, précisément, l’injonction (sociale, institutionnelle, familiale) à la normalité, qui demandait « pardon » à Clémence, et à tout ce qui déborde (l’eau, la nature en général, la folie)… Pour la petite histoire, je me suis longtemps entendue dire que j’étais « originale » et ce n’était pas un compliment… Enfin Clémence est, pour Lucie, celle qui porte en elle une grâce (comme les bouquetins) qui me semble être contenue dans l’idée de miséricorde.
Il n’était pas question de poser un diagnostic de maladie psychique sur les débordements de Clémence, même si la réponse apportée par ses parents et la société est celle du soin psychiatrique. Si je ne me suis pas aventurée sur ce terrain-là, c’est aussi parce que dans ce récit, le comportement de Clémence est indissociable de l’environnement qui l’entoure, elle délire la montagne, elle délire la forêt, la pente, elle délire le monde dans lequel elle évolue.
Toujours pour rester dans la polysémie de l’eau que vous affectionnez tant, il y a une métaphore très puissante sur laquelle je souhaiterais avoir votre explication. Il s’agit de l’image du bol d’eau sale, symbole du bol de peur. Il a dans votre récit une double signification : celle de la peur intime, familiale, et celle plus générale des habitants de la vallée. « Ne pas renverser ce bol, jamais, ne l’agiter », dit Lucie. Comment décrire cette métaphore ?
Oui, comme je l’expliquais plus haut, les peurs intime et collective sont liées, et elles sont liées par la géographie (voire la géologie) et la politique (au sens large). Par ailleurs, elles s’incarnent, et se logent, au sens propre, dans le ventre (celui du glacier, celui de Lucie) où se trouvent une poche, un bol, d’eau comme de peur… Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une métaphore. Ce bol d’eau (parfois sale, parfois pure, selon les moments et les situations) que je décris comme porté dans le ventre, est quelque chose que je ressens vraiment, physiquement, quand je l’écris. J’espère que les lecteurs, eux aussi, le ressentent. Visualiser ce bol permet d’ajuster notre centre de gravité lorsqu’on grimpe, mais il est aussi une alarme lorsqu’on a peur : il s’agit de rester calme en essayant, mentalement, de garder l’eau étale…
L’attente fait partie du lot quotidien du monde paysan de la vallée. Mais il y a d’autres menaces induites par les suspicions des écologistes, les végans ou autres type de surveillance. « Désormais minoritaires même à la campagne, les paysans se sentaient acculés par la pression sociale et vivaient sous la terreur des animalistes ». Sommes-nous en 2056 ou dans le monde d’aujourd’hui ?
L’attente fait partie du quotidien de tous les paysans, partout et depuis toujours. Concernant la menace des animalistes, nous sommes dans le passé de la narration qui se situe en 2056, donc aujourd’hui…
Votre style s’élève prodigieusement lorsqu’il s’agit de décrire la nature, que ce soit la forêt ou un coucher de soleil en montagne. Remarquables sont également les répétitions qui, par leurs accumulations qui s’étendent souvent sur une page entière, font surgir des beautés superlatives. Sans parler du vocabulaire rare contenant des mots de la famille lexicale des montagnes et des glaciers. Pouvez-vous nous parler de cette prédilection pour ce type d’écriture ?
Je n’ai pas de prédilection pour un type d’écriture particulier, j’essaie juste d’être la plus précise possible, et de trouver le mot, la phrase qui conviennent le mieux pour décrire les sensations et les émotions que je veux faire passer. Il arrive que le vocabulaire spécifique ne soit pas remplaçable, surtout lorsqu’il contient une certaine poésie. Par contre, j’ai une tendance au lyrisme, à la surenchère d’adjectifs… mais je me surveille et je fais en sorte que tout le roman ne soit pas « emporté », qu’il reste sobre lorsque c’est nécessaire, et je réserve les débordements aux moments où ça dérape aussi dans l’histoire que je raconte.
Et le silence ? Comment décrit-on le silence, ce « silence des hauteurs », un silence qui mesure par son envergure la vie tout simplement de la nature sans la présence humaine ?
Le silence dont je parle est effectivement la nature sans l’homme, mais lorsque cette nature est « calme », et ce n’est pas toujours le cas. Ce n’est pas une absence de bruits bien sûr, ce sont des bruits différents, qui prennent le temps et la place de s’épanouir. C’est aussi le silence d’avant le fracas, d’avant la catastrophe, comme si la montagne retenait son souffle avant de craquer de partout.
En conclusion j’aimerais vous parler d’un mot qui a attiré mon attention, celui d’invivre. Voici le contexte : « Invivre, est-ce que c’était plus difficile que vivre, que vivre qui est déjà si difficile ». Peut-on dire que votre roman n’est finalement qu’une tentative magnifiquement bien illustrée pour trouver une place dans la vie de vos personnages de ce mot douloureusement vrai ? Et, enfin, n’est-il peut-être pas le mot qui s’accorde le plus avec le titre de votre roman, ce hors gel, cette existence en sourdine, qui n’est finalement que la définition même de la condition humaine ?
J’ai emprunté ce verbe à Fernand Deligny, dans le film de Renaud Victor, Ce gamin-là (1975)* : « Invivable, alors la société a tout prévu, et même des lieux où invivre le soit, prévu. » Dans l’histoire que je raconte, « invivre » c’est comme être « hors gel ». Le gel tient le sol de la montagne, et, lorsqu’il fond, tout peut déraper et déborder et s’écrouler. Pour Clémence, le hors gel, c’est lorsqu’elle sort de la gangue de la société ou de la thérapeutique qu’on a essayé de lui faire suivre (psychologues, hospitalisations, contentions, chimie…) : libérée de cette gangue, elle est à la fois magnifique et incontrôlable.
- http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/4903
- https://www.unifrance.org/film/4888/ce-gamin-la-radeaux-dans-la-montagne
Propos recueillis par Dan Burcea
Photo d’Emmanuelle Salasc : © Hélène Bamberger P.O.L
Emmanuelle Salasc, Hors gel, Éditions P.O.L., 2021, 416 pages.

