
Dès son premier roman, «Chercher Proust» (Le Livre de Poche, 2014) Michaël Uras avait séduit les amateurs de bonne littérature par son talent, à tel point que ceux-ci n’ont pas hésité à mettre ce titre sur la liste de leurs préférences, le sélectionnant pour le Prix des lecteurs. Ils avaient sans doute été conquis par le personnage de Jacques Bartel, vrai modèle de l’anti-héros, pratiquant l’autodérision et un humour intelligent et très inspiré qui découvre dès l’adolescence Marcel Proust et vit «sous domination proustienne». Se faisant embaucher dans un institut de recherches sur la vie et l’œuvre de son idole, il exerce le métier de chercheur, ce qui «l’éloigne de la réalité» et l’oblige à passer de «longues heures à lire et à étudier dans le calme».
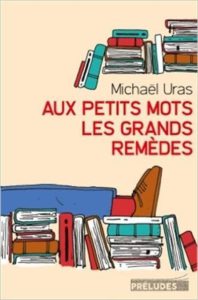 L’effort en vaut la peine, nous dit-il, car «Proust aide à vivre, c’est un plaisir». Plus qu’un hédonisme fortifiant, ce propos a valeur d’indice annonçant le thème de son deuxième roman, «Aux petits mots les grands remèdes» (Éd. Préludes, 2016), la bibliothérapie. Cette discipline paramédicale dont la vocation est justement de redonner la joie de vivre à l’aide de la lecture commence à être connue en France grâce aux travaux de Michèle Petit ou à la formation dispensée par Régine Detambel. Le sujet mérite ici une petite parenthèse pour parler de ses vertus dans un monde devenu «un espace de crise» et où «l’accélération des transformations, l’accroissement des inégalités, des disparités, l’ampleur des migrations ont altéré ou fait disparaître les cadres dans lesquels la vie se déroulait, vulnérabilisant hommes, femmes et enfants de façon évidemment très variable selon les ressources matérielles, culturelles, affectives dont ils disposent et le lieu où ils vivent[1]». L’acte de lire passe par la voix, par l’accueil de la réalité racontée et ensuite par la fonction symbolisante ayant trait à nos peurs préhumaines, «la solitude et l’obscurité», selon Pascal Quignard cité dans son livre par Michèle Petit. Régine Detambel parle, quant à elle, de «bibliothérapie créative» dans son livre «Les livres prennent soin de nous[2]» où elle détaille quelque unes des sources théoriques de sa pratique de bibliothérapeute.
L’effort en vaut la peine, nous dit-il, car «Proust aide à vivre, c’est un plaisir». Plus qu’un hédonisme fortifiant, ce propos a valeur d’indice annonçant le thème de son deuxième roman, «Aux petits mots les grands remèdes» (Éd. Préludes, 2016), la bibliothérapie. Cette discipline paramédicale dont la vocation est justement de redonner la joie de vivre à l’aide de la lecture commence à être connue en France grâce aux travaux de Michèle Petit ou à la formation dispensée par Régine Detambel. Le sujet mérite ici une petite parenthèse pour parler de ses vertus dans un monde devenu «un espace de crise» et où «l’accélération des transformations, l’accroissement des inégalités, des disparités, l’ampleur des migrations ont altéré ou fait disparaître les cadres dans lesquels la vie se déroulait, vulnérabilisant hommes, femmes et enfants de façon évidemment très variable selon les ressources matérielles, culturelles, affectives dont ils disposent et le lieu où ils vivent[1]». L’acte de lire passe par la voix, par l’accueil de la réalité racontée et ensuite par la fonction symbolisante ayant trait à nos peurs préhumaines, «la solitude et l’obscurité», selon Pascal Quignard cité dans son livre par Michèle Petit. Régine Detambel parle, quant à elle, de «bibliothérapie créative» dans son livre «Les livres prennent soin de nous[2]» où elle détaille quelque unes des sources théoriques de sa pratique de bibliothérapeute.
Alexandre, le personnage de Michaël Uras, a, quant à lui, des raisons de croire en ces vertus curatives de l’esprit car, pour lui, les mots sont «comme des pansements». Et même si sa méthode peut laisser ses patients sur leur faim, il l’assume : «J’aime sentir l’attente chez l’autre. Pourtant, je ne propose rien de miraculeux. Qui le pourrait d’ailleurs ? Je n’ai jamais cru aux miracles, seulement à la volonté». À ceux qui auraient tendance, comme sa mère, à croire qu’il s’est enrôlé dans une secte, il répond : «Non, je ne souhaitais pas m’occuper de ce genre d’écrits. Seulement de littérature», tout en reconnaissant que «parfois, la vie est rattrapée par la littérature». Nous voici arrivés, par cette dernière affirmation, au vif du sujet : en mettant sur pied d’égalité la réalité de la vie et le pouvoir fictionnel de la littérature qui transgressent, autant l’une que l’autre, les frontières poreuses qui les séparent, Michaël Uras nous dévoile un projet d’écriture qui dépasse le genre d’un manuel de bien-être. Au contraire, il ne cache pas son ambition de construire une narration autour de la vie de son personnage, Alexandre, frère jumeau, tout aussi décalé, de Jacques Bartel, converti, lui, en guérisseur des âmes et, pour reprendre ses propres mots, «rattrapé par la littérature».
Comme son prédécesseur, Alexandre se nourrit de la littérature, comme d’une «intertextualité magique», étant lui-même sujet à une transformation profonde de sa vie qu’il nous invite à suivre. Car, en effet, la première fiche qu’il rédige avec application et humour concerne sa propre personne. Beaucoup de similitudes le lie (là encore) de son précédent modèle. Il dévoile sa relation avec Mélanie qui l’a quitté ne supportant plus sa passion dévorante pour les livres. En bon professionnel, il recommande «Le journal du séducteur» de Sören Kierkegaard pour «tenter de séduire à nouveau» Mélanie. Gardant ses distances avec ce registre plaintif mais posant tout au long du récit un œil introspectif sur ses problèmes, Alexandre nous fait entrer dans le secret de ses relations avec ses patients. Sans doute, ceux-ci ne sont pas choisis au hasard, ils ont chacun une force symbolique tellement distincte que l’on pourrait les assimiler à de vrais cas d’école. Les énumérer suffit pour s’en rendre compte : Yann B, jeune qui vit une expérience post-traumatique, après un grave accident, «cas extrêmement complexe mais passionnant». Avec lui, Alexandre va essayer de lui rendre la confiance perdue et de le sortir de l’isolement; Robert Chapman, employé dans le commerce de montres de luxe, épuisé par son travail, avec des problèmes de couple qui veut offrir à sa femme un lave-linge dernier cri ; Anthony Poltra, footballeur professionnel, «riche, beau, célèbre et en bonne santé» mais qui se pose trop de questions sur «sa place en société».
À chacun de ses patients, Alexandre propose la lecture à vive voix ou en solitaire de différentes œuvres littéraire, chacune répondant par un lien direct ou allusif à sa pathologie. Ainsi, à Yann, Alexandre propose Thomas l’imposteur, de Jean Cocteau et L’Attrape-cœurs, de J. D. Salinger, à Anthony Poltra, l’Odyssée de Homer et à Robert Chapman, Oblomov d’Ivan Gontcharov et La lenteur de Milan Kundera. Tous ces ouvrages sont en lien avec leur personnalité et leurs problèmes. Reste à savoir comment ces lectures vont agir sur ces biblio-patients, quel impact vont avoir sur leur conscience et quelle capacité à changer leurs habitudes. L’auteur sait qu’il ne s’agit pas ici d’une lecture, nommons-la, ordinaire, et d’une démarche de routine. Il faut qu’elle réponde à un besoin curatif, à une démarche de guérison et à une volonté affirmée de changement, de sortir de ce que chacun considère comme «situation complexe». «Quand tout va bien, on va à la bibliothèque, pas chez un bibliothérapeute», nous dit-il pour nous faire comprendre les motivations de la démarche de ses patients.
Un court exemple, pour illustration, sans rien trahir des secrets du magicien des mots qui est Alexandre. Chapman a renoncé dès sa jeunesse à la lecture, suite à un événement familial, alors qu’il adorait lire. La vie, le travail, la routine l’ont ensuite empêché à reprendre la lecture. Comment lui redonner ce goût et essayer de résoudre ainsi ce sentiment de lassitude et d’absence à la vie si ce n’est que par le contraire de ce qu’il attendait? Car Oblomov est tout sauf un lecteur assidu. «Ce qui m’étonne – reconnait-il – dans le choix de ce livre, c’est que les personnages rejettent complétement la littérature. Vous avez pris des risques en me le proposant. Je ne lis plus et vous me mettez entre les mains l’histoire d’un type qui pense que les auteurs sont des êtres inutiles. Un insensible aux mots qui lit le journal sans s’intéresser aux dates». Il accepte même à lire à voix haute un fragment du livre. Nous retrouvons ici tout le protocole décrit par les théoriciens de cette thérapie. Alexandre l’explique: «Lire à haute voix est une pratique impudique. On ne peut pas se cacher derrière le texte. […] Faire entendre sa voix lors d’une lecture est forcément une mise en danger. Le silence qui précède est terrifiant. Puis vient la voix qui le détruit et ne le laisse plus revenir. La voix appelle la voix.» Le changement d’attitude de Robert Chapman à l’encontre de la littérature, mais aussi de sa femme, de son entourage et, enfin, de lui-même est emblématique et les autres patients d’Alexandre agissent de même, chacun à un rythme adapté à la profondeur de la plaie qu’ils ont à guérir.
Reste à savoir si le bibliothérapeute lui-même a pu résoudre ses problèmes personnels. Pour le savoir, il faut retourner dans le domaine du romanesque. La hauteur que son savoir lui confère suffira-t-elle pour faire revenir Mélanie? Pourra-t-il assumer les choses de la vie courante, prendre en charge son quotidien, pouvoir payer ses loyers, échapper aux regards assassins de Mme Farber, sa propriétaire, et, surtout, se remettre sans cesse en question? Tous ces aspects dévoilent aux lecteurs sa fragilité, sa sensibilité unique, humaine et, en fin de compte, très romanesque. Et c’est sans doute dans cette capacité d’humaniser ses personnages que consiste la qualité essentielle de ce roman. Au courage de les placer en marge des modèles communs s’ajoute la candeur de faire de cette différence la marque d’une humanité profonde qui les transfigure et attire la sympathie des lecteurs qui, en fin de compte, se reconnaissent tout simplement en eux.
D’autres éléments font la singularité de la prose de Michaël Uras.
Ce qui, à première vue, pourrait ressembler à une timidité incorrigible, à une singularité avéré – «tu ne laisses personne indifférent», s’exclame son héros – n’est que sublimation, métaphorisation, reflet imparfait et mineur d’une réalité que la littérature dévoile à travers une fenêtre, symbole d’un quatrième mur traversé par le regard de génie de l’artiste-créateur, rempart gardien de l’approximatif, de l’ineffable et transfigurant la beauté unique du monde. Et c’est justement en cela que consiste le principe actif de la bibliothérapie : «Donc la littérature c’est la vie de l’autre côté de la fenêtre. En cela, elle peut nous aider. Parce qu’elle est presque la vie. Il faut simplement adapter le texte à la situation. Dans ce simplement se trouvait tout le sel de mon métier».
Merci, docteur Uras, pour cette belle et lénifiante leçon de littérature curative !
Dan Burcea (28/09/2016)
Michaël Uras, Aux petits mots les grands remèdes, Éditions Préludes, 2016, 375 p., 15,10 euros.
[1] Michèle Petit, «L’art de lire ou comment résister à l’adversité», Ed. Belin, 2008, p. 13.
[2] Regine Detambel, «Les livres prennent soin de nous», Ed. Actes Sud, 2016.

