
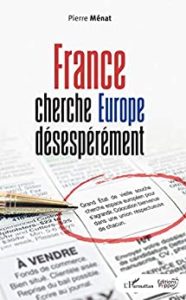 Diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France au Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et en Tunisie, Pierre Ménat a longtemps œuvré pour l’Europe à des postes et dans des gouvernements successifs, comme conseiller du Président de la République et directeur des affaires européennes. Comme écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, il publie cette année le livre « France cherche Europe désespérément », où il met au profit du grand public les résultats de cette riche expérience acquise dans le feu de l’action gouvernementale. « J’ai été moussaillon avant d’être commandant de bord ! », affirme-t-il avec le haut sens du devoir qui le caractérise pour définir sa contribution à l’édifice européen.
Diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France au Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et en Tunisie, Pierre Ménat a longtemps œuvré pour l’Europe à des postes et dans des gouvernements successifs, comme conseiller du Président de la République et directeur des affaires européennes. Comme écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, il publie cette année le livre « France cherche Europe désespérément », où il met au profit du grand public les résultats de cette riche expérience acquise dans le feu de l’action gouvernementale. « J’ai été moussaillon avant d’être commandant de bord ! », affirme-t-il avec le haut sens du devoir qui le caractérise pour définir sa contribution à l’édifice européen.
Toujours disponible, malgré ses multiples activités, Pierre Ménat a accepté de répondre à nos questions et nous éclairer sur l’actualité politique et sur la vision dont témoigne son livre.
Avant de parler de votre livre, permettez-moi une question liminaire liée à l’actualité mouvementée du Brexit. De quoi est-elle le nom cette déroute politique qui a saisi le Royaume Uni et comment voyez-vous la fin de ce feuilleton, en tout cas à cette date ?
Le Brexit est un tremblement de terre. Le peuple britannique a pris une décision mais il est, je pense, normal que des débats houleux interviennent à Londres au moment de passer à l’acte. En plus de cette donnée de base, la situation politique au Royaume Uni est particulière. Mme May est très contestée au sein de son parti, les Tories, mais ceux-ci ne veulent pas renverser son gouvernement. Car s’ils le font, il y aurait sans doute des élections générales. Et le parti conservateur serait pris en sandwich entre le Labour, donné gagnant, et UKIP qui pourrait reprendre des couleurs. J’ajoute un élément qui a été peu mentionné. Jusqu’en 2011, le Premier britannique pouvait dissoudre – ou plutôt proposer à la Reine de dissoudre – quand il l’estimait utile. Mais une réforme alors réclamée par M. Clegg (libéral-démocrate) à M. Cameron qui l’a acceptée dans le cadre de l’accord de coalition entoure la convocation d’élections générales de conditions drastiques. Si bien que Mme May ne dispose plus de cette arme pour convaincre les récalcitrants.
Pour la fin de ce feuilleton, six mois de sursis ont été accordés aux Britanniques. Mais les termes du débat n’ont pas changé. La priorité de Mme May demeure la validation par le Parlement de l’accord de retrait. Elle a avancé deux nouveaux pions : d’une part, l’organisation le 23 mai d’élections au Royaume Uni pour désigner des représentants au Parlement européen ; d’autre part l’engagement de négociations avec les travaillistes. Mme May a besoin d’une trentaine de voix pour faire approuver l’accord. Si elle n’y parvient pas, une deuxième option est souvent citée par la presse : l’abandon du Brexit, dont l’élection de parlementaires européens britanniques serait la première étape. Je ne crois pas beaucoup en cette hypothèse. Elle supposerait un second referendum. Je ne vois ni un gouvernement conservateur, ni même un éventuel gouvernement travailliste, prendre la responsabilité d’organiser un tel scrutin. Et donc si au 31 octobre il n’y a ni validation de l’accord de retrait, ni décision d’annuler le Brexit, nous en reviendrons au « no deal », c’est-à-dire au Brexit sans accord. Cette hypothèse conserve aujourd’hui toute sa validité.
S’agit-il d’un désamour éminemment anglais ou d’un phénomène qui a déjà traversé d’autres frontières dont celles de l’Hexagone ?
Restons en France pour le moment. Nos compatriotes sont restés longtemps favorables à l’Europe, incarnée aujourd’hui par l’Union européenne. Ils avaient l’impression que le projet européen était positif pour l’avenir mais également favorable aux intérêts de la France. C’était le cas notamment des agriculteurs, qui connaissaient bien l’Europe. Et puis les Français, dans leur majorité, ont changé de camp. Cette mutation s’est incarnée dans le « non » à la Constitution européenne qui a marqué un vrai tournant. Une grande partie des Français a été convaincue par les arguments disparates des eurosceptiques touchant la perte de souveraineté, l’excès de libéralisme ou l’austérité prétendument imposés par ‘UE. De plus, les Français se reconnaissent de moins en moins dans le modèle économique de l’UE, qui, avec les années, est devenu plus anglo-saxon. Il est une catégorie qui a basculé : ce sont les paysans, qui ont longtemps été favorables à l’Europe et ne le sont plus. Comme je le montre chiffres à l’appui dans mon livre, le clivage entre Français sur l’Europe rejoint celui qui divise la nation elle-même. Les populations modestes, ouvrières, rurales, isolées, sont les plus réticentes au projet européen. Celui-ci satisfait davantage les habitants des grandes villes, plus aisés et de formation universitaire.
Avant d’inviter les lecteurs à embarquer sur le navire de la construction européenne au bord duquel nous convie votre livre, que pourriez-vous nous dire de votre expérience et de vos qualités de commandant de bord ?
J’ai été moussaillon avant d’être commandant de bord ! En fait j’ai commencé à traiter de questions européennes en 1982, en m’occupant d’abord d’industrie et recherche, puis de la politique agricole commune, comme rédacteur, c’est-à-dire à un niveau très modeste. Puis, en 1986, je suis devenu conseiller technique au cabinet du ministre des affaires étrangères Jean-Bernard Raimond. C’était la première cohabitation et l’Europe était un enjeu politique entre le président François Mitterrand et le Premier ministre Jacques Chirac, tous deux candidats à l’élection présidentielle de 1988. J’ai alors pu observer ces deux hautes personnalités, qui tous deux étaient d’excellents connaisseurs de la construction européenne. Quelques années plus tard, en 1993, le ministre Alain Juppé m’a confié des fonctions analogues à son cabinet. Auprès de lui, j’ai traité le dossier épineux du GATT qui a provoqué une crise majeure entre la France et ses partenaires. Mais nous n’étions encore que Douze. Dans la foulée, lorsqu’il a été élu en 1995, le président Chirac m’a nommé auprès de lui comme conseiller chargé des affaires européennes. Les dossiers étaient nombreux mais l’un d’entre eux m’a beaucoup occupé : celui de la réforme institutionnelle avant le grand élargissement. Hélas ! Au Conseil européen d’Amsterdam, nous avons échoué et cet échec a pesé lourd car il a expliqué les étapes suivantes : Nice, la constitution européenne, le traité de Lisbonne. Puis, fin 1997, je suis parti pour la Roumanie, où j’ai été près de cinq ans ambassadeur de France. Ma première mission a été de soutenir la candidature de ce pays à l’Union européenne. Il y avait deux conditions à cela : une bonne préparation économique et administrative ; mais aussi que les Roumains y croient et ne se considèrent pas comme les éternels exclus de l’Europe. Quand je me rends à Bucarest aujourd’hui, j’ai l’impression que les Roumains ont un peu oublié que sans l’engagement personnel du Président Chirac, ils ne seraient toujours pas membres de l’UE aujourd’hui. Après la réélection du président en 2002, le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin, m’a nommé directeur des affaires européennes. Comme souvent, il y avait débat sur la politique agricole commune. Nous en avons sauvegardé les mécanismes et le budget. Et, bien sûr, la Convention qui élaborait le projet de traité constitutionnel ; les terribles divisions provoquées par la crise irakienne qui ont fait douter de la possibilité même d’une politique étrangère de l’UE.
De 2004 à 2007, j’ai représenté la France en Pologne. A mon arrivée, ce pays venait d’entrer dans l’UE. Déjà, les frères Kaczynski sont arrivés au pouvoir en 2005. Mais ce fut Lech Kaczynski qui fut élu président. Sa disparition tragique en 2010 a propulsé son frère jumeau Jaroslaw, très différent et moins ouvert, comme chef de la famille et aujourd’hui, dans l’ombre, véritable patron de la Pologne.
En 2007, le nouveau président, Nicolas Sarkozy, me confia à nouveau la direction des affaires européennes. Nous eûmes deux années très rudes avec la crise financière, le traité de Lisbonne et la dernière présidence française en 2008. Puis, en 2009, je partis en Tunisie. J’ai relaté dans un autre livre mon séjour à Tunis et les conditions dans lesquelles je quittai ce poste en 2011, pour effectuer à La Haye, de 2011 à 2014, ma dernière mission comme ambassadeur de France.
L’Europe, écrivez-vous, est victime d’une complexification qui la rend « incapable d’appliquer ce qu’elle a décidé et d’adopter, hors modèle et idéologie, un programme minimum de survie ». En cause, l’élargissement, l’inflation des normes, le manque de courage politique ou autre ?
Les trois sont liés. Pour moi, le principe de l’élargissement n’est pas en cause, car c’était un devoir politique et moral. Mais songez qu’en douze ans, de fin 1994 à début 2007, l’Union est passée de 12 à 27 membres. Cet effet de nombre n’a pas été vraiment corrigé par une réforme institutionnelle adaptée : ce fut l’échec d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne. L’inflation des normes est liée à cela. Les 16 nouveaux commissaires et leurs directeurs généraux doivent bien trouver à s’occuper et proposent un nombre croissant de textes au Conseil et au Parlement. Et le manque de courage politique conduit à s’abstenir d’aller au bout d’une logique. C’est le cas pour l’immigration, pour laquelle la seule solution viable est une répartition entre États-membres, du moins pour ls réfugiés.
Quelle est la responsabilité des États membres si l’on évoque « le principe de subsidiarité » ?
Cette question suppose d’examiner les catégories de compétences de l’UE. C’est un apport positif du traité de Lisbonne que des les avoir énumérées. Les compétences exclusives, pour lesquelles les États sont dessaisis, ne sont qu’au nombre de 5. Trois résultaient du traité de Rome : l’Union douanière, la concurrence et la politique commerciale commune. Deux se sont ajoutées : la conservation des ressources halieutiques en 1983, puis en 1999, la monnaie pour les membres de la zone euro. Dans ces domaines, il faut regarder si la compétence de l’UE est exercée dans des conditions satisfaisantes. A l’autre bout, il y a les compétences d’appui, c’est-à-dire celles qui demeurent dans la main des Etats-membres et qui sont très vastes : santé, éducation, police, affaires sociales et bien sûr affaires étrangères et défense. Entre les deux les compétences partagées, au nombre de 11, dont le climat, le marché intérieur, l’asile. C’est là que doit s’appliquer le principe de subsidiarité : l’Union n’intervient que si elle apporte une valeur ajoutée. Ce sont les parlements nationaux qui contrôlent l’application de ce principe. Le traité de Lisbonne leur donne des moyens qu’on appelle le carton jaune et le carton rouge. Mais ces procédures ont été rarement utilisées en dix ans. Donc, pour répondre à votre question, la responsabilité appartient à la fois à la Commission, qui ne résiste pas à la tentation de l’inflation législative et aux États qui n’utilisent pas assez leurs moyens de freiner cette tendance mais cependant la dénoncent.
Selon vous, l’élargissement a conduit la France à la perte de sa « centralité géographique et politique ». Vous accordez une place de prédilection à la conception gaullienne sur l’Europe. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, le Général de Gaulle était un grand Européen. Je cite plusieurs de ses discours des années 50 et 60. Son objectif était de créer une Confédération, à l’époque des Six. Mais une confédération n’est pas très éloignée d’une fédération. Elle suppose une délégation de compétences, que le Général assumait. Mais De Gaulle n’est pas parvenu à ses fins car il avait deux autres exigences. Il voulait une Europe indépendante des États-Unis, alors que nos partenaires ne concevaient notamment de défense que transatlantique, dans le cadre de l’OTAN. Il était opposé à l’entrée du Royaume Uni dans la Communauté, que les autres appelaient de leurs vœux. C’est pourquoi je propose de ressortir le Plan Fouchet des cartons. Ce plan avait pour objectif de créer une véritable politique étrangère et de défense. Il a achoppé sur trois sujets, qui ne se présentent plus sous le même jour. D’abord, l’exigence de nos partenaires que Londres y soit associée apparaît sous un jour nouveau avec le Brexit. Ensuite, l’allégeance à Washington, alors que les États-Unis, aujourd’hui se désengagent. Enfin, la question des rapports entre cette Union politique et les communautés européennes, question pour laquelle des solutions pragmatiques existent.
Après 1982, lorsque l’Europe passe de 10 à 12 États membres, la France se voit attribuer un rôle directeur «d’agitateur d’idées et de membre du couple moteur franco-allemand». En quoi consiste ce tandem connu sous le nom de «couple franco-allemand», si nécessaire et si décrié à la fois ?
La Communauté puis l’Union sont nées d’initiatives franco-allemandes. Nos deux pays représentent encore aujourd’hui 40 % de la richesse de l’Union. En plus, nous partons de positions si différentes que lorsque nous sommes d’accord, le compromis que nous trouvons reflète souvent le point d’équilibre général d’une négociation. Mais si ce couple demeure nécessaire, force est de constater qu’il ne fonctionne plus très bien, car il est devenu déséquilibré. En population, en prospérité, en influence, l’Allemagne est plus forte. Elle a aujourd’hui la tentation du « cavalier seul », qu’elle a tant reprochée à la France. Il appartient à notre pays de reconstituer un réseau de proximité, au sud et à l’est de l’Europe. Et aussi de se réformer, car certains font valoir que la France promeut un modèle assez peu attractif pour eux.
Quels ont été les moments les plus graves dans la fracture entre la France et l’Europe ? Je pense au référendum de mai 2005, mais également aux signes avant-coureurs comme le vote favorable mais de justesse du Traité de Maastricht en 1992.
Oui, le référendum sur Maastricht, le 20 septembre 1992, n’ai été approuvé que par 51 % des Français. A l’époque, les paysans ont massivement voté contre car ils rejetaient la réforme de la PAC dite Macsharry, qui a transformé le soutien aux prix par des aides aux revenus. Cependant, le oui l’a emporté de justesse car les grands partis français, dits de gouvernement, le soutenaient. Ensuite, la fracture s’est élargie car au sein de ces partis, notamment le PS, une part croissante s’est montrée de plus en plus critique envers la construction européenne. Cette alliance entre les populistes et une partie des formations modérées, en quelque sorte désinhibées, a scellé le divorce entre l’Europe et les classes populaires.
Vous consacrez une bonne partie de votre ouvrage aux solutions qui pourraient sortir l’Europe de l’impasse actuel. Quelles ont été les raisons de votre démarche, alors que beaucoup d’hommes politiques se contente de la critique, souvent sous sa forme la plus facile et la plus partielle ?
Les responsables politiques ont leur propre logique. Ils veulent attirer à eux une partie de l’électorat. Donc ils lancent des mots d’ordre censés frapper l’opinion : Frexit, sortie des traités ou au contraire formation d’un groupe pionnier lançant des actions de pointe. Ma démarche est différente. J’essaye de distinguer ce qui peut marcher de ce qui est irréaliste ou dangereux. C’est pourquoi j’écarte le Frexit, non sans l’analyser. Je juge également vaine une grande révision des traités. Et j’essaye de préconiser des pistes réalistes.
Comment permettre aux Français, comme aux Citoyens européens d’ailleurs, à se réapproprier l’appartenance européenne que vous qualifiez d’essentielle ?
Oui, c’est la première piste que j’explore, en partant d’une idée simple. Pourquoi les eurosceptiques rencontrent-ils un tel succès ? Parce qu’ils partent de problèmes bien réels que rencontrent les citoyens, tels que l’immigration, le pouvoir d’achat ou l’insécurité. Et ils en imputent la responsabilité à l’Union européenne. Ils jouent sur du velours car que connaissent les citoyens de l’UE ? Lors des réunions du Conseil européen, nous voyons à la télévision les véhicules des Chefs d’État ou de gouvernement. Les correspondants tirent à la ligne : on ne sait pas très bien ce qui se passe. Enfin, le chef de délégation s’exprime, mais sur le seul sujet en discussion, souvent très technique.
Et encore, les Conseils européens sont suivis par la grande presse. Ce n’est le cas ni des travaux de la Commission -sauf à les critiquer comme pour la décision sur Alstom-Siemens-, ni des instances du Conseil, ni du Parlement européen. Il faut donc essayer de répondre – ce n’est pas facile – au double déficit d’information et de proximité. Vous trouverez dans mon livre un certain nombre d’idées. Par exemple, Erasmus, qui a été le seul succès notable, pourrait s’étendre à l’ensemble de l’enseignement professionnel, voire au secondaire. Le web pourrait également être mieux utilisé, notamment par des jumelages électroniques.
Une autre valeur à reconquérir est celle de la citoyenneté. Peu d’Européens en sont conscients, écrivez-vous.
Plutôt à conquérir. C’est une notion qui est apparue dans le traité de Maastricht, entré en vigueur voici 26 ans. Une précision d’abord : la notion de citoyenneté ne se confond pas avec celle de nationalité. La citoyenneté européenne s’ajoute à celle que nous avons dans un État-membre. Il est vrai qu’une majorité de Français a de cette innovation une vision abstraite ou d’ailleurs pas de vision du tout. Mais nos compatriotes vivant dans un autre État-membre savent par exemple qu’ils peuvent se présenter aux élections organisées dans cet État. J’ai plusieurs exemples aux Pays-Bas, voire même en Roumanie. En outre, depuis le traité de Lisbonne, si un million au moins de citoyens «représentant un nombre significatif d’États-membres» le demandent, ils peuvent obliger la Commission à présenter une proposition sur tel ou tel sujet.
Beaucoup reprochent à l’Union européenne l’abandon de souveraineté, l’excès de libéralisme, une politique de rigueur et une absence de protection. Comment combattre ces idées reçues dans l’opinion publique ?
J’aborde en effet ces sujets et bien d’autres dans le chapitre consacré au débat européen. Mon approche consiste à tout mettre sur la table. Par exemple, la question de la souveraineté ne peut être traitée de manière globale, mais par domaine, en fonction du type de compétences concernées. Et même pour les compétences exclusives, comme la monnaie pour les membres de la zone euro, il peut y avoir débat sur la meilleure manière pour l’Union de les exercer. C’est la question de la gouvernance. Autrement dit, il ne s’agit pas tant de combattre tel ou tel argument pertinent, mais de le replacer dans un contexte et de démontrer qu’à partir de constats parfois partiellement exacts, on peut arriver à de fausses conclusions.
Interview réalisée par Dan Burcea
Pierre Ménat, « France cherche Europe désespérément », L’Harmattan, Éditions Pepper, 2019, 320 p.

