
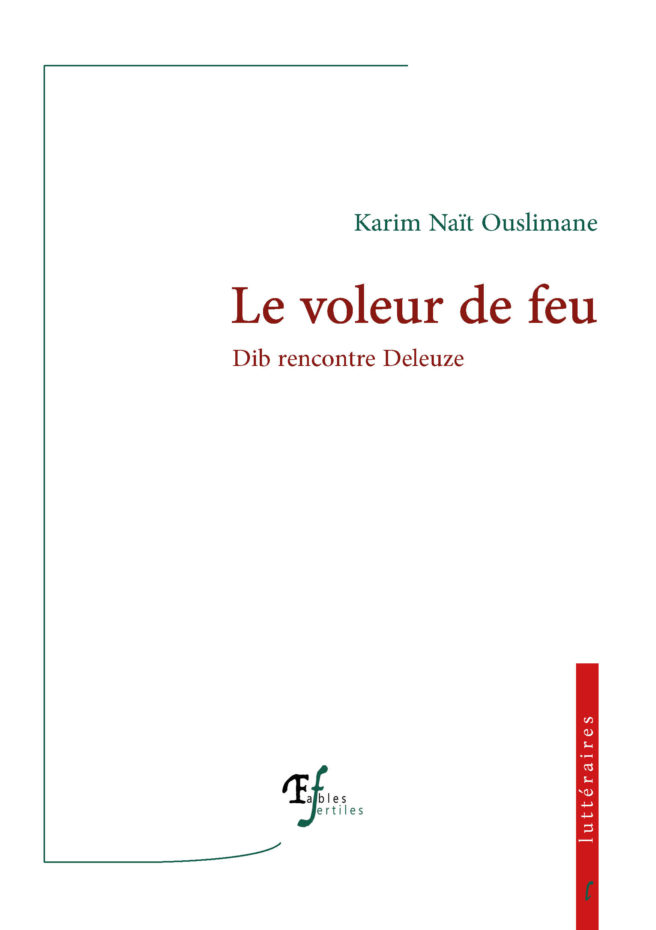 Avec Le voleur de feu – Dib rencontre Deleuze, Karim Nait Ouslimane signe une œuvre dense proposant une réflexion inédite sur l’œuvre protéiforme de Mohammed Dib, considéré comme l’un des plus grands écrivains algériens. L’objet littéraire est singulier, qui croise plusieurs dynamiques de création. Il nous a semblé important que l’auteur, à travers cet entretien, donne au public quelques clefs de lecture de ce qui a constitué son projet, un cheminement.
Avec Le voleur de feu – Dib rencontre Deleuze, Karim Nait Ouslimane signe une œuvre dense proposant une réflexion inédite sur l’œuvre protéiforme de Mohammed Dib, considéré comme l’un des plus grands écrivains algériens. L’objet littéraire est singulier, qui croise plusieurs dynamiques de création. Il nous a semblé important que l’auteur, à travers cet entretien, donne au public quelques clefs de lecture de ce qui a constitué son projet, un cheminement.
G.D. : La littérature sur et autour de l’œuvre de Mohammed Dib est abondante. Pourquoi ce livre ?
A priori, oui, mais en y regardant de plus près, on constate l’inverse. Les publications sur l’œuvre de Mohammed Dib abordent souvent ses premiers textes, publiés dans le contexte de la colonisation. Comparativement, peu de livres s’intéressent réellement à sa production post-coloniale. Or, d’un point de vue littéraire, et même politique, ce sont ces textes publiés après l’indépendance de l’Algérie qui renferment l’essentiel de la pensée dibienne. Car contrairement à beaucoup d’auteurs francophones de sa génération, et même de la génération récente, Mohammed Dib n’a pas entretenu un rapport conflictuel avec la francophonie. Son rapport à la langue s’est fait autour de la création, et non de la revendication. Et c’est justement par cette entrée que Le Voleur de feu aborde l’œuvre de Mohammed Dib. Le recours à la théorie deleuzienne s’explique aussi par le fait que Dib a vécu sa francophonie comme un créateur, et non comme un créancier. Il n’y a pas de ressentiment chez Dib. De la douleur, sans-doute, mais pas de ressentiment.
- : Pouvons-nous dire que cette absence de ressentiment chez Dib marque avant tout une volonté déterminée d’adopter un “oui créateur” ? Et dans l’affirmative, dans quelle mesure la langue du colonisateur, ce « champ de mines », comme vous l’écrivez, pouvait servir le geste créateur de l’écrivain ? La langue arabe n’eût-elle pas été un terreau plus favorable ?
La question, à mon sens, porte moins sur le choix de la langue arabe ou de la langue française que sur la volonté d’édifier un dire révolutionnaire portant une parole collective. Le fait que ce dire passe par la langue française, qui est aussi la langue du colonisateur, ne pouvait qu’augmenter sa portée, d’autant que les idées révolutionnaires qui s’expriment à travers cette littérature ne sont pas sans lien avec les idées de liberté, d’égalité, de droits de l’homme qui ont marqué la Révolution française. À cette idée du dire littéraire s’ajoute aussi l’idée de l’Homme algérien, qui avait longtemps souffert des conséquences psycho-sociales du statut de l’indigénat. S’approprier la langue française était aussi une manière de s’émanciper de ce rapport d’altérité entre l’homme colonisateur et le sous-homme indigène. C’est dans cette équation complexe que se forge l’esprit révolutionnaire de l’écriture dibienne, qui est aussi celui de la francophonie.
GD : La référence au « feu volé » pour qualifier l’espace littéraire dibien exprimerait donc cette réappropriation de la langue du colonisateur ?
Oui, tout à fait, et c’est d’ailleurs Kateb Yacine qui parlait de la langue française comme d’un « butin de guerre ». Mais cette idée de réappropriation doit être entendue dans son sens le plus large : à la fois sur le plan littéraire, et sur le plan philosophique. Lorsque Dib dit « je » en français, il n’est pas dans un procédé d’inversion du discours colonial, comme font certains de nos jours, qui opposent à la violence du discours colonial d’autres formes de violence qui ne sont pas moins condamnables. La réappropriation de la langue française, telle qu’on la retrouve dans l’œuvre dibienne, permet au contraire d’accentuer le discours humaniste que cette langue a longtemps véhiculé avant qu’elle ne s’embourbe dans le marécage colonial. Et d’ailleurs, cette idée de la plurivocité de la langue qui caractérise le dire littéraire est extrêmement importante. Elle permet d’échapper à l’univocité des discours de domination dont l’objectif final est le contrôle du sens. C’est la raison pour laquelle l’œuvre post-coloniale de Mohammed Dib a suscité la méfiance des dirigeants du FLN, qui, après avoir porté les aspirations des Algériens à la libération, s’est transformé après l’indépendance de l’Algérie en un moyen de répression du peuple algérien, dont les aspirations à la liberté se sont heurtées aux tendances totalitaires des dirigeants du FLN, notamment après 1965. Il est d’ailleurs étonnant de constater que les interrogations que Dib a soulevées dans son œuvre post-coloniale sur le devenir de la révolution algérienne et le FLN sont désormais portées par une majorité d’Algériens, et le FLN est sans doute actuellement un des partis politiques les plus honnis de la rue algérienne.
G.D. : Le feu est donc la langue dérobée, « déterritorialisée », pour en appeler à ce concept deleuzien, mais la voie semblait étroite et périlleuse… J’aimerais que vous nous disiez quelques mots sur l’acte créateur dibien et ce cheminement littéraire qui fut le sien…
L’acte créateur dibien réside justement dans cette opération de déterritorialisation, par laquelle Dib décontextualise la langue française pour la recontextualiser dans l’imaginaire algérien. C’est d’ailleurs ce renversement magnifique des perspectives littéraires qui nous frappe dans les premières œuvres de Dib, notamment dans La Grande maison (1952) et L’Incendie (1954). La déterritorialisation de la langue a permis à l’Homme algérien d’exister dans le roman et de porter un regard sur le colonisateur et la situation coloniale, après qu’il a longtemps été confondu sous les invariables dénominations de la littérature coloniale : l’Arabe, Fatima, Aïcha… Mais l’originalité de l’écriture dibienne à partir de ce mouvement de déterritorialisation est qu’elle a permis l’émergence de l’Homme algérien dans le champ littéraire universel, mais a aussi dévoilé les limites du discours révolutionnaire anticolonial en mettant au jour sa reterritorialisation dans le discours univoque du FLN post-indépendance, qui s’institua parti unique.
G.D. : Par-delà la venue à l’existence de l’Homme algérien dans la littérature francophone qu’a permis l’acte créateur dibien, il semble que la question du devenir soit en outre une question tout à fait fondamentale, au sein de l’œuvre.
Oui. Le concept de « devenir », tel qu’on le retrouve dans l’écriture dibienne, est intimement lié à l’idée de plurivocité du langage littéraire. C’est le devenir qui permet l’actualisation de l’idée de la déterritorialisation dans une perspective historique. Contrairement à l’idée qui se répand de plus en plus de nos jours, l’Histoire n’est pas un bloc monolithique, et moins encore l’addition linéaire de plusieurs blocs. C’est une conception erronée de l’Histoire. Et il ne suffit pas de soustraire un bloc de l’Histoire d’une nation ou d’un peuple pour retrouver un moment idéalisé de l’Histoire de cette nation. Pour parler de la colonisation, par exemple, il ne suffirait pas de soustraire la période coloniale de l’Histoire de France pour retrouver la France des Lumières et des droits de l’Homme. L’idée de devenir permet justement d’échapper à ce figement dans une certaine conception de l’Histoire. L’Homme algérien de la période coloniale n’est pas l’Homme algérien de l’Algérie indépendante, et encore moins le résultat de l’addition de l’Homme de la période coloniale plus l’Homme de la période post-coloniale. Il est à la fois l’Homme de toutes ces périodes et un tout autre Homme. Et cela est valable pour l’Homme français, comme pour l’humanité tout entière.
G.D. : Comment vous est venue l’idée de cette « rencontre » ?
Dib rencontre Deleuze sur le plan des idées. D’ailleurs, l’idée de la rencontre a un sens particulier chez Deleuze. Et sur le plan des idées, Dib et Deleuze se rencontrent sur un point essentiel : l’idée du devenir révolutionnaire. L’une des idées phare de la philosophie de Deleuze est celle de la liberté, ou pour le dire plus clairement, de la libération. Et de même, une des thématiques majeures que l’on retrouve partout dans l’œuvre dibienne est celle de la quête émancipatrice, à commencer par celle du petit Omar, dans les trois romans de ce que l’on a dénommé « la trilogie Algérie », qui suit un cheminement initiatique passant par une interrogation profonde sur la condition de l’homme et son rapport à la liberté et aux mouvements émancipateurs. Et c’est là où réside l’intérêt de la rencontre de Dib avec Deleuze ; de l’idée du devenir avec celle de la quête ; de la déterritorialisation-reterritorialisation qui reflètent les trajectoires des protagonistes des romans dibiens. Et même sur un plan beaucoup plus large, la grande thématique de l’œuvre dibienne, dont il n’a jamais pu se départir d’ailleurs, et qui est l’Algérie – ou plutôt le devenir de l’Algérie –, n’est pas sans lien avec la philosophie deleuzienne et sa conception de la création littéraire, si l’on s’en réfère à son idée du « devenir mineur », que l’on retrouve dans l’ouvrage qu’il a coécrit avec Félix Guattari : Kafka, pour une littérature mineure (1975).
G.D. : Comment vous est venue l’idée de « déterritorialiser » votre texte de cet espace qui aurait pu être celui d’un essai universitaire, le territorialisant dans l’espace littéraire ?
J’apprécie votre formulation lorsque vous parlez de « déterritorialisation » de mon texte de l’espace académique vers l’édition grand public, car elle recouvre une grande partie de ma démarche. Il me semble qu’une lecture attentive, voire amoureuse, d’une œuvre, ne peut que déboucher sur une réécriture en écho qui est une forme de transmission reconnaissante. Je pense qu’il y a plusieurs manières de lire, et en ce qui me concerne, la meilleure d’entre elles serait l’écriture. Dans la préface de La nuit sauvage, Dib lui-même parlait du « lecteur inconnu » destinataire de ses œuvres.
G.D. : Ce que vous exprimez là laisse à penser à une hagiographie qui ne serait qu’un écho de plus donné à une œuvre féconde… Mais ne doit-on pas comprendre, lorsque vous évoquez les effets libérateurs de l’œuvre par ailleurs, que votre acte d’écriture en propre est recréation émancipatrice ? Et si toutefois c’est cela que l’on peut y lire, ne serait- ce pas là le meilleur hommage que l’on puisse rendre au cheminement littéraire de Mohammed Dib ?
Par la forme même de mon texte, il s’agissait pour moi d’échapper aux sentiers battus des essais académiques qui par ailleurs ont tout à fait leur place, mais qui ne m’inspirent pas, par le fait qu’ils se limitent au champ universitaire. Or, en ce qui me concerne, j’essaie d’aborder l’œuvre de Mohammed Dib, la pensée de Gilles Deleuze, et, de manière générale, la production intellectuelle en tant qu’écrivain. Je pense que la meilleure manière de rendre hommage à Dib, à Deleuze et à tous les intellectuels et autres grands hommes qui ont marqué l’humanité est de poursuivre et de prolonger leur engagement, justement par la création. C’est d’ailleurs Nietzsche qui disait qu’il ne voulait pas de disciple, mais des hommes émancipés. Et Le voleur de feu, en ce qui me concerne, est une étape importante de mon cheminement intellectuel émancipateur. Il est d’ailleurs très intéressant de noter que Deleuze lui-même avait commencé en tant que commentateur, l’un de ses textes m’ayant durablement marqué étant Proust et les signes (1964).
G.D. : Pour clore cet entretien et en écho, à mon tour, je citerai deux extraits de votre livre, livre que je reçois comme un acte littéraire fondateur ; comme une anthropologie politique en mouvement que porte une langue poétique magnifique. Ces extraits me paraissent parfaitement illustrer votre propos : « À ces parias qui souillent le langage, tirer le chapeau. » ; « Là où l’art commence à poindre, la soumission s’étiole. ».
Merci à vous, Karim Nait Ouslimane.
Entretien conduit le 8 septembre 2022 par Guylian Dai
« Le voleur de feu – Dib rencontre Deleuze » de Karim Nait Ouslimane, à paraître le 7 octobre 2022 aux éditions Fables fertiles, coll. Luttéraires » (ISBN 978-2-493872-03-6, 108 pages, 15,50€)

