
« On ne parle jamais que de soi » (François Mauriac)
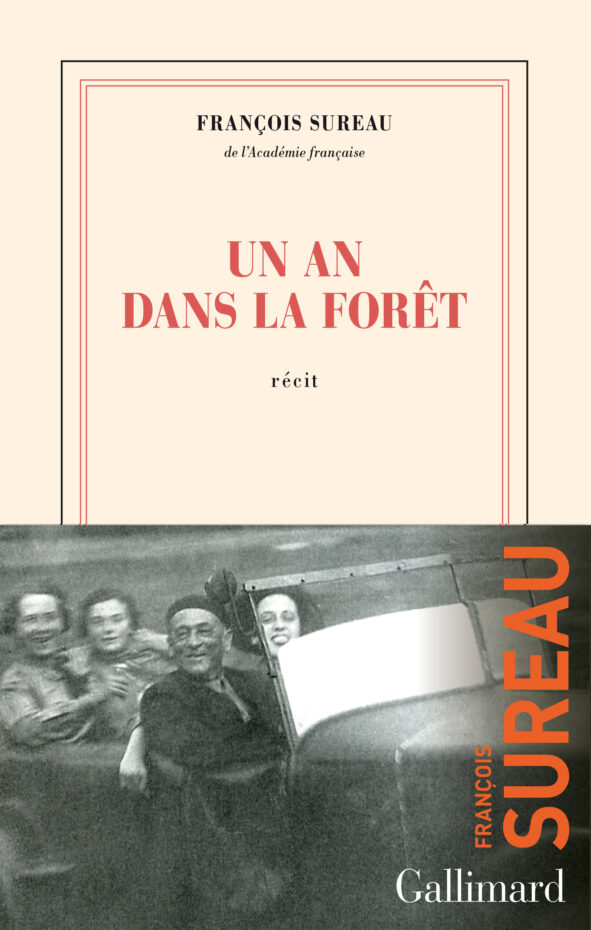 Dès les premières pages de son nouveau livre Un an dans la forêt (Gallimard, 2022), François Sureau de l’Académie française écrit cette phrase qui en dit long sur sa démarche d’écriture, sur le genre littéraire qu’il revisite, en naviguant avec élégance entre le récit historique et le récit de soi : « La biographie en dit plus long sur le biographe que sur l’objet de la biographie, surtout lorsqu’il s’agit d’amour ».
Dès les premières pages de son nouveau livre Un an dans la forêt (Gallimard, 2022), François Sureau de l’Académie française écrit cette phrase qui en dit long sur sa démarche d’écriture, sur le genre littéraire qu’il revisite, en naviguant avec élégance entre le récit historique et le récit de soi : « La biographie en dit plus long sur le biographe que sur l’objet de la biographie, surtout lorsqu’il s’agit d’amour ».
Rien d’étonnant en réalité pour un auteur qui avait déjà annoncé son attachement à ses poètes préférés, dont celui pour l’auteur des Alcools dans Ma vie avec Apollinaire qu’il avait publié un an auparavant chez le même éditeur.
Quant à son nouveau livre, il suffit de pencher l’oreille, pour s’apercevoir que son intitulé n’est qu’un rappel en filigrane au titre prémonitoire que Blaise Cendrars – encore un poète qu’il aime – avait donné à son esquisse autobiographique, publiée en 1929, Une nuit dans la forêt. Si François Sureau prolonge la durée de son séjour littéraire, c’est qu’il a ses raisons et qu’il va les détailler tout au long de son récit, rejoignant au fond ce qu’il avait déjà dit et qu’il n’hésitera à répéter, en l’élevant au rang de credo littéraire : « J’ai toujours reculé devant la biographie des artistes. Je n’aime pas l’indiscrétion qui s’y déploie ». Il rajoute : « Elle n’explique pas l’œuvre, et décrit, en dehors d’elle, un homme ou une femme que personne ne peut connaître, le biographe moins que tout autre ».
Ce préambule suffit à rendre compte de ce que ce livre comporte comme nécessité de double lecture, dans une cohabitation surprenante de réel et de mémoire, d’amitié et de fraternité.
Blaise Cendrars avait été invité en 1938 par l’exploratrice Élisabeth Prévost dans les Ardennes. François Sureau nous parlera quant à lui de ses Ardennes dont les souvenirs qu’il porte semblaient endormis sous « les glaces de la mémoire » pour l’aider à évoquer les forêts dont il n’oublie pas de rappeler « l’épaisseur immobile de tunnels d’arbres aux perspectives repoussées, à chaque pas, vers une découverte, un secret qui se dérobent ». Il porte ces vestiges depuis son arrivée depuis Saumur en 1978 « au poste de garde du 12e régiment de chasseurs, boulevard Fabert à Sedan ».
La Légion étrangère est une affaire d’hommes qui les unit, et on se souvient bien entendu de la photo de Cendrars posant en uniforme de légionnaire en 1916, peu de temps après son amputation.
Mais au moment où Cendrars rencontre Elisabeth Prévost, il a cinquante et un ans, il est « un homme malheureux et incertain », malgré sa carrière littéraire qui l’avait rendu célèbre. La Légende de Novgorode ou Les Pâques à New York sont là pour porter témoignage.
Elisabeth était l’enfant unique d’une famille riche qui avait fait fortune dans la métallurgie. Elle avait été élevée dans le pavillon des Aiguillettes, dans les Ardennes, pas loin de Charleville-Mézières, la ville de Rimbaud. On dit que l’un de ses grands oncles était allé en classe avec le poète.
Par son engagement en 1914, dans la Légion étrangère Cendrars veut aller « jusqu’au bout de lui-même ». L’amputation du bras droit après l’assaut de la ferme Navarin, le 28 septembre 1915, lui donne la mesure de la violence de la guerre. Il sera meurtri et partira en 1924, pour le Brésil et publiera en 1926 Moravagine, le roman dont on dira que son personnage central n’est autre que double du poète converti à l’écriture du roman.
En 1936, au moment de sa rencontre avec Cendrars, Elisabeth ne sait presque rien de lui. D’elle, on sait « qu’elle n’a quitté sa forêt, ses chevaux, le fusil offert par son père, que pour un pensionnat de dominicaines et deux collèges privés, l’un en Angleterre, l’autre en Italie. Puis elle a choisi l’aventure, au point que ses amis ne l’appelaient pas autrement que Mozambique ». Ce portrait suffit pour nous donner une idée de sa personnalité et de sa beauté physique : « Une jeune fille aux grands yeux d’un bleu profond de saphir. Une beauté, une force de la nature ».
La rencontre entre Cendrars et Elisabeth Prévost a lieu dans le petit hôtel de l’Alma, par l’entremise de Pierre Pucheu. Cendrars en parlera dans L’homme foudroyé tandis qu’Elisabeth le fera dans un livre intitulé Madame mon copain, édité par Monique Chefdor en 1997. Habitée par une sainte innocence, elle ne connaît presque rien de l’œuvre de son interlocuteur. Elle dira : « Je n’avais pas assez lu pour savoir devant qui j’étais. »
On connait peu de choses sur ce qui se passa ensuite entre eux, mais l’impression qu’il provoque à la jeune femme est intense : « Pour Élisabeth, au premier abord, son visage sur lequel elle ne pouvait mettre aucun âge représentait la force ». Cela devait impressionner cette femme qui, à vingt-sept ans, avait déjà traversé plusieurs fois l’Afrique. Mais ce qui est sûr c’est que ce séjour ardennais a dû permettre à Cendrars de reprendre goût à la vie et à la littérature. Le reste compte peu.
Mais revenons à ses Ardennes et à ses forêts que François Sureau traverse quant à lui dans les années ’78, à ses voyages de la Gare de l’Est jusqu’à la garnison de Sedan et de Charleville. De sa retraite, il nous dira comme un écho sans doute aux ressentis de Cendrars « Cette retraite de la forêt, comme celle de la montagne, échappe pourtant aux outrages. J’en ai aimé les saisons, et d’abord l’été, dans lequel elle m’est apparue ».
On peut imaginer sans peine que la nostalgie profonde qui traverse le cœur de François Sureau est peut-être celle qui répond au mieux au cœur désespéré de Cendrars, le légionnaire amputé et l’écrivain découragé qu’il était quarante ans plutôt et qui saura réinventer sa vie dans l’Homme foudroyé.
Réinventer sa vie – voici le point culminant, le sommet. C’est sans doute ce détail qui l’unit à son poète préféré, et c’est aussi pour cela qu’il reprend à son compte cette déclaration d’Elisabeth : « À la fin de ses brefs souvenirs on peut lire : « Blaise Cendrars fut, dans ma vie, et pour toute ma vie, l’être qui marqua le plus mon cœur et mon esprit. »
Dan Burcea
Photo : © F.Mantovani – éditions Gallimard
François Sureau de l’Académie française, Un an dans la forêt, Éditions Gallimard, novembre 2022, 96 pages.

