
On ne peut pas parler de l’écrivaine roumano-québécoise Felicia Mihali sans faire référence à la série d’aventures qui ont façonné sa vie : aventure de l’exil, aventure littéraire et multilinguistique, aventure de traductrice et d’éditrice engagée et tout simplement aventure d’une femme assoiffée de vivre pleinement ses nombreux projets dont un la préoccupe spécialement, celui du retour dans son pays d’origine et à l’écriture dans sa langue maternelle.
Loin de se voir engloutie dans cette multitude de labeurs, et heureuse de croquer sa vie à pleines dents, Felicia Mihali se sent heureuse dans ce qu’elle entreprend et ne manque pas d’idées et de nouveaux projets.
Bonjour Felicia, heureux de pouvoir vous interroger à nouveau pour le grand plaisir des lecteurs de Lettres Capitales qui connaissent déjà votre travail d’éditrice, ayant eu l’occasion de lire notre entretien concernant votre maison d’édition Hashtag[1]. C’est de vos multiples casquettes que je vous invite de parler cette fois-ci, et premièrement de celle d’autrice. Alors que vous avez débuté en littérature dans votre langue maternelle, le roumain, vous avez ajouté aujourd’hui comme langues d’écriture le français et l’anglais. Comment vous sentez-vous, munie d’autant de moyens d’expression ? Qu’est-ce qu’une langue étrangère pour vous et, d’ailleurs, nommez-vous aujourd’hui le français et l’anglais comme telles ?
Malgré le fait que je travaille présentement en trois langues et que j’en ai appris deux autres qui sont d’ores et déjà oubliées, le chinois et le néerlandais, disons que je ne me considère pas du tout une polyglotte. Je pense qu’un.e polyglotte est quelqu’un.e d’extrêmement doué.e pour les langues, et qui est de plus animé.e par une grande passion de l’apprentissage. Loin de moi tout cela. J’ai toujours été une étudiante médiocre à tous les égards et surtout en langues étrangères. Je travaille en plusieurs langues seulement parce que l’exil m’en a obligée. C’était le besoin impératif d’évoluer, de me diversifier. Or, cela passe souvent par les langues. Mais ce va-et-vient a joué peut-être en ma faveur. Je n’ai jamais saisi la beauté de la langue en soi, mais ce qu’elle peut transmettre et peut nous enseigner : l’histoire, la politique, l’art. Je ne fais pas une étude de langues en soi, mais je les utilise comme n’importe quels outils de travail et de communication. Mon registre d’écriture favori et celui journalistique : on ratisse large tout en économisant les mots. Le monde est trop vaste pour passer sa vie à étudier le grand ongle de tel ou tel personnage littéraire. J’opte plutôt pour l’encyclopédisme, pour l’accumulation des connaissances hétéroclites et pour la libération du carcan européocentriste. Après l’expérience coloniale, on voit combien l’Europe est humaniste et égalitaire chez elle et combien injuste, cruelle, méprisante reste ailleurs. Au Canada, j’ai appris à valoriser certains de mes désavantages. C’est un pays qui apprécie la franchise, la nouveauté, et où les femmes jouissent de plus de confiance qu’ailleurs. C’est aussi un pays officiellement bilingue, mais en réalité multilingue, vu l’immigration massive. Je ne sais pas s’il y a beaucoup de pays au monde qui m’auraient donné la chance de changer trois fois de langue de création et de carrière. Pour réussir il faut être un peu doué — ou fou — si vous voulez, mais le contexte doit aider aussi, ainsi que les structures étatiques, sociales, culturelles. Dans toute cette Babel identitaire, le roumain reste ma langue maternelle. Mais quand il s’agit de création, de traduction, d’édition, les trois se situent au même niveau affectif et cognitif. Il est vrai que le vocabulaire roumain est plus riche, mais celui français ou anglais est plus adéquat, plus technique, plus efficace. Cela tient aussi du bagage culturel qui accompagne ces langues. Le roumain est peu soumis aux règles, à l’Académie. Je me rappelle la difficulté de faire introduire dans la langue la forme « sunt » du verbe être à la 3e personne du pluriel ainsi que la lettre « Î » écrit avec A. Dans les autres langues, l’Académie fait régulièrement un travail de mis à jour au niveau linguistique, nouvelle orthographe, les accords, les concordances, pour tenir le pas avec les changements sociaux, culturels, etc., et pour faciliter la tâche des locuteurs. Les professeurs en parlent dans les classes à partir des plus petits, les journaux et la littérature adoptent les nouvelles mesures et les gens doivent petit à petit embrasser la nouvelle grammaire. Le mouvement #metoo a aussi introduit au Québec une nouvelle règle, celle de la double orthographe lorsqu’il s’agit de décrire une personne. Nous ne sommes plus, heureusement, à l’époque où le masculin l’emportait sur le féminin. Le féminin n’est pas sous-entendu, il doit être là. Voilà pourquoi il faut apprendre à travailler avec les langues et surtout apprendre à être conscient des différences et de les exploiter. Il y a des avantages à cela, des avantages qui font peur, car les gens sont loin de comprendre la beauté et surtout la force de ce va-et-vient entre langues et cultures.
En regardant votre bibliographie, on remarque le chemin parcouru depuis votre premier livre. Ce serait intéressant de nous parler des grands thèmes de vos romans, de ce que la critique aime appeler la ligne thématique directrice d’une œuvre, l’unité des personnages, etc. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet.
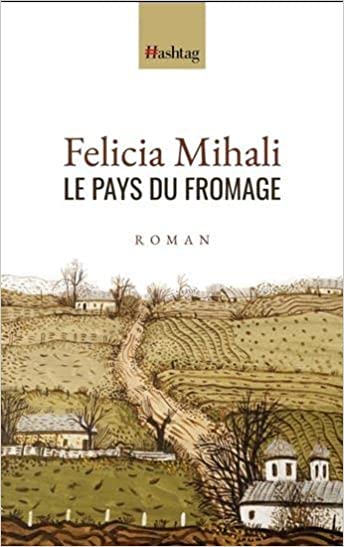 On peut dire qu’il y a un grand écart au niveau des thèmes et surtout du style entre Le pays du fromage, mon premier roman, et Une nuit d’amour à Iqaluit, mon plus récent, publié simultanément en anglais et en français au printemps 2021. Comme chaque écrivain, qui reste un artisan, j’ai perfectionné mes outils, mon savoir-faire. Je suis aussi devenue plus consciente des modes, de la relation de l’écrivain avec son public, du travail éditorial aussi qui se fait derrière un bon texte. J’étais loin de tout ça au début, malheureusement, et il n’y avait personne autour pour m’en parler. Un.e primo-romancièr.e devrait être accompagné.e plus sérieusement et plus minutieusement qu’un.e auteur.e établié.e. En même temps, il y a des thèmes récurrents dans mes écrits : le poids de la tradition, la priorité de la tribu avant l’individu, la condition de la femme dont le destin est encore redevable à la famille, au voisinage. Dans mes livres, les femmes sont tout d’abord leurs propres victimes : victimes de leur éducation, leurs croyances, leurs peurs, leurs complexes. J’ai grandi dans une société qui nous a enseigné de refuser les défis ainsi que la peur de trop vouloir, car cela contrevient à la traduction qui dit qu’une bonne femme est une femme de ménage d’abord et avant tout. Mes personnages ont de la difficulté à se libérer du carcan familial lorsqu’il devient une cage, à apprendre à dire non, à réclamer, à imposer, à prendre. En fin de compte, si on considère ce thème de la femme qui a peur d’être heureuse, on se rend compte qu’entre Le pays du fromage écrit à l’époque où j’étais journaliste à l’Évènement du jour, et Une nuit d’amour à Iqaluit, écrit dans au Cercle polaire, il n’y a pas une si grande différence que ça.
On peut dire qu’il y a un grand écart au niveau des thèmes et surtout du style entre Le pays du fromage, mon premier roman, et Une nuit d’amour à Iqaluit, mon plus récent, publié simultanément en anglais et en français au printemps 2021. Comme chaque écrivain, qui reste un artisan, j’ai perfectionné mes outils, mon savoir-faire. Je suis aussi devenue plus consciente des modes, de la relation de l’écrivain avec son public, du travail éditorial aussi qui se fait derrière un bon texte. J’étais loin de tout ça au début, malheureusement, et il n’y avait personne autour pour m’en parler. Un.e primo-romancièr.e devrait être accompagné.e plus sérieusement et plus minutieusement qu’un.e auteur.e établié.e. En même temps, il y a des thèmes récurrents dans mes écrits : le poids de la tradition, la priorité de la tribu avant l’individu, la condition de la femme dont le destin est encore redevable à la famille, au voisinage. Dans mes livres, les femmes sont tout d’abord leurs propres victimes : victimes de leur éducation, leurs croyances, leurs peurs, leurs complexes. J’ai grandi dans une société qui nous a enseigné de refuser les défis ainsi que la peur de trop vouloir, car cela contrevient à la traduction qui dit qu’une bonne femme est une femme de ménage d’abord et avant tout. Mes personnages ont de la difficulté à se libérer du carcan familial lorsqu’il devient une cage, à apprendre à dire non, à réclamer, à imposer, à prendre. En fin de compte, si on considère ce thème de la femme qui a peur d’être heureuse, on se rend compte qu’entre Le pays du fromage écrit à l’époque où j’étais journaliste à l’Évènement du jour, et Une nuit d’amour à Iqaluit, écrit dans au Cercle polaire, il n’y a pas une si grande différence que ça.
D’où puisez-vous vos sujets d’inspiration dans votre écriture — ancienne ou plus récente ?
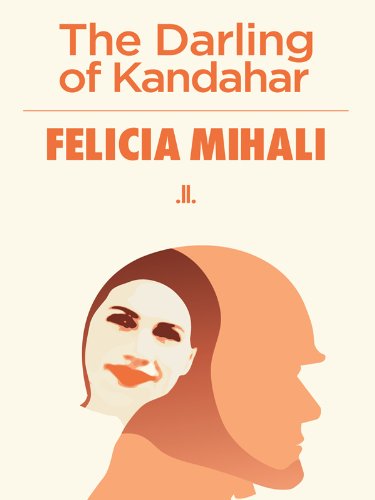
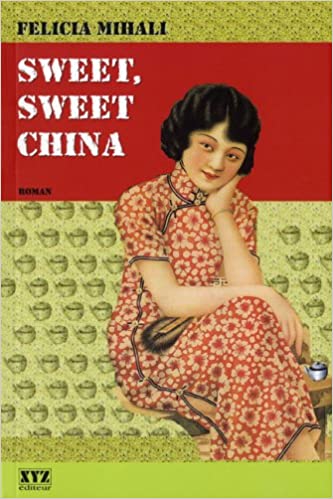
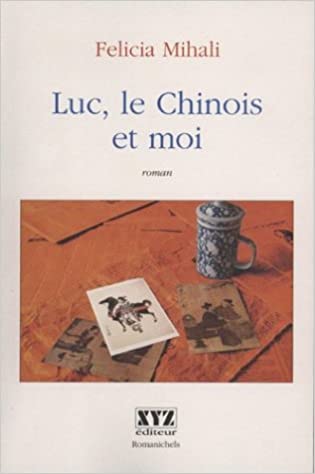 Ma grande source d’inspiration autant pour mes livres écrits en roumain, français ou anglais est ma vie avec tout ce qui la traverse : des gens, des livres, des films, des études, ma maitrise en histoire, celle en littérature aussi, mon voyage en Chine, le Grand nord, mes mariages et mes séparations, ma profession d’enseignante. Tout peut couler dans mes livres d’une manière plus ou moins reconnaissable. Je reste une journaliste dans mes instincts et pratiques. Mon expérience primaire et une forte note autobiographique sont facilement détectables dans des romans comme Le pays du fromage, Dina, Confession pour un ordinateur, Luc, le Chinois et moi, A Second Chance. Il y a aussi le côté livresque de mes écrits, où l’histoire, les mythes, la littérature elle-même sont à la base des livres comme La reine et le soldat, l’Enlèvement de Sabina, The Darling of Kandahar. Je joue parfois avec la reprise de certains thèmes comme c’est le cas du roman Une nuit d’amour à Iqaluit qui est une sorte de deuxième volume du livre The Darling of Kandahar, car il reprend le même personnage Irina, dix ans après les évènements qui ont troublé sa vie. Malgré le fait que certains de mes livres peuvent être placés quelque part sur la carte du monde et sur la ligne chronologique, j’évite de dater les sujets en excès en espérant que la vie des personnages et leur vécu garderont leur longévité. Des thèmes comme la solitude, l’échec, la fragilité de l’âme restent un langage atemporel et j’espère qu’il saura parler aussi à mes jeunes lecteurs et lectrices.
Ma grande source d’inspiration autant pour mes livres écrits en roumain, français ou anglais est ma vie avec tout ce qui la traverse : des gens, des livres, des films, des études, ma maitrise en histoire, celle en littérature aussi, mon voyage en Chine, le Grand nord, mes mariages et mes séparations, ma profession d’enseignante. Tout peut couler dans mes livres d’une manière plus ou moins reconnaissable. Je reste une journaliste dans mes instincts et pratiques. Mon expérience primaire et une forte note autobiographique sont facilement détectables dans des romans comme Le pays du fromage, Dina, Confession pour un ordinateur, Luc, le Chinois et moi, A Second Chance. Il y a aussi le côté livresque de mes écrits, où l’histoire, les mythes, la littérature elle-même sont à la base des livres comme La reine et le soldat, l’Enlèvement de Sabina, The Darling of Kandahar. Je joue parfois avec la reprise de certains thèmes comme c’est le cas du roman Une nuit d’amour à Iqaluit qui est une sorte de deuxième volume du livre The Darling of Kandahar, car il reprend le même personnage Irina, dix ans après les évènements qui ont troublé sa vie. Malgré le fait que certains de mes livres peuvent être placés quelque part sur la carte du monde et sur la ligne chronologique, j’évite de dater les sujets en excès en espérant que la vie des personnages et leur vécu garderont leur longévité. Des thèmes comme la solitude, l’échec, la fragilité de l’âme restent un langage atemporel et j’espère qu’il saura parler aussi à mes jeunes lecteurs et lectrices.
Récemment, la maison d’édition Vremea de Bucarest a publié la version roumaine auto-traduite de votre roman Dina. Avec une forte dose de suspense, ce roman parle davantage de la condition de la femme et de son emprise par la société patriarcale. Ce thème traverse votre œuvre littéraire. Comment expliquez-vous cette omniprésence thématique chez-vous ?
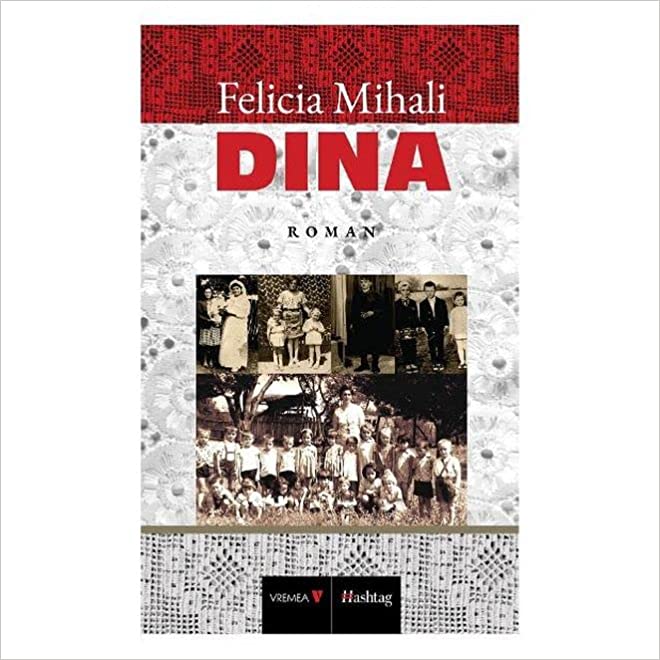 Je pense qu’une écrivaine qui parle des femmes n’est pas chose surprenante. Et si les femmes dont elles parlent sont malheureuses ou victimes des hommes, encore une fois, ce n’est pas surprenant du tout. Je pense que c’est la nature même de la littérature de parler des drames dans un désir secret de les exorciser. C’est le noyau même du théâtre grec, qui est à la base du canon occidental. Les règles d’Aristote restent aussi valables en dramaturgie que dans l’art du roman. Médée, Cassandre, Andromaque sont des personnages au destin exceptionnel, des femmes fortes, mais qui craquent sous la pression des forces plus grandes qu’elle : la famille, les dieux, la tradition. Avec mes humbles pouvoirs, j’ai voulu que Dina incarne une telle héroïne tragique qui lutte avec la tradition, le pouvoir de l’homme pour finalement cesser de s’opposer à son destin. À 40 ans, elle se reconnait vaincue, à tort évidemment. Sauf qu’une vie qui brûle comme une chandelle à deux bouts peut être extrêmement épuisante, surtout dans un pays comme la Roumanie qui ne donne pas de répit aux gens. La vie au quotidien même peut être extrêmement épuisante, impitoyable. En 2006 lorsque j’ai commencé sa rédaction, ce n’était nullement dans l’intention de faire un manifeste militant féministe. C’était l’histoire d’une femme que je connaissais, histoire qui a été expulsée des tréfonds de ma mémoire par la lecture d’un autre livre. Mais je pense que la lecture de Dina devrait pousser à la réflexion en Roumanie, là où les femmes ne jouissent pas de la reconnaissance qu’elles méritent. Plus grave encore, elles n’ont pas la liberté de choix qui caractérise leurs pairs mâles. J’ai eu des échos dernièrement que ce genre de femmes abusées, ce n’est plus la norme en Roumanie. Sauf que le nombre de féminicides, les abus ainsi que l’attitude des gens face à la dénonciation des violences prouvent qu’on est loin d’avoir fait de grands progrès. La situation des femmes ne peut pas s’améliorer autrement que par le travail acharné de sensibilisation, et surtout par la contribution des jeunes femmes qui vivent une autre réalité que celle de ma génération, et c’est tant mieux. Si on accepte que la vie des femmes à l’ouest est meilleure que celle des femmes d’ailleurs sur la planète, alors il faut accepter que le féminisme a fait son travail. En Roumanie, les femmes commencent toujours leur militantisme pour la cause des femmes avec une excuse : « je ne suis pas féministe. » Mon avis est qu’elles devraient dire le contraire : toute femme est féministe, car son travail sert à la cause de tant de femmes qui n’ont pas de voix publiques, mais qui ont tellement besoin de support. Il ne faut jamais oublier que la vie des vieilles femmes au village est loin de celle des jeunes femmes dans les grandes villes. Tout ce qu’on fait, nous comme artistes, écrivaines, musiciennes, peut leur servir.
Je pense qu’une écrivaine qui parle des femmes n’est pas chose surprenante. Et si les femmes dont elles parlent sont malheureuses ou victimes des hommes, encore une fois, ce n’est pas surprenant du tout. Je pense que c’est la nature même de la littérature de parler des drames dans un désir secret de les exorciser. C’est le noyau même du théâtre grec, qui est à la base du canon occidental. Les règles d’Aristote restent aussi valables en dramaturgie que dans l’art du roman. Médée, Cassandre, Andromaque sont des personnages au destin exceptionnel, des femmes fortes, mais qui craquent sous la pression des forces plus grandes qu’elle : la famille, les dieux, la tradition. Avec mes humbles pouvoirs, j’ai voulu que Dina incarne une telle héroïne tragique qui lutte avec la tradition, le pouvoir de l’homme pour finalement cesser de s’opposer à son destin. À 40 ans, elle se reconnait vaincue, à tort évidemment. Sauf qu’une vie qui brûle comme une chandelle à deux bouts peut être extrêmement épuisante, surtout dans un pays comme la Roumanie qui ne donne pas de répit aux gens. La vie au quotidien même peut être extrêmement épuisante, impitoyable. En 2006 lorsque j’ai commencé sa rédaction, ce n’était nullement dans l’intention de faire un manifeste militant féministe. C’était l’histoire d’une femme que je connaissais, histoire qui a été expulsée des tréfonds de ma mémoire par la lecture d’un autre livre. Mais je pense que la lecture de Dina devrait pousser à la réflexion en Roumanie, là où les femmes ne jouissent pas de la reconnaissance qu’elles méritent. Plus grave encore, elles n’ont pas la liberté de choix qui caractérise leurs pairs mâles. J’ai eu des échos dernièrement que ce genre de femmes abusées, ce n’est plus la norme en Roumanie. Sauf que le nombre de féminicides, les abus ainsi que l’attitude des gens face à la dénonciation des violences prouvent qu’on est loin d’avoir fait de grands progrès. La situation des femmes ne peut pas s’améliorer autrement que par le travail acharné de sensibilisation, et surtout par la contribution des jeunes femmes qui vivent une autre réalité que celle de ma génération, et c’est tant mieux. Si on accepte que la vie des femmes à l’ouest est meilleure que celle des femmes d’ailleurs sur la planète, alors il faut accepter que le féminisme a fait son travail. En Roumanie, les femmes commencent toujours leur militantisme pour la cause des femmes avec une excuse : « je ne suis pas féministe. » Mon avis est qu’elles devraient dire le contraire : toute femme est féministe, car son travail sert à la cause de tant de femmes qui n’ont pas de voix publiques, mais qui ont tellement besoin de support. Il ne faut jamais oublier que la vie des vieilles femmes au village est loin de celle des jeunes femmes dans les grandes villes. Tout ce qu’on fait, nous comme artistes, écrivaines, musiciennes, peut leur servir.
Une autre chose tout aussi intéressante — liée bien entendu à votre capacité multilinguistique — est la traduction faite par vous-même de certains de vos romans. Ce n’est même pas de la traduction, à mon sens, c’est purement et simplement de la réécriture. Qu’en pensez-vous ?
Oui, c’est le terme le plus approprié pour décrire ce que je fais. Mais je me demande si ce n’est pas aussi le cas pour toute autre traduction. Moi aussi je fais très attention de garder le sens, la structure, le rythme, le registre de la version originale. Pour mettre le terme « traduction » sur un livre, il y a des règles qu’il faut absolument respecter. La traduction doit correspondre autant que fidèlement possible à l’original. Tout comme la traduction, l’autotraduction est confrontée au défi de présenter au public une version libre des traces de l’original, d’éviter les lieux communs, d’être surprenante, fraîche, de faire des choix de mots qui correspondent plutôt à la nouvelle langue en trahissant un peu l’original. Je pense que toute bonne traduction contient une certaine dose de réécriture.
Permettez-moi d’aborder le sujet de votre expérience d’exilée. Elle vous a sans doute beaucoup appris sur la manière de vivre l’ailleurs. Quelles ont été les choses qui vous ont le plus marquée positivement ? Et les choses les plus douloureuses ?
J’ai émigré au Canada, plus précisément au Québec, en 2000. J’ai fait des études, deux maitrises et un baccalauréat en études anglaises, j’ai enseigné, j’ai écrit en deux langues, j’ai fondé une maison d’édition. Le bilan est positif et je pense que malgré les difficultés, j’ai fait un bon choix de quitter la Roumanie sans jamais l’abandonner ou la maudire. Mon pays d’origine est comme la maison de mes parents. Elle est toujours là, l’endroit où j’ai appris la plupart des choses qui me définissent comme individu. Mais ce qui m’a le plus aidée dans mon nouveau pays sont surtout les structures démocratiques enracinées de longue date, le respect des lois, la dynamique sociale. Par leur nature, ils sont faits de manière à servir tout le monde, de la même manière. Ça dépend toujours de chaque individu la manière de les utiliser. J’ai plusieurs fois dans ma vie eu le sentiment d’être minimisée et discriminée. Et ce n’était pas seulement une impression. En même temps je peux dire la même chose de mon pays d’origine, où je n’ai pas eu de support de nulle part. Mais je n’ai jamais cessé de me battre. Je n’ai jamais croisé les bras. Lorsque ma carrière en français commençait à s’essouffler, car il y a toujours une mode en littérature, j’ai commencé à écrire en anglais. Avec une nouvelle langue, il y a eu soudainement du renouveau dans mon style, mes thèmes, mon audience. Le changement m’a rajeuni en plan littéraire. Lorsque ma carrière littéraire a pris un peu de recul, car la jeune génération est toujours plus intéressante que l’ancienne, j’ai fondé une maison d’édition pour publier des livres que j’aime, lancer des auteur.es que j’admire et qui me semblent marginalisé.es, sinon carrément discriminé.es par l’établissement. C’est la carrière d’éditrice qui m’a réconcilié le plus avec le Canada. En tant que femme d’affaires, et j’ose me nommer ainsi, car l’édition a plus de rapport avec l’argent qu’avec la littérature, j’ai dû circuler dans d’autres cercles et apprivoiser d’autres compétences. J’ai alors compris que pour les libraires, les diffuseurs, pour le Ministère de la culture qui a dû nous octroyer le certificat d’agrément, pour les conseils des arts qui nous donnent du financement, moi personnellement je ne suis qu’un nombre. Je ne suis pas une femme migrante d’un certain âge et avec un nom impossible à prononcer. Si je réponds aux critères de qualité, si je fais correctement mes états financiers et paie mes taxes, alors je bénéfice de tous les avantages que mes collègues québécois pures laines. La grande liberté en affaires donne à tout le monde les mêmes chances ou à peu près, car je ne compte pas ceux qui héritent des fortunes ou ont des relations. Quelque part, tout le monde part de rien et brava pour ceux qui ont eu des ancêtres avec le sens des affaires. Moi, je suis partie de zéro. Je pense que ce qui m’a guidé est le fait d’avoir enseigné un peu l’histoire du Canada, un pays fondé sur la doctrine protestante de la richesse qui domine l’esprit nord-Américain. La réussite est la preuve du travail bien fait, de l’acharnement. Je crois en cette philosophie et si demain j’échoue je ne pourrais malheureusement accuser personne sauf moi-même.
J’ai appris que vous étiez de plus en plus présente à Bucarest. Le désir du retour au pays y serait pour quelque chose ? Avez-vous l’intention de revenir du Québec où vous vivez actuellement ?
Lorsque j’ai publié Le pays du fromage en 1999, un de mes professeurs d’université m’a dit en blaguant : « Veut, veut pas, tu es entrée dans la littérature roumaine ». J’ai débuté comme écrivaine roumaine et tout ce qui me reste à faire est de continuer cette carrière, de l’enrichir, de la compléter. Tout comme les livres écris en roumain ont été traduits et publiés au Canada, c’est mon devoir de faire le chemin de retour, traduire les livres français et anglais en roumain et les ajouter à mes premiers œuvres. Ces livres appartiennent tous à ma carrière littéraire, au même corpus d’idées. Voilà pourquoi je prépare mon retour au pays au niveau littéraire, sans jamais abandonner ce que j’ai bâti au Québec et qui connait maintenant une belle renaissance. Je vais rester une écrivaine avec plusieurs maisons, et qui peut voyager, à mon grand bonheur, entre trois langues et trois cultures.
Et, en écriture, de revenir au roumain ?
Oui, mon rêve serait que mon dernier livre soit écrit en roumain. Mais pour cela j’aurais besoin de rester au pays plus de deux mois par année, ce qui pour le moment est impossible. La traduction de mes livres, tout comme ceux des autres — Vincent Fortier, Josip Novakovich, Cristina Montescu — m’a rapprochée de nouveau du roumain littéraire. Et je suis surprise combien ma langue maternelle est enracinée dans ma mémoire, la manière subtile dont elle me dicte les choix de mots et les registres de langue les plus inattendus. Je creuse souvent dans les régionalismes, les archaïsmes, et cela de manière absolument involontaire. Lorsque j’ai le choix par exemple entre un terme moderne et un archaïque, ma préférence va toujours vers l’ancien, vers la langue que j’entendais chez mes parents, mes voisins. Le retour au roumain c’est le retour à l’enfance, au passé. Je suis vraiment curieuse de voir ce que cela va donner lorsque je vais commencer à écrire directement en roumain et non pas par le biais de la traduction.
Votre maison d’édition a déjà 4 ans d’activité. Quels sont les choses importantes que vous avez apprises pendant toute cette période ?
En quatre ans d’existence nous avons publié 30 titres : des romans, de la poésie, des essais, et des traductions qui nous ont apporté une bonne réputation. Un grand écrivain disait qu’un éditeur doit publier pour faire de l’argent, mais un grand éditeur publie des livres que peu de gens lisent. Je ne me suis pas proposée de faire de l’argent. Nous sommes à la recherche d’une littérature qui raconte des histoires peu connues, qui révèlent les visages cachés de notre société. Les auteurices de la diversité, que ce soit ethnique, sexuelle ou de genre, ont la priorité, car ils et elles ont été longtemps disciriminé.es. Mais nous ne disons jamais non à un bon manuscrit, d’où qu’il vienne. Je garde aussi un œil attentif vers les traductions, car j’ai la chance de pouvoir transposer moi-même des livres de l’anglais, du roumain et du français. Pour la première fois, j’ai vu l’avantage d’avoir tant peiné dans les départements de langues étrangères. Les traductions représentent pour nous un grand atout, car cela nous permet d’élargir notre mission et de créer des liens avec des éditeurs étrangers pour faire traduire nos propres livres.
Enfin, une dernière question, personnelle cette fois. Je vous ai vue heureuse dans une photo sur un marché de Bucarest. Quelle est la définition du bonheur pour vous ?
Il y a principalement deux choses qui me rendent heureuse : faire ce que j’aime et m’entourer de bonnes personnes. Lorsque je suis en Romanie, je bénéficie pleinement des deux. Le plaisir pour moi se mesure dans les choses simples, quotidiennes, dans les rencontres autour d’un café, le bavardage au téléphone dans une langue dont j’avais oublié la familiarité. Après deux décennies d’absence, je découvre une nouvelle Roumanie, mais qui me permet encore de renouer avec le passé. Tant que mes ancien.nes ami.es sont encore ici, la Roumanie sera toujours la maison de mon enfance. Je rajeunis dès que je mets le pied à l’aéroport.
[1] https://lettrescapitales.com/nouvelle-maison-dedition-a-montreal-interview-avec-felicia-mihali-ecrivaine-professeure-et-directrice-de-hashtag-editions/
Propos recueillis par Dan Burcea
Photo de Felicia Mihali ©Danila Razykov

