
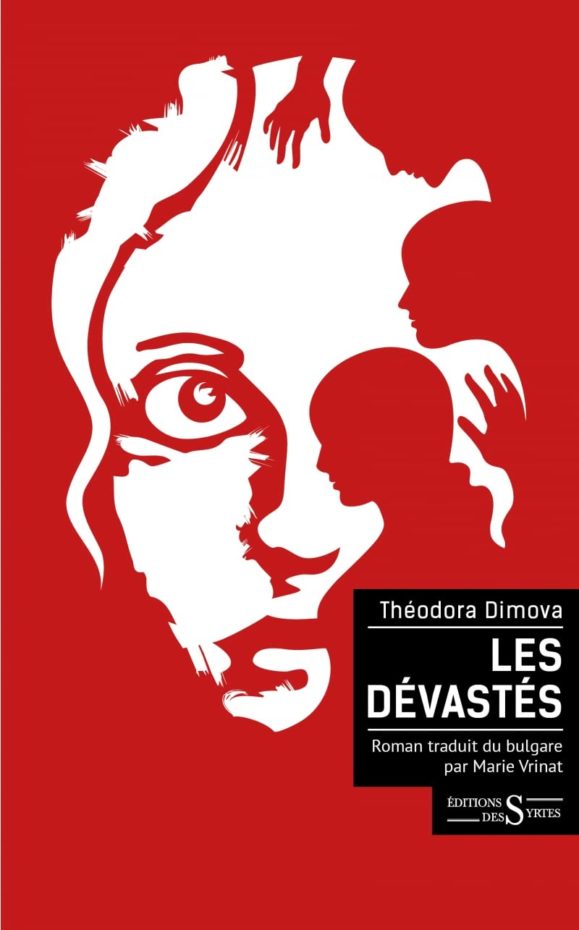 Le roman « Les Dévastés » de l’écrivaine bulgare Théodora Dimova, paru aux Éditions des Syrtes dans la traduction française de Marie Vrinat, est avant tout un acte de justice rendue aux intellectuels et aux opposants persécutés et assassinés par le régime communiste instauré en Bulgarie suite au coup d’État de septembre 1944. Cette mise en fiction historique réussit à remettre en lumière « le mécanisme par lequel le poison de la peur se mettait tout à coup à agir en l’homme et paralysait ses mouvements et sa volonté ». C’est de ce danger d’un basculement brutal et inattendu dont nous parle Théodora Dimova dans un roman bouleversant et tellement actuel.
Le roman « Les Dévastés » de l’écrivaine bulgare Théodora Dimova, paru aux Éditions des Syrtes dans la traduction française de Marie Vrinat, est avant tout un acte de justice rendue aux intellectuels et aux opposants persécutés et assassinés par le régime communiste instauré en Bulgarie suite au coup d’État de septembre 1944. Cette mise en fiction historique réussit à remettre en lumière « le mécanisme par lequel le poison de la peur se mettait tout à coup à agir en l’homme et paralysait ses mouvements et sa volonté ». C’est de ce danger d’un basculement brutal et inattendu dont nous parle Théodora Dimova dans un roman bouleversant et tellement actuel.
Dans la Postface de votre roman, vous parlez de la commémoration des victimes du communisme un jour glacial du 1er février 2016. L’absence des représentants de l’État vous inspire ces phrases tout aussi terribles que le froid hivernal : « Comme si les victimes n’avaient rien à voir avec notre État. Comme si il nous était plus confortable de vivre sans mémoire ». Dans quelle mesure, ce devoir de mémoire vous a-t-il encouragée à écrire Les Dévastés ?
Le 1er février est une journée consacrée à la commémoration des victimes du communisme. Je me rends presque chaque année au monument qui est situé dans le centre de Sofia. Je n’oublierai jamais ce jour glacial de février. La température était de -20°C, il y avait du soleil, mais on avait l’impression qu’il était glacial lui aussi, l’air vous coupait le souffle. J’ai pensé que c’était par un froid inhumain comme celui-ci que les 144 premières personnes condamnées par le tribunal dit « populaire » ont été fusillées dans la nuit du 1er février 1945. J’ai éprouvé une douleur soudaine et inexprimable pour eux, car aucun des représentants des institutions et des autorités de l’État n’était présent, comme si cet hommage était une initiative privée, une messe commémorative privée d’environ cent, deux cents personnes. Il n’y a pas eu de discours, pas d’honneurs rendus par l’État. Comme s’il n’était pas nécessaire de se souvenir de leur fin tragique et injuste. Je me suis demandé pourquoi il y a si peu de romans sur la période qui suit immédiatement le 9 septembre. La littérature bulgare est redevable à cette période, me suis-je dit avec un brin d’arrogance. Avant d’ajouter aussitôt : « Attends, attends, je fais partie de la littérature bulgare, non ? Comment puis-je la blâmer et pas moi ? » Et c’est littéralement à ce moment-là que j’ai su que j’allais écrire un roman, à ce moment-là que ce sujet m’est tombé dessus et m’a obsédé, me projetant, durant les quatre années qui ont suivi, d’un extrême à l’autre sans me laisser reprendre mon souffle.
Au-delà de cet impératif testimonial, vous parlez de l’exemplarité éthique de l’écrivain. « Car, en tant qu’écrivain ma tâche est de mettre le doigt dans la plaie, d’exprimer l’intuition du plus grand nombre possible des gens. » Que pensez-vous de son rôle en tant qu’éveilleur des consciences ?
J’ai passé presque un an et demi à lire les événements tragiques liés à l’arrivée et à l’occupation de la Bulgarie par l’Armée rouge en 1944. Des dizaines d’études historiques ont été publiées, des dizaines de livres de mémoires, de journalisme d’investigation, de souvenirs, il y a aussi un bon nombre de documentaires. J’ai parlé à énormément de personnes dont les proches ont été victimes de cette période sanglante. Mais, pour notre société dans son ensemble, de manière irrationnelle, ce sujet est demeuré intact, on ne l’a pas effleuré, vécu, exprimé, repensé. Inévitablement, l’idée s’est imposée qu’il n’était pas nécessaire de regarder en arrière, qu’il était préférable pour notre avenir de regarder vers l’avant. De ne pas reconnaître, ne pas regarder nos traumatismes historiques pour pouvoir rompre avec le communisme et se rapprocher des démocraties normales. Comme si cette période avait été vécue par les ancêtres d’autres personnes et non par les nôtres, comme si elle s’était déroulée dans une société différente, il y a des siècles, et qu’il n’était pas utile d’y revenir parce que nous n’avons plus rien à voir avec elle. C’est là une position défendue principalement par l’ancien parti communiste, qui, immédiatement après 1989, s’est rebaptisé « parti socialiste ». Mais cette position s’est répandue de manière invisible et incompréhensible dans presque toutes les couches de notre société. Le passé totalitaire a été condamné, mais cette condamnation n’est en quelque sorte restée que sur le papier, formelle, partielle, éventuelle. En réalité, on en cultivait la nostalgie avec une perfide dextérité, on en brouillait les contours, on imposait l’opinion selon laquelle tout événement était de double nature, à double fond, qu’il n’y avait pas une seule vérité. Les dévastés s’opposent précisément à cette ambivalence et s’adressent précisément aux générations qui n’ont pas vécu d’expériences traumatiques similaires. C’est cette attitude de notre société qui ne m’a pas laissée en paix. Je voulais que le roman la fasse exploser. Car oublier ces témoignages, ne pas s’en souvenir, c’est bafouer une seconde fois la mémoire des victimes. Et je pense qu’une partie du travail d’un écrivain consiste à mettre le doigt sur les blessures, à essayer de les exprimer, parce que le fait même de les exprimer fait déjà partie de leur guérison.
Cette image symbolique de l’écrivain engagé nous donne l’occasion d’évoquer la figure de Nikola, le personnage du premier chapitre de votre roman. Mais avant de l’évoquer, pouvez-vous nous dire comment avez-vous imaginé et structuré votre matière narrative par plusieurs points de vue, surtout à travers les voix féminines ?
Je voulais explorer la manière dont la nature humaine réagit lorsqu’elle se heurte frontalement au mal. Certains se rendent rapidement, commencent à coopérer avec lui, d’autres, que nous avions considérés comme fragiles et instables, le regardent dans les yeux et ne plient pas, chez d’autres il produit une explosion intérieure et ils s’autodétruisent, pour d’autres encore c’est la chance attendue qui ouvrira la voie de l’épanouissement personnel. En ce sens, ces années très dures sont la toile de fond historique sur laquelle se joue l’éternelle lutte métaphysique entre la résistance et la défaite. Les quatre voix féminines reflètent de manière polyphonique cet affrontement. L’évangile présente également des événements par les différents points de vue des quatre évangélistes.
Revenons à Nikola, votre personnage que nous évoquions à l’instant. Il fait preuve d’une confiance à tout épreuve à la raison, à tel point qu’il ne voit ni le changement des mentalités ni la fragilité de sa position. « Que pourrait-on me faire à moi, un écrivain et éditeur ? », s’exclame-t-il en réponse aux avertissements de Raïna, sa femme. Que pouvez-vous nous dire de cet intellectuel convaincu, naïvement, sans doute, que l’humanisme protège ou plutôt devrait le protéger de la violence qui frappe aux portes de la société bulgare dans les années 1945 ?
Oui, cela s’est produit avec de nombreuses personnes. C’est la réaction la plus courante. Certains ont pressenti le danger imminent d’une occupation par l’Armée rouge, d’autres ne pouvaient pas deviner ce qui allait arriver, même si l’on savait depuis longtemps ce qui se passait en URSS. Ils ne pensaient tout simplement pas que le mal pouvait s’abattre sur eux de manière aussi soudaine et brutale. Je ne sais toujours pas comment définir un tel comportement, si c’est de la dignité ou de la naïveté. Raïna, la femme de Nikola, sent la menace avec son intuition féminine et le supplie, elle l’exhorte à aller en Suisse ; elle comprend ce qui va leur arriver, mais lui refuse de comprendre. Les actions humaines recèlent toujours un mystère. Lorsque le coup d’État du 9 septembre a lieu, les putschistes prennent très vite leurs marques, ils libèrent les criminels des prisons et les attirent comme collaborateurs, ils nomment dans tous les ministères des personnes de leur camp qui limogent les précédents, dans les tout premiers jours après le 9 septembre, on entend parler de personnes disparues, de personnes arrêtées, tuées, abattues sans procès ni condamnation. La digue retenant la vengeance contre les plus aisés, les plus riches, les plus talentueux est rompue. Le génie est libéré de la bouteille. Les nouveaux dirigeants s’installent dans les maisons des personnes arrêtées, mettent leurs vêtements, disposent de leurs biens comme si c’étaient les leurs, ils emprisonnent les véritables propriétaires et expulsent leurs familles avec pour tout bagage une seule valise chacun.
À quel moment et par quel moyen la société bascule dans la folie de la culpabilisation d’une partie de ses membres, dans ce cas, des intellectuels ?
Très vite, le pouvoir communiste a réussi, et c’est pour moi la chose la plus frappante, à instiller la peur dans la société. Il crée le sentiment qu’il est partout, omniprésent, invincible, sournois, qu’il surveille chaque personne, qu’il les tient dans ses mains. Les voisins commencent à se surveiller mutuellement, à se dénoncer, à se calomnier. Cela est encouragé, des privilèges et des avantages sont accordés, des biographies sont blanchies. L’un des principaux reproches que je nous adresse, à nous, Bulgares, dans ce roman, est d’avoir succombé très rapidement et de manière incontrôlée à la peur, sans même résister, en un laps de temps très court. Il y a eu des résistances, bien sûr, et des gens qui se sont tenus à l’écart, qui n’ont pas participé à la folie générale. Mais la majorité a succombé à la folie. Je pense que c’est l’une des vérités les plus difficiles que j’ai dû affronter en écrivant ce roman.
Les communistes, nous le savons, tenaient en horreur la religion et mettaient tout en œuvre pour effacer ce socle spirituel dans la population. Le père Mina, un autre personnage de votre roman, en subit les conséquences de cette politique criminelle. Il est arrêté de manière brutale et traîné dans la rue, une pancarte autour du coup sur laquelle est écrit Juda. « Le communisme tue les couleurs du monde » – écrivez-vous. Qu’incarne-t-il pour vous ?
Le père Mina fait partie de ces gens qui ont vu très clairement ce qui allait arriver. Mais même lui n’imaginait pas la taille et l’ampleur de ce désastre. Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a dénoncé le « bacille communiste ». Il a parlé de la persécution et de la destruction de l’Église en Union Soviétique, de la démolition des églises, des meurtres en masse de prêtres. Il a cité le message bouleversant du patriarche Tikhon au gouvernement soviétique à l’occasion du premier anniversaire de la révolution bolchevique. En gros, il dit la chose suivante : personne ne se sent en sécurité, tout le monde vit dans la peur constante d’être arrêté, envoyé dans un camp, déporté, fusillé. Vous saisissez des centaines de personnes sans défense, les jetez dans des prisons pour qu’elles y pourrissent, les punissez de mort. Vous tuez des gens complètement innocents sous l’accusation fallacieuse de fomenter une contre-révolution. Il ne vous suffit pas d’avoir taché de sang les mains du peuple russe, mais vous l’avez poussé à un pillage ouvert et éhonté. À votre instigation, terres, usines, fabriques, maisons, animaux, argent, meubles, biens, vêtements sont pillés. Vous avez obscurci la conscience des ignorants avec la possibilité de piller en toute impunité, vous avez fait taire en eux la conscience du péché… etc.
La troisième victime est Boris, un commerçant, gérant d’une coopérative prospère nommée Nadejda, espoir. Il sera à son tour arrêté et torturé et se retrouvera dans la même cellule avec Nikola et le prêtre orthodoxe Mina. D’ailleurs, dès le premier récit, Raïna nous présente ce trio de martyrs. « Tu nous exhorte à être forts, à être courageux, à ne pas avoir peur, à nous soutenir les uns les autres, à ne pas répondre à la bassesses, à nous comporter dignement », dira Raïna, en s’adressant à son mari. Peut-on dire que cette exhortation est le symbole même de la Résistance à cette folie totalitaire ?
En fin de compte, la résistance la plus forte a consisté à ne pas participer, ne pas les soutenir, à défendre son propre système de valeurs, pas le leur. Boris était un homme riche, un entrepreneur, un commerçant, ses biens et les entrepôts de sa coopérative ont été confisqués, il a été accusé d’y avoir mis le feu délibérément, et il a été jeté dans la même cellule que Nikola et le père Mina. Raïna leur rend visite dans cette cellule. Elle est frappée par l’état dans lequel elle les trouve. Elle décide en son for intérieur qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour les libérer. La tragédie de sa trahison pour sauver au moins son mari n’est pas moindre que la tragédie des trois prisonniers.
Vous illustrez cette terreur à travers trois figures emblématiques : Yordann, Vassa et Anguel. S’agit-il des personnes réelles présentes dans des archives qui vous ont servi de modèles ? Que disent ces personnages de la manipulation par la propagande de l’époque ?
Certains d’entre eux ont des prototypes, comme Vassa, qui a purgé une peine criminelle de vingt ans mais qui a été libéré le 10 septembre et qui, en remerciement, accomplit le travail le plus noir et le plus ingrat : celui de « purger les ennemis ». Il s’agit généralement d’hommes sans éducation ni instruction, aigris par la pauvreté, remplis d’envie à l’égard de ceux qui, grâce à leurs capacités et à leur travail, se sont élevés au-dessus de la misère habituelle. Parmi les partisans de ce pouvoir usurpateur, il existe une autre classe de personnes, dont Anguel est un représentant, mais ils sont moins nombreux. Éduqués et intelligents, instruits, ils ont adhéré un jour aux slogans et aux appels ostentatoires à l’égalité universelle. Ils ont pris conscience de la monstruosité du mécanisme, mais une fois happés, ils ont perdu la volonté et le courage de s’en détacher, de se guérir du virus du pouvoir.
Chacun de ces chapitres porte le nom d’une femme ou d’une lignée de femmes. Pourquoi avez-vous préféré leur confier à elles les rênes de la narration ?
Dès cette journée glaciale du 1er février, alors que je me tenais devant le Mémorial aux victimes du communisme, lorsque j’ai pris conscience que je devais écrire un roman les concernant, l’image de ma grand-mère, de ses amis et de ses parents, a fait surface dans mon esprit, des images de ma petite enfance. Je me suis souvenue de leurs réactions, tombées dans l’oubli. Enfant, j’étais entourée de personnes de cette génération qui ont enduré l’époque qui a fait suite au 9 septembre. Dans ma famille, personne n’a été jugé par le tribunal populaire. Mais il aurait pu en être différemment, car les biographies des personnes jugées sont semblables. Mon grand-père était ingénieur, il avait fait ses études en France, ma grand-mère avait fait des études secondaires, ce qui était normal pour les femmes à l’époque, ils avaient beaucoup voyagé, connaissaient des langues étrangères, lisaient, avaient des liens avec l’Europe. J’ai commencé à observer des personnages, peu à peu leurs contours ont émergé comme d’une brume, j’ai commencé à percevoir des bribes de mots, des réactions, c’était un sentiment tellement mystérieux. Les générations qui, comme moi, ont grandi dans la Bulgarie communiste ont été embrigadées dès l’enfance pour faire l’éloge du « Parti ». Je me suis souvenue qu’à l’école, on nous avait demandé d’écrire un poème sur « le Parti ». J’ai dû avoir une bonne note car je l’ai montré avec joie à ma grand-mère. Mais elle, elle a eu un mouvement de recul, elle s’est repliée sur elle-même, s’est tue, non seulement elle ne m’a pas félicitée, mais elle s’est détournée, éloignée et ne m’a rien dit, comme si je l’avais blessée physiquement, comme si j’avais été grossière avec elle. Ça a dû être terrible pour elle qu’une enfant de huit ans puisse être manipulé de façon aussi écrasante. Et il n’y a aucun moyen d’expliquer à un enfant qu’il est manipulé à l’école. En fait, ce sont les épouses des hommes arrêtés et tués, celles qui sont les plus faibles, les plus vulnérables, les plus fragiles, qui supportent tout le poids du régime, de la déportation en province, parce qu’elles restent en vie, parce qu’elles doivent élever et éduquer leurs enfants. Certaines d’entre elles ne tiennent pas le coup, physiquement, d’autres plient, d’autres encore commencent à participer et à coopérer.
Peut-on également parler d’une influence transmise par la personnalité et l’œuvre de votre père, le célèbre écrivain bulgare Dimitar Dimov, sur votre conception de la littérature et particulièrement sur l’univers de votre écriture ?
Ses livres ont laissé en moi une empreinte presque aussi importante que sa mort prématurée. J’ai perdu mon père quand j’avais cinq ans. C’est peut-être pour cela que je suis devenu écrivaine, parce que je voulais instinctivement être plus proche de lui. Je relis périodiquement ses romans et découvre toujours de nouvelles choses. On me demande souvent comment j’ai eu le courage de suivre son chemin, si je n’ai pas eu peur de rester dans son ombre. Je réponds que j’ai compris très tôt que chaque être humain doit suivre son propre chemin, sinon il déforme sa vie, ne réalise pas ce à quoi il est destiné. Et cette prise de conscience m’a donné la paix de l’esprit et une responsabilité envers mon travail d’écrivain, me protégeant miraculeusement de toutes les peurs et de tous les complexes. Un de mes premiers romans était la suite d’un de ses romans inachevé. L’écrire a été ma relation la plus mystique avec lui.
Et enfin, une dernière question, où en est la Bulgarie avec son travail de découverte et de dénonciation des crimes du communisme ? Comment voyez-vous l’avenir de votre pays dans cette lutte mémorielle selon laquelle il serait impossible de construire une société nouvelle ?
Malheureusement, je ne suis pas très optimiste quant à la lutte mémorielle. Il est apparemment plus facile de ne pas regarder en arrière, de ne pas étudier les traumatismes. Mais ainsi, ils s’embrasent encore plus, s’enveniment et empoisonnent l’organisme. Tôt ou tard, notre société doit faire face à ses périodes historiques sombres, elle doit les dire. La mémoire ne peut jamais être complètement effacée.
Propos recueillis par Dan Burcea©
(Texte traduit du bulgare par Marie Vrinat)
Théodora Dimova, Les Dévastés, Éditions des Syrtes, Genève, janvier 2022, 288 pages.

