
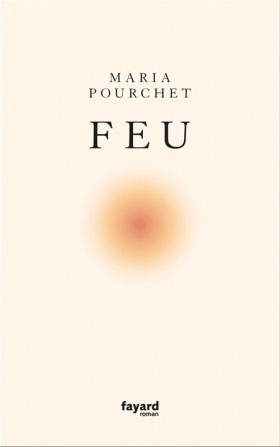 Est-il encore possible de parler d’amour aujourd’hui ? Et, d’ailleurs, que veut dire parler d’amour de nos jours, dans un monde où les âmes, devenues des objets difficilement connectables, sont vouées à une consommation qui jadis portait le nom d’une combustion passionnelle ? Maria Pourchet tente d’y répondre à ces questions dans Feu, un roman haletant dont elle ne cache pas une certaine fonction thérapeutique. À 40 ans dit-elle avec lucidité dans une interview, on peut compter les blessures laissées par 25 ans d’histoires amoureuses.
Est-il encore possible de parler d’amour aujourd’hui ? Et, d’ailleurs, que veut dire parler d’amour de nos jours, dans un monde où les âmes, devenues des objets difficilement connectables, sont vouées à une consommation qui jadis portait le nom d’une combustion passionnelle ? Maria Pourchet tente d’y répondre à ces questions dans Feu, un roman haletant dont elle ne cache pas une certaine fonction thérapeutique. À 40 ans dit-elle avec lucidité dans une interview, on peut compter les blessures laissées par 25 ans d’histoires amoureuses.
Bonjour Maria Pourchet, permettez-moi de reprendre ma question et de vous la reposer en y rajoutant un élément d’histoire littéraire : Est-il encore possible de parler aujourd’hui d’amour, ce sujet suranné, qui, pour le retrouver, nous obligerait à descendre dans les annales romanesques du XIXe siècle ?
Dans un premier temps, pour écrire à propos de l’amour mieux vaut avoir en tête l’immensité de ce qui a été dit, les personnages légendaires du théâtre amoureux. Voire en faire quelque chose, voire en jouer. Si « le mari » dans mon roman est médecin à l’image de Charles Bovary c’est pour dire au lecteur : « nous sommes par endroits dans ce qu’il reste de ce royaume-là, dans une certaine littérature d’édification, où l’amour a un coût social, nous sommes là ». Dans un second temps, il faut tout oublier de ce que l’on a lu, se désencombrer le plus possible pour pouvoir atteindre le noyau de son propre « discours amoureux » intérieur et tu, sédimenté par les années.
Quant au titre de votre livre, il est intéressant de noter que, lorsque l’on fouille dans les galeries souterraines de la famille sémantique du mot amour, on tombe sur des synonymes renvoyant sans ambiguïté au feu, à la flamme, à l’ardeur, l’étincelle, à l’embrasement. Que disent tous ces mots de votre roman, et pourquoi avoir choisi de le placer par son titre sous ce signe de l’incandescence ?
J’ai dit un peu partout, parce que je le crois, que la métaphore du Feu évoque à peu près tous les états de l’amour identifiables sur un axe allant de l’étincelle à l’extinction puis encore après, aux cendres, à ce qu’on trouve encore dessous : résidus sentimentaux ou habitudes, prêt à crépiter à nouveau, s’embraser encore… ou formes froides, durcies, pompéiennes de l’amour mort. Le feu dit tout.
Mais récemment une lectrice m’a fait remarquer que « feu » lu à l’envers se prononce « œuf ». Vertige lacanien. Ce livre parlerait de la nidation du sentiment amoureux ? Va savoir.
Est-ce que parler d’amour n’implique pas de la manière la plus directe et inévitable de parler de soi ? Y a-t-il beaucoup de choses de vous dans ce roman ?
Oui il y a beaucoup de choses de moi dans ce roman. Mais absolument pas là où on s’attendrait à les trouver.
Quel a été votre travail de documentation et combien de temps a duré l’élaboration de votre livre ?
Mon travail de documentation a consisté à poser, au motif avoué d’écrire ce livre, des questions indécentes à des hommes préalablement disposés par « accord » à y répondre de façon décomplexée. Une autre documentation, plus saignante et introversée, a consisté à retrouver le noyau que j’évoquais dans ma réponse à votre première question.
Vous avez évoqué une fonction thérapeutique en parlant de votre roman. En quoi consiste-t-elle ?
Idem, j’en parlais au début. Me désencombrer. Faire quelque chose de possiblement beau, et surtout de « terminé », avec la matière de vieilles, parfois lancinantes, douleurs.
Vous adoptez une démarche romanesque très théâtrale qui trouve ses aises dans une construction narrative binaire, à travers un dialogue entre une femme, Laure, et un homme, Clément. On peut noter son caractère très unitaire, dans le sens classique : une passion qui se consomme de juin à décembre, dans un décor où le provisoire de l’adultère reste incapable de construire un vrai toit protecteur pour des personnages dramatiquement très forts. Que pensez-vous de cet aspect, l’aviez-vous envisagé comme faisant partie de votre stratégie d’écriture ou a-t-il découlé naturellement de son développement, de son envol narratif ?
Je suis incapable de répondre à cette question. Elle suggère des techniques dont ce livre a été, devait être, affranchi pour s’élaborer.
Toujours à ce sujet, il serait intéressant de nous dire quelques mots sur les deux manières de discours que vous utilisez, un à la première personne pour Clément et l’autre à la deuxième personne du singulier pour Laure. Là-aussi, vous touchez par ce double discours direct une dimension théâtrale du langage de vos personnages. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
L’énonciation de chacun est venue assez naturellement. JE pour Clément car j’aimais beaucoup ce personnage et s’en qu’il me ressemble, il était mon vecteur de ce qu’il reste de mon ironie. TU pour Laure car c’est l’adresse de l’introspection, Laure se parle à elle-même. Et aussi c’est celle dont l’amour est tu (au sens de non-dit) par obligation.
Disons également un mot de votre style qui mélange élégance et brutalité dans une concision souvent impressionnante surtout par sa capacité de construction aphoristique. En quoi consiste ce langage, comment l’avez-vous adopté, travaillé ?
Merci ! Je ne pense pas l’avoir travaillé. Il tient à la fois de mon oralité propre, j’oscille en parlant entre la rigueur et l’approximation des termes, entre la recherche du bien-dit, la douceur des avis, et une subite violence, éternellement mal comprimée. Donc j’écris comme ça. À la fois comme on pense et comme on gueule, dans la même phrase.
Qui sont Laure et Clément, vos personnages principaux ? Que disent leur âge, 40 et 50 ans, leur position sociale et maritale, leurs métiers de leurs personnalités ?
Je préfère ici répondre la vérité : je déteste présenter mes personnages comme s’il s’agissait qu’ils soient recrutés ou invités à dîner par le lecteur. Leurs états civils, leurs goûts, leurs jobs. Mais je vais répondre à la consigne 😃. Pourquoi ces métiers car ce sont des environnements professionnels que je connais, dont je peux parler à peu près justement. Il y en a peu, je n’ai guère de choix. Pourquoi ces âges car c’est le mien j’imagine, 40, et ensuite celui qu’un jour j’aurai, 50, donc qui m’interrogent, m’intriguent, m’émeuvent. La plus grande jeunesse, à présent que je l’ai vécue, m’intéresse moins. Mon âge me passionne, je le trouve puissant. Je vais parfois jusqu’à regretter de l’avoir eu si tard. Comprenne qui peut.
Une des thématiques centrales de votre roman est celle du désir. Lorsque Laure écrit à Clément après l’avoir vu deux fois, précise-t-elle, elle avoue consumer (encore un mot évoquant le feu) « des générations de bienséance, de convenances, de principes, de préceptes, de prudence, de pudeur, de punition, de réserve, de respect, de tact, de vertu ». C’est une longue liste, si l’on regarde attentivement. Êtes-vous d’accord avec Laure lorsqu’elle tente de définir ainsi le désir ?
Ça définit surtout la liberté qui est celle d’exposer son désir, de le mener au bout. Donc oui, je suis d’accord avec cette définition : la liberté ça commence par consumer tout ça.
Clément, quant à lui, croit s’en sortir par une pirouette. « C’est une femme avec des idées – dit-il – je suis un homme avec un chien, je ne peux pas être partout. Je ne supporte que les fictions, elle a toujours la nostalgie de la vérité ». Ne pointez-vous pas par ces mots le trait essentiel de cet être abandonnique qui est Clément, prêt à tout moment à larguer les amarres devant les projets de Laure ?
Si, exactement, il tente de trouver une raison définitive pour la fuir. Ce qu’il explique n’expliquant absolument rien. Ça dit simplement la différence et l’impuissance, à l’origine de beaucoup de détresses amoureuses.
Plus encore, Clément continue à s’intéresser plutôt aux « indices du bonheur » avec une propension pour un monde où, selon lui, rien de salissant ne devrait arriver. Il décrétera à la fin qu’entre lui et Laure il y a une chose paradoxale qui les unit, « on ne se comprend pas ». À cela, Laure n’hésite pas à réitérer son angoisse : « moi aussi je suis fragile Clément, moi aussi je suis seule », dira-t-elle. Que disent ces paroles de l’incompatibilité entre ces deux partenaires ?
Qu’ils ne sont encore qu’au stade premier, narcissique, presque infantile de l’amour : quand on demande avant tout à être compris. Le stade le plus développé étant d’aimer « quand même ». Sans être sûr d’être compris et en acceptant de ne pas comprendre.
Un autre thème de votre roman est celui du mensonge. S’il est implicite, fondamental dans la situation adultérine de vos deux personnages, les proportions qu’il prend sont incontrôlables, allant jusqu’à la perte des propres repères, comme ceux de Laure. « Le mensonge se mue en nature autant qu’il t’épuise », dira-t-elle. Comment analyser cette perte dans le cas de votre héroïne ?
Je ne l’analyse pas. Le mensonge dans son cas est un effort tactique et créatif permanent, ça épuise.
À ce mensonge de Laure répond le discours de Véra, sa fille ainée. Adolescente rebelle, ultra féministe, elle porte en elle une sorte de lucidité que semble ignorer sa mère. On retiendra le résumé qu’elle fait de la pièce de théâtre Andromaque de Racine, vrai réquisitoire de l’idée que l’on se fait des sentiments et de la tradition. « C’est moi qui t’ai fait cours », dit-elle à sa mère médusée. Quelle place occupe Véra dans l’intrigue de votre roman ?
Elle représente tant de choses. Pour en dire quelques-unes : le principe moralisateur, la vertu, la théorie des rapports homme-femme contre l’expérience de ceux-ci, et donc le terrorisme qui va avec toute théorie entretenue. Elle représente la fille qui se pense née femme et donc victime, et qui ignore encore comment on devient femme, pour paraphraser une grande dame. Elle représente le combustible qui donnera au feu des proportions ultimes.
Pour conclure, je vous propose de nous arrêter sur ces images qui en disent long de l’être contemporain : un être blessé, habité de doutes, porteur d’une « âme discount », une poupée parlante, un jouet raté soumis au complexe de classe et condamné à une vie souterraine et regardant en face la brulure faite par la souffrance en amour. « Tu es une femme de peu d’espoir », répète sans cesse Laure. Diriez-vous que ce portrait est celui d’une grande partie de nos contemporains ? Qu’incarne selon vous Laure Gref, cette femme qui rappelle Emma Bovary, Anna Karenina et tant d’autres ?
Elle n’incarne qu’elle-même au moment où elle emploie ces termes : une femme qui a provisoirement consumé ses ressources en voulant se faire aimer et qui va devoir renaître de ces cendres, après la fin. Je n’ai pas un désespoir si vif à l’endroit de mes contemporains, loin de là.
Propos recueillis par Dan Burcea
Photo de Maria Pourchet ©JOEL SAGET / AFP
Maria Pourchet, Feu, Éditions Fayard, août 2021, 360 pages.

