
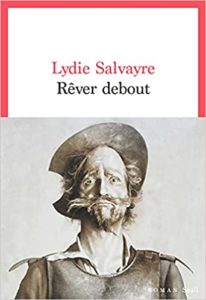 Lydie Salvayre publie Rêver debout, un livre-manifeste puissant sous la forme d’une suite de lettres adressées à Miguel de Cervantes le père littéraire de Don Quichotte et de Sancho, « un couple qui est d’une certaine manière, notre miroir » et dont nous faisons nôtres « leurs révoltes, leurs impasses, leurs craintes et leurs contradictions ».
Lydie Salvayre publie Rêver debout, un livre-manifeste puissant sous la forme d’une suite de lettres adressées à Miguel de Cervantes le père littéraire de Don Quichotte et de Sancho, « un couple qui est d’une certaine manière, notre miroir » et dont nous faisons nôtres « leurs révoltes, leurs impasses, leurs craintes et leurs contradictions ».
Bonjour Lydie Salvayre, vous avez raison d’évoquer cette valeur de miroir dont sont porteurs certains êtres de fiction comme ceux de don Quichotte et Sancho à qui vous dédiez votre livre. Quelle a été pour vous la raison qui vous a conduite à vous tourner vers les héros de Cervantes ?
Nous étions en plein confinement et je me suis souvenue que Don Quichotte rompait avec panache le confinement mental dans lequel il était, passant ses journées à lire des romans de chevalerie, pour aller à la découverte des autres et du monde. J’ai donc relu « L’Ingénieux Don Quichotte de la Manche » que je n’avais pas ouvert depuis quarante ans, et j’ai éprouvé une grande joie à cette lecture. Alors l’idée m’est venu d’écrire une lettre à Cervantes, puis 2, puis 3, puis 15 avec un plaisir constant.
Le titre de votre ouvrage, Rêver debout, renvoie à ce que vous appelez « le pari d’élargir la réalité aux dimensions de son rêve » qu’entreprend don Quichotte. Croyez-vous en cette dualité presque immanente entre le rêve et la réalité et pourquoi cette réalité risque-t-elle de « trivialiser » le rêve ?
Ce à quoi Le Quichotte essaie de mettre fin, c’est à ce divorce dans lequel nous sommes presque tous : divorce entre nos pensées et nos actes, nos dires et nos faire, nos théories et nos pratiques, nos rêves et leur exaucement. Le projet du Quichotte est donc de réconcilier rêve et réalité, de donner corps à ses idéaux et de les ancrer dans la vie quotidienne, afin que cette littérature qui l’a passionné ne reste pas lettre morte, verbiage sans effet sur la vie. Mais ce dont il s’aperçoit, c’est que ses rêves se heurtent la plupart du temps à une réalité qui ne veut pas d’eux, une réalité qui bien souvent les brise, les ampute, les trivialise, et presque toujours les amoindrit.
Vous relevez une autre évidence parmi « les milles vérités précieuses » transmises par Cervantes à travers son œuvre, en écrivant, par exemple, que « ce monde s’apprend par le rêve autant que par l’agir ». Pourquoi les hommes ont, selon vous, besoin de ce que vous appelez « les douces et enjôleuses illusions » pour se consoler de leur mal vivre ?
Nous sommes quelques-uns à penser qu’une vie sans rêve, sans envol (pour reprendre l’expression d’Artaud : « notre féroce besoin d’envol »), sans désir d’infini, sans désir d’impossible, ne serait pas une vie. « Que serait une vie sans le secours de ce qui n’existe pas » dit Valéry. Que serait une vie privée de cet élan, de cette énergie que confère l’utopie ?
Une vie vivante pourrait-elle se satisfaire du mesurable, du pragmatique, de la raison utilitaire ?
Vous dites de don Quichotte « qu’il ne sait, ou ne peut, ou ne veut évaluer les rapports de force » et que ses combats ce sont de « pures chimères ». Comment qualifieriez-vous cette admirable démesure, cet idéalisme donquichottesques qui poussent des gens à se dresser souvent seuls et démunis contre l’injustice ? N’est-il pas de ce point de vue le porte-drapeau de ces gens de courage ?
Oui, l’Histoire nous rappelle que des combats ont été gagnés, démentant toutes les prévisions, par une poignée de combattants affrontant des forces gigantesques et sans commune mesure avec leurs pauvres armes. Je pense évidemment aux premiers résistants contre le nazisme. Pour eux, se battre était une urgence, une nécessité, presque un ordre éthique, quelque chose qui ne se discutait pas, quelque chose qui refusait d’entrer dans les raisons de l’acceptation d’une paix honteuse. Et peu leur importait qu’ils soient peu nombreux et pauvrement armés. Ce qui comptait c’était la lutte, c’était de s’opposer au déshonneur, quitte à être traité d’irréalistes.
Je souhaiterais aborder avec vous à ce stade de notre discussion deux notions essentielles qui traversent votre livre. La première concerne la littérature comme essence même et garante de la liberté. Que signifient ces deux aphorismes que vous proposez dans votre livre : « Pas de littérature sans liberté » et « Pas de liberté sans courage ».
Je pense qu’il faut du courage pour penser, pour prendre le risque de penser, de penser à ce qui échappe au consensus, de penser à ce qui ne va pas de soi, de penser à ce qui dérange notre confort spirituel, nos habitudes, de penser à ce qui déroute nos préjugés.
Il faut du courage pour penser et écrire ces choses qui déplaisent ou qui choquent simplement parce qu’elles ne sont pas conformes à l’esprit du temps.
C’est l’une des vocations de la littérature, il me semble.
La seconde est celle de ce que vous appelez « une vie sans dehors, sans ailleurs, sans mystère, sans rien qui la déborde et qui l’égare ». Comme pourriez-vous décrire cette « existence de confiné » contre laquelle s’érige don Quichotte ?
Ce serait une existence toute consacrée à l’utile, à l’efficience, au pragmatisme.
Ce serait une vie uniquement gouvernée par ce que j’appelle « l’esprit caissier », ou par le réalisme. (Il me vient tout à coup à l’esprit cette phrase de Bernanos : le réalisme est le bon sens des salauds).
Ce serait une vie où tous les hommes agiraient avec prudence, avec mesure, précautionneusement, sans jamais rien risquer, et sans jamais parier sur un avenir autre, comme Sancho.
Propos recueillis par Dan Burcea
Photo de Lydie Salvayre : capture d’écran © La Grande Librairie
Lydie Salvayre, Rêver debout, Éditions du Seuil, 2021, 208 pages.

