
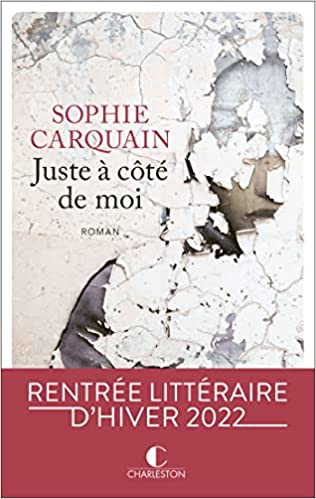 Sophie Carquain publie Juste à côté de moi, un livre « sensible et bouleversant sur l’ouverture à l’autre, la résilience et la puissance de l’art ». En effet, en regardant de plus près, ses thèmes contribuent chacun à sa manière à guider Susie et Niels, ses personnages dans ce que nous pourrions appeler le chemin de sortie d’une impasse traumatique et de reconstruction de soi. L’art pictural joue, quant à lui, un rôle essentiel dans cet exercice d’évasion, à forte puissance curative. Un roman bouleversant, inventif et rempli d’humanité.
Sophie Carquain publie Juste à côté de moi, un livre « sensible et bouleversant sur l’ouverture à l’autre, la résilience et la puissance de l’art ». En effet, en regardant de plus près, ses thèmes contribuent chacun à sa manière à guider Susie et Niels, ses personnages dans ce que nous pourrions appeler le chemin de sortie d’une impasse traumatique et de reconstruction de soi. L’art pictural joue, quant à lui, un rôle essentiel dans cet exercice d’évasion, à forte puissance curative. Un roman bouleversant, inventif et rempli d’humanité.
Deux thèmes essentiels construisent votre roman. Permettez-moi de les aborder séparément afin de mettre en valeur la pertinence de chacun. D’abord celui qui concerne Susie Pitt, votre héroïne principale, blessée pendant l’attentat du Bataclan, où elle a perdu sa sœur. Son passé, dites-vous, ressemble à « un précipice » et sa vie présente à un exercice de funambule « chancelant parfois, se rééquilibrant in extremis ». Il semble bien, si l’on tient compte de votre note à la fin du roman, qu’il s’agirait d’une amie qui vous a servi de modèle. Que pouvez-vous nous dire en guise d’introduction de ce personnage ? Que s’est-il passé, comment a-t-elle vécu ce drame et comment le vit-elle à présent ?
Une de mes amies journalistes a été tuée à la terrasse du restaurant La Belle Équipe. J’ai perdu également une autre amie – Loumia Hiridjee – pendant les attentats de Bombay en 2008. Je pense que nous sommes toutes et tous blessés dans notre chair, quand il s’agit de terrorisme. Nous sommes la génération victime du terrorisme – depuis les années 85, jusqu’à 2015. J’en ai déjà parlé dans le Roman de Molly N, paru il y a deux ans. J’y suis revenue presque « naturellement » pourrais-je dire. Je crois qu’en moi, il y a une Susie encore sidérée par ce que nous avons traversé. J’ai été bien entendu pétrifiée par l’attentat du Bataclan. Je savais que certains avaient perdu un très proche « juste à côté d’eux », que certains s’étaient même cachés sous le corps mort de leur proche. C’est ce qui est arrivé à mon héroïne Susie – elle a « fait la morte ». Et elle le dit, elle est morte pendant quelques minutes. À force de jouer, on devient sérieux, dit-on. C’est cette proximité avec la mort qui m’intéressait aussi concernant Susie. Susie a un peu moins de trente ans, l’âge où l’on bascule vraiment dans l’âge adulte. Elle exerçait un autre métier avant le 13 novembre 2015, puis a été comme éjectée de son ancienne vie par la catastrophe.
Comme vous le soulignez, Susie est peintre de fresques, donc artiste. Elle « croit aux fantômes », confesse-t-elle à Niels. Tout artiste, tout écrivain est pétri de l’énigme de la mort. Tout artiste, je crois, créé un pont entre l’ici-bas et l’au-delà, avec les défunts. Susie est marquée dans sa chair. L’art l’aide profondément à traverser les frontières, à se libérer de sa prison, de son chagrin, de son deuil. C’est d’autant plus évident que, peintre de fresques, elle vient s’installer chez les autres, dans leur intimité, pour peindre sur leurs murs. Ce faisant, elle créé du lien, ouvre la porte. Et elle respire enfin…
Le second thème concerne Niels, le jeune homme, enfermé dans sa chambre, coupé des autres. « Était-il seulement possible de survivre sans qu’un seul regard humain ne soit posé sur vos joues, vos yeux, votre corps, pendant des mois et des mois ? ». Qui sont les hikikomoris ?
Un hikikomori est un jeune (majoritairement un garçon) reclus dans sa chambre. C’est un terme japonais, car le syndrome est particulièrement répandu au Japon (il y a là-bas entre 500.000 et un million de hikikomoris). Leur nombre augmente en France. Ici, on le nomme plus volontiers le « retrait social ». Les jeunes ne sont atteints d’aucune pathologie mentale, mais ils opèrent une forme de résistance passive. Ils ne veulent plus subir cette société qui les aliène. Ils en refusent les contraintes, et surtout l’exigence, la compétition. La France et le Japon sont assez proches sur ce plan-là. Il faut être le meilleur, le « champion », intégrer une université d’élite ou une classe prépa chez nous. Certains lâchent, tout simplement. Les Hikikomoris sont parfois reclus plusieurs années dans leur chambre. Avant d’écrire le roman, j’ai mené mon travail d’enquête. J’ai parlé avec une mère dont le fils n’était pas sorti de sa chambre depuis deux ans. Cela semble incroyable : et c’était une gageure de rendre cela crédible dans le roman. On dit que la réalité dépasse la fiction- c’est le cas avec les hikikomoris.
Pour approfondir le monde dans lequel vit Susie, prenons en compte cette dichotomie qu’elle utilise pour le crayonner, pour utiliser ici ce verbe au sens propre, sachant que Susie est artiste peintre en décors. Vous dites de Susie la chose suivante : « Pour Susie, l’univers était partagé en deux : les gens à plis, et les gens à taches ». Inutile de ma part d’expliciter cette image, je vous laisserais à vous la primauté de nous en dire plus. Que veut-elle dire ?
Ça, c’est vraiment le langage pictural de Susie – plus que le mien ! Les gens à plis (je pense notamment aux tableaux de Lucio Fontana) seraient les introvertis qui camouflent leurs émotions et suivent un tracé rectiligne, (le père de Niels, Xavier Wagner, mais aussi Niels lui-même). Les « gens à taches » (voir Jackson Pollock, ou Seurat) seraient plutôt extravertis, fantaisistes, ne suivant pas un tracé défini. Mais ce qui est important de dire, au moment où nous parlons : cette formule traduit vraiment la façon dont Susie « code » l’univers. Elle a vécu l’indicible, elle a besoin de balises, de repères. Elle se protège aussi dans les tableaux. Milad, son ami iranien, le lui reproche gentiment « Arrête de coder l’univers, écoute tes émotions ».
Lors de son travail de reconstruction, Susie essaie de ne pas rater « une occasion de dérober à l’existence son lot de petites grâces ». Parmi celles-ci, celle de vivre de sa peinture occupe une place importante. À travers ce travail, elle va faire connaissance avec la famille Wagner. Que pouvez-vous nous dire de ce moment important dans l’économie de votre roman ?
Tout débute là. Quand elle pénètre chez les Wagner, dans ce très grand appartement bourgeois pour y peindre un « 360 », une fresque « intégrale » elle ressent un malaise. Xavier Wagner lui parle de son fils « disparu ». Et aussitôt une mécanique infernale se met en branle. C’est à sa sœur qu’elle pense aussitôt. Le fantôme de sa sœur vient se superposer à son insu, au personnage de Niels.
L’histoire avance au rythme de la fresque. Et quand la fresque est achevée, Susie referme la porte de l’appartement des Wagner. Pour autant, elle a rencontré Niels, sa vie en a été chamboulée, et la vie du jeune homme aussi. Je n’irai pas plus loin évidemment pour ne pas divulgâcher le roman – qui est une belle histoire d’amitié amoureuse…
Les parents de Niels espèrent que Susie, grâce à ses pinceaux, parviendra à sortir Niels de sa chambre. Quel place occupe dans la construction de votre intrigue ce rôle revivifiant de l’art ?
L’art est comme vous le dites joliment « revivifiant » au sens où il apporte de la vie et de l’oxygène dans un univers – celui de Niels, celui des Wagner – totalement asphyxié, enfermé. L’art est même plus que « revivifiant » : il créé du lien à l’autre – que cet autre soit un être humain, ou un lieu par exemple. J’aime beaucoup comparer l’art à un refuge, une maison ouverte, avec la clé sur la porte. C’est ainsi que l’artiste, d’ailleurs, ou l’écrivain, permet au spectateur, au lecteur, de pénétrer dans son univers. Quand nous contemplons un tableau, quand Susie peint sa fresque, ou quand je démarre l’écriture d’un roman, je suis dans « ma » maison. Mais contrairement à Niels, ça n’est pas un abri fermé à double tour. C’est par l’art que nous pouvons communiquer. C’est par l’art que Susie parviendra à créer du lien avec Niels, et à l’engager à sortir de sa chambre.
Vous construisez au fil de l’intrigue une autre métaphore qui, à mon sens, a valeur de troisième thème de votre roman, celui du mur, du dehors et du dedans, de la déesse Hestia et du dieu grec Hermès. « Entre les rives du même et de l’autre, l’Homme est un pont », citez-vous Jean-Pierre Vernant. Pouvez-vous nous aider à comprendre ces métaphores et ces symboles empruntés à la mythologie grecque ?
J’aime particulièrement ce couple mythologique de Hestia, déesse du foyer (donc de l’intérieur) et Hermès, dieu nomade et voyageur. Nous, êtres humains, évoluons dans cette double polarité de Hestia et Hermès, entre le dedans et le dehors. Nous avons besoin de notre part de Hestia, et de notre part d’Hermès, du Même et de l’Autre. Mais si nous ne sommes que Hestia, nous nous transformons en Hikikomoris. Pour moi, l’art est exactement aussi entre Hestia et Hermès. C’est un pont entre nous et les autres. C’est le lieu du partage, de la rencontre, « juste à côté de soi ». Dans mon roman, la psychologue animatrice du groupe de paroles de victimes parle ainsi à ses patients-victimes des attentats. « J’aimerais que vous réfléchissiez à ce vers de René Char : « Il faut s’établir à l’extérieur de soi, au bord des larmes ». Autrement dit : ne pas refouler ses larmes, ne pas s’y noyer, mais être « juste à côté », dans l’espace du partage. C’est ainsi que l’on peut partager une émotion, une œuvre d’art. En étant « à côté de soi ».
Revenons, si vous me permettez, à Niels et à son syndrome. Il y a deux phrases le concernant qui ont attiré mon attention et qui en disent long sur sa souffrance : « « Un regard humain pèse une tonne. Un regard est un cyclone qui vous dégomme ». Il est temps de nous parler non pas de son étrange comportement, de son complet isolement, mais de sa souffrance. Comment envisager cette peine, d’une « âme errante », comme il se nomme lui-même ?
Je pense que Niels n’en peut plus. Il sent peser sur lui une pression phénoménale. Il sent que son père, pourtant d’allure aristocratique, assez douce, couve une immense violence au fond de lui. La violence de quelqu’un comme Niels qui souffre, comme nombre d’adolescents, de cette réalité, de cette société absurde, qui leur en demande tant. Mais pourquoi ? Pour vivre sur une planète abîmée ? Pour travailler 10 heures par jour ? Pour gagner encore plus d’argent ? Pour moi, Niels est l’alter ego de Chris, le héros du film « Into the wild ». Chris décide du jour au lendemain de renoncer à une brillante carrière. Il brûle ses papiers, et part sur les routes sans rien. Niels est un Chris qui choisirait au contraire de s’enfermer au lieu de courir le monde. Tout en refusant la société. Ecoutons leur silence. Ils ont beaucoup de choses à nous dire.
Comme dans Alice au pays des merveilles, vous invitez vos personnages à une traversée du miroir en utilisant les fresques peintes par Susie. Vous précisez à la fin de votre livre vouloir « parler de littérature à travers la peinture ». Quel points communs identifiez-vous entre ces deux disciplines, et entre les différents arts, en général ?
La peinture est l’art le plus spectaculaire, visible – et permet en effet des mises en scène plutôt sympas. J’ai bien aimé raconter le refuge de Susie, et il m’a permis à moi aussi de devenir pendant quelques mois une peintre de fresques ! Je dois vous dire que c’est une peintre en décors Marianne Faure-Deforges, qui, en venant peindre une fresque dans ma cuisine il y a quelques années, m’a inspiré le personnage de Susie. Le jour où elle a franchi le seuil de la porte, avec ses pinceaux, ses tubes de couleurs, j’ai immédiatement pensé : « J’aimerais en faire mon héroïne, et écrire une histoire qui avancerait au rythme de la fresque. La fresque laisserait apparaître un secret ». Marianne et moi avons énormément parlé de nos arts respectifs, et nous en sommes arrivées à la conclusion que nos façons de travailler étaient très proches. Par exemple : Marianne procède par couches, ce qui est aussi mon cas. Je reviens tout le temps sur mon texte, j’avance, je trouve certaines idées, qui m’imposent de revenir en arrière. Marianne m’a dit une chose très juste : « Quand je peins des trompe-l’œil, j’avance… Et puis, vient un moment miraculeux où je commence à croire en mon faux-ciel ». C’est la même chose pour moi ! Croire en son faux ciel : c’est une magnifique promesse aussi faite au lecteur.
Une autre lecture nécessaire de votre roman est celle de la capacité de résilience de vos personnages. Pourriez-vous, pour conclure, qualifier votre récit comme l’histoire d’une renaissance, d’un abattement nécessaire et salvateur des murs des nombreuses douleurs obsessionnels dont souffrent les victimes des attentats ou des milliers d’enfants dans le monde victimes du syndrome de hikikomori ?
Ce roman est d’abord pour moi l’histoire d’une rencontre entre deux âmes « jumelles », liées par un fil invisible, et je dirais presque spirituel. Susie se rend compte que Niels a fréquenté une clinique dans laquelle elle a animé un atelier de peinture. C’est une coïncidence presque mystique. Ils s’aideront tous les deux…Même si je ne dévoile pas la fin ! Mais il est très compliqué de parvenir à sortir un hikikomori de sa chambre. Et très long. Comme je l’écris à la toute fin du roman, « le syndrome reste aux yeux des psychiatres, une énigme ». Énigme est le dernier mot du roman. Il le clôt de façon ouverte. Tout comme une maison ouverte – avec la clé sur la porte…
Propos recueillis par Dan Burcea©
Photo de Sophie Carquain : © Astrid di Crollalanza
Sophie Carquain, Juste à côté de moi, Éditions Charleston, janvier 2022, 221 pages.

