
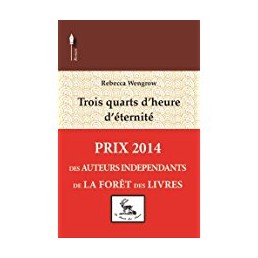 Inutile de chercher à savoir ce que Rebecca Wengrow pense de la liberté, on sait qu’elle serait prête à renoncer à tout sauf à cette réalité de l’être, la seule à pouvoir la gratifier d’un sentiment de plénitude irremplaçable, comme elle l’affirme avec autant de force dès « Le désespoir des heures de pointe » (réédité par Fortuna Éditions en 2014). A cela, rien de surprenant, si l’on jette un regard attentif à la prose de cette écrivaine pour qui les mots sont censés à transfigurer en émotions une angoisse définitive qui ne cesse de lui rappeler l’insidieuse présence d’un mal qui défigure impunément le monde. Rien d’étonnant, dès lors, de voir que chez elle l’espace décrit dans son œuvre est toujours circonscrit à des frontières immuables, toutes construites en dur et insurmontables, où la routine prend toujours le dessus sur les rêves et où les existences doivent s’accommoder de la bêtise des hommes pour continuer à surmonter le seuil du supportable.
Inutile de chercher à savoir ce que Rebecca Wengrow pense de la liberté, on sait qu’elle serait prête à renoncer à tout sauf à cette réalité de l’être, la seule à pouvoir la gratifier d’un sentiment de plénitude irremplaçable, comme elle l’affirme avec autant de force dès « Le désespoir des heures de pointe » (réédité par Fortuna Éditions en 2014). A cela, rien de surprenant, si l’on jette un regard attentif à la prose de cette écrivaine pour qui les mots sont censés à transfigurer en émotions une angoisse définitive qui ne cesse de lui rappeler l’insidieuse présence d’un mal qui défigure impunément le monde. Rien d’étonnant, dès lors, de voir que chez elle l’espace décrit dans son œuvre est toujours circonscrit à des frontières immuables, toutes construites en dur et insurmontables, où la routine prend toujours le dessus sur les rêves et où les existences doivent s’accommoder de la bêtise des hommes pour continuer à surmonter le seuil du supportable.
C’est le cas d’Eva, l’héroïne du livre de Rebecca Wengrow, « Trois quarts d’heure d’éternité », personnage qui tire sa force de la conviction inébranlable que l’amour est capable de guérir les blessures de Seth, son ami, son amant, ex-voyou condamné pour braquage de banque et enfermé à la prison de Fresnes. A leur disposition, de menues moments de présence lors de parloirs hebdomadaires, des trois quarts d’heure qui ont valeur d’éternité, lorsque l’on pense au pouvoir de reconstruire la vie bouleversée de ces deux êtres séparés, perdus et fragiles. Revenir à chaque fois, ne jamais perdre le fil du lien avec Seth, lui prouver son amour inébranlable, tout cela renforce en Eva la conviction qu’elle tient dans sa fidélité constante les clés d’une thérapie dont seules les femmes ont le secret. Gauches, malhabiles, maladroits, les hommes ont à peine su mettre des mots sur ces mystères de femmes, en le nommant timidement dévouement, abnégation, renoncement, sacrifice, alors qu’elles méritaient de la part de leurs compagnons, fils ou parents les lauriers d’une unique fidélité qui tient, à elle seule, le grand équilibre de notre humanité. Et même si Eva sait qu’elle ne détient pas le pouvoir absolu de guérir son ami, elle continue à lui donner, dans un « bouche-à-bouche vital » l’oxygène de son amour et les saveurs de son corps dans des étreintes inachevées. Car, selon elle, la présence des femmes peut, en effet, avoir comme heureuse conséquence d’empêcher que les hommes ne deviennent plus sauvages.
Peut-on, pour autant, risquer d’enfermer le personnage d’Eva dans un cliché, fut-il celui d’une héroïne moderne, assistante de cœur pour des êtres égarés dans les couloirs d’une prison ? Surtout qu’elle ne possède aucune légitimité civile, étant, pour ainsi dire, en concurrence avec l’ex-épouse de Seth. À part cette fragilité et le court passé qui les lient, rien ne justifie l’acharnement de cette femme pour sauver un homme dont elle ne sait même pas si, à la sortie de prison, reviendra réellement vers elle. Peu lui importe ! Eva n’a que faire de ces conventions ! Et, en cela, Rebecca Wengrow refuse d’enfermer son personnage dans une telle typologie réductrice. Car, malgré et envers tout, Eva ne se bat pas seulement pour sauver son improbable amour, mais pour sauver aussi son être de femme seule, sensible, altruiste, mais seule quand même, après tout. Et son combat, elle doit le mener non seulement avec le monde extérieur mais également avec ses chimères de femme qui souffre de la solitude, ce qui est, toute proportion gardée, tout aussi destructeur que l’enfermement.
Et c’est aussi pour cette raison que même le portrait de Seth, on peut le dire, c’est le portrait d’une absence ponctuée, il est vrai, de moments d’une présence intermittente qui ôte toute chance à un probable attachement sentimental ou à une stabilité quelconque. Sa vraie reconstruction à lui s’accomplit dans le secret des périodes successives d’enfermement pendant lesquelles l’écriture devient une thérapie et un mode de vie censé à guérir les blessures d’une adolescence marquée par la violence du père et le défi du fils de protéger sa sœur. La narratrice nous livre comme preuve plusieurs poésies et lettres écrites par Seth et qui remplissent le roman d’une lumière lyrique qui dévoile en fait la vraie vie intérieure de Seth, ce reclus qui croque la vie à doses d’enivrantes métaphores.
De ce double regard autour du problème de la solitude naît la vraie clé de lecture du livre de Rebecca Wengrow. Peu importe les parcours qu’empruntent ses personnages, à un moment ou à un autre, ils vont se retrouver dans une impasse d’où seul l’effort de leur infinie humanité va s’avérer capable de les sauver. Le nom qu’elle donne à cette forme de combat est la « résistance », en rapport direct avec sa grand-mère. Ce clin d’œil a d’autant plus de valeur pour elle car l’on devine chez cette écrivaine à fleur de peau le besoin d’exorciser tous les démons de son passé.
En même temps, le livre dresse un sévère réquisitoire contre l’univers concentrationnaire français, en occurrence celui de la prison de Fresnes, avec les conséquences dramatiques qu’il engendre sur les détenus et leurs familles. Son regard sur la politique de privation de liberté est sans concession, tout cela ne mène qu’à la déshumanisation. Sa conclusion est sans retour : « Pas de thérapie, pas d’amour, pas de dignité. Laisser mourir sans condamner à mort ».
Alors, la question qu’elle pose est simple : « Comment ressortir vivant d’une telle surface ? D’une telle non-surface ! » Et même si l’on sait peu sur le quotidien des prisonniers, il suffit d’avoir connaissance de l’effet qu’il produit sur leur état d’esprit. « Ce que je sais – écrit Seth à Eva –c’est que la prison est un mal pour notre relation et un bien douloureux pour notre intelligence ». À en croire les paroles de Seth, l’enfermement aurait-il, donc, un effet bénéfique sur le prisonnier ? C’est en tout cas ce que le personnage de Rebecca Wengrow tente de nous expliquer : toute réclusion apporterait un bien à celui qui tente de voir plus clair à l’intérieur se soi. Toujours est-il que, malgré cette dureté extrême, Seth tente d’avancer et de s’en sortir par le biais de la littérature qui, en lui ouvrant les bras de l’univers de la poésie, lui ouvre en même temps une porte à son secours.
Que reste-il, selon Rebecca Wengrow, de tout ce monde à moitié défiguré et qui a cessé de se regarder en face ? Ce monde « au regard vieilli » ?
Sans doute, reste l’espoir d’Eva – image archétypale de la femme – qui mise tout sur un fulgurant moment de bonheur improbable.
Et c’est justement en cela que consiste la leçon de vie du livre de Rebecca Wengrow : un optimiste contagieux quant à la force des hommes de sauver la part d’humanité qui reste dans l’autre car tenter de sauver l’autre c’est se sauver soi-même.
En cela, les « Trois quarts d’heure d’éternité » de Rebecca Wengrow atteignent les sommets d’une poignante histoire d’amour sous le regard d’une bienveillante et inaccessible éternité.
Dan Burcea
Rebecca Wengrow, Trois quarts d’heure d’éternité, Fortuna Éditions, mars 2014, 104 pages, 12,35 €

