
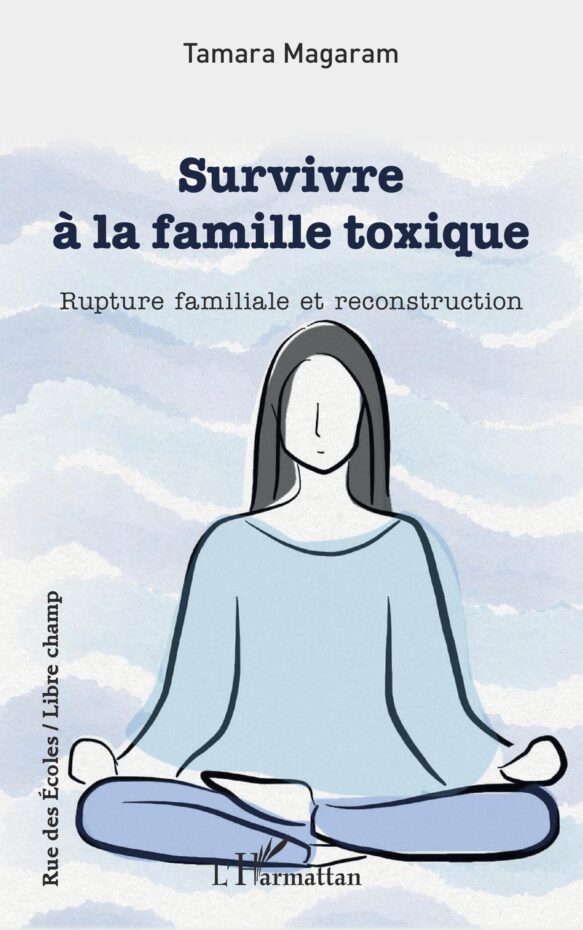 Connue surtout comme romancière, Tamara Magaram publie Survivre à la famille toxique, un « récit de vie » sur la rupture familiale, sur les mécanismes et les questionnements que celle-ci engendre, et surtout sur la reconstruction possible et nécessaire dans le long processus de résilience et de retour à la vie.
Connue surtout comme romancière, Tamara Magaram publie Survivre à la famille toxique, un « récit de vie » sur la rupture familiale, sur les mécanismes et les questionnements que celle-ci engendre, et surtout sur la reconstruction possible et nécessaire dans le long processus de résilience et de retour à la vie.
Avant de commencer notre discussion autour de votre nouveau livre, je ne peux m’empêcher de penser à votre ancien roman « Les âmes guéries » que vous avez publié quelques années auparavant. Y a-t-il un lien ne serait-ce que lointain entre Nina, l’héroïne de ce récit, et vous, puisque « Survivre à la famille toxique » est un livre écrit à la première personne ?
Le roman Les âmes guéries était une œuvre de fiction, le personnage de Nina était imaginaire mais elle avait vécu une enfance douloureuse auprès d’une mère malade, alcoolique et dépressive. Il peut y avoir certaines similitudes entre elle, l’héroïne du récit présent et moi. Les enfants qui ont grandi auprès de parents « défaillants » présentent des caractéristiques communes : une suradaptation permanente aux autres, des doutes prenants, une culpabilité constante, des symptômes divers qui peuvent se ressembler. Nina était une figure de résilience, comme son prénom le signifie en espagnol ; elle était cette « petite fille » qui semblait guérie de l’enfance et qui se questionnait sur la véritable nature de sa mère. Elle cherchait à l’humaniser, c’est en ce sens qu’elle peut ressembler à la figure du Je du livre Survivre à la famille toxique. Ce Je qui s’adresse est sorti d’un enfer, tout comme Nina, et c’est avec cette perception que ce Je peut s’adresser, tout comme Nina, cette perception propre à ceux qui ont connu l’horreur en famille, la souffrance et la maltraitance, mais qui ont répondu à cela par un élan de vie. Ils restent certes marqués et empreints de certains fantômes, mais leur vie quotidienne est apaisée, saine ; ils ont pu construire quelque chose et surtout ne sont pas condamnés à reproduire l’horreur vécue.
De quel courage a-t-on besoin pour aborder un tel sujet d’un angle si personnel ? A-t-il été facile de vous décider à l’écrire ?
Je ne pense pas qu’il faille du courage pour aborder ce sujet sous un angle intime ; je pense que c’est une nécessité qui s’impose à l’être après un certain nombre d’années. Au démarrage de l’existence, on vit en absurdie, quelque chose de puissant nous maintient dans une éducation néfaste, sordide, inadaptée, et même si on parvient à détecter que quelque chose ne fonctionne pas dans ce bain familial, on reste et on trouve le moyen d’aimer ses parents. Malgré ces alertes internes, l’enfant, l’adolescent s’adapte, supporte et prend sur lui le sordide de toute une éducation. Il y a ceux qui vont s’en accommoder, sans doute reproduire, et vivre tristement une vie avec une forte propension à l’autodestruction, et puis il y a ceux qui, à l’inverse, parviennent à poser un regard critique sur « l’éducation vécue », sur la violence de ce qu’ils ont connu, ou sur la perversité de leur jeunesse. Ceux-là vont souffrir plus que de raison, par la lucidité et l’analyse de ce qu’ils ont connu. Il peut être beaucoup plus violent à un moment de sa vie de reconnaître qu’on n’a pas été aimé, ou qu’on a été abusé, ou terriblement malmené que de subir en posant un voile sur ses yeux. Ceux-là, les lucides, arrivent à une étape où la violence du vécu ne peut plus être tue ; un travail de « guérison » peut alors commencer, loin des liens malades. Puis un jour, à un moment dans leur existence, ils peuvent réaliser qu’ils sont aujourd’hui « indemnes », qu’ils ont pu avoir une vie à eux, et qu’ils ont dépassé ces premiers maux. D’autres souffrent encore. Pour ces deux cas de figure, la nécessité de s’exprimer, de dire, de sortir du silence peut devenir vitale. Non seulement pour témoigner et espérer que ces mots atteignent d’autres personnes encore engluées dans leur passé victimaire, mais surtout parce qu’il y a le sentiment d’avoir échappé à quelque chose de totalement absurde et il faut le faire savoir. Comme tout ce qui est indicible, la maltraitance en famille est une bouillie opaque, camouflée, qui désintéresse tout l’entourage ; quand on l’a vécue, on a doublement souffert de la lâcheté des êtres qui auraient pu agir, faire cesser une situation, ou alerter. Ce silence du monde alentour, ce silence complice crée l’indicible et l’indicible est mortifère. Ne pas nommer ce qu’on ne pense pas pouvoir appréhender rend malade ; c’est ce silence qui tue les victimes, pas la parole. Donc, cette action de dire, de poser des mots, de délimiter, de donner vie et corps à ce qui a été vécu n’est pas un acte de courage, mais un acte de survie. C’est l’élan vital qui reprend le dessus. Il m’a été difficile de l’écrire, et même la période d’écriture a été difficile, lourde. Cette difficulté venait de relents de culpabilité ; on se sent coupable de dire, comme si parfois les anciens bourreaux pouvaient encore être là, et c’est cette culpabilité que l’on combat en continuant. L’éducation dans la violence et la déshumanisation crée le silence, et briser ce silence a un coût énergétique important. C’est comme une transgression ou une trahison ressentie, car la violence vécue si jeune crée comme un pacte avec le bourreau ; la victime se tait, elle sait instinctivement qu’elle doit se taire, et même si elle parle à l’époque où cela a été vécu, on ne la croira pas. La rupture du « pacte » du silence est difficile mais nécessaire car ce pacte n’existe réellement que dans l’esprit pervers du bourreau. Parler humanise et retire sa force d’action au bourreau. Les anciennes victimes ont tendance à mettre sur un piédestal leur ancien bourreau, à lui attribuer une force surhumaine qu’ils n’ont pas. Parler et dire permet de rappeler que ce n’était que des hommes ou des femmes, dans toute leur médiocrité et leur petitesse. Le silence maintient cette aura de fausse grandeur autour de celui qui a transgressé en violentant un enfant.
Plusieurs éléments pourraient nous aider à comprendre ce qui se cache derrière la formule de famille toxique : un parcours complexe, une famille maltraitante, une inconscience des actes et des souffrances que ceux-ci engendrent. Que se cache-t-il vraiment derrière ce syntagme ?
J’aime beaucoup la troisième signification que vous donnez : « une inconscience des actes et des souffrances qu’ils engendrent », je crois bien que la famille toxique réside là où l’altérité n’est pas reconnue, c’est-à-dire là où un ou plusieurs êtres en famille sont en si grande souffrance psychique qu’ils n’ont pas accès à l’autre, c’est-à-dire au mécanisme d’empathie. Dans ces familles, on retrouve toujours un ou deux protagonistes, dominants, qui souffrent de ce que les psychologues nomment une pathologie du narcissisme. Ces êtres se haïssent au point de ne pas saisir le lien humain ; rien n’a de valeur, l’autre n’est pas, il n’y a qu’eux. Après cela peut être plus complexe, dans certaines familles c’est lié à la maladie d’un des membres, ou à une addiction. Mais il faut toujours avoir en tête cette notion d’altérité et de place accordée à « autrui » en tant que membre de la famille. Si elle est absente, ce n’est pas bon signe ; un lien de souffrance et un rapport de domination peuvent surgir. Toutes les familles connaissent des dysfonctionnements, mais dans une famille saine, l’amour entre les membres, les mécanismes d’empathie vont empêcher qu’une barrière soit franchie. Dans les familles toxiques, toutes les barrières de bienveillance peuvent être franchies sans remords, car autrui n’est pas et n’a pas de valeur. Et votre phrase est très juste : on a souvent face à nous des bourreaux qui n’ont aucune conscience du mal qu’ils engendrent ; certains sont même persuadés de bien agir ou d’agir pour le bien du tiers tant ils sont pris dans leur propre souffrance qui les isole. La toxicité est un élément complexe à définir ; elle s’accompagne d’une forme d’ignorance de son existence.
À ce propos encore, qu’est-ce que « l’inégalité affective » qui touche, si l’on vous lit avec attention, le développement de l’individu et même l’équilibre de la société ?
J’ai pu constater que de nombreuses personnes étaient bien nées sur le plan économique, dans des familles aisées ; elles avaient reçu une éducation, des soins, mais elles avaient été détruites en parallèle par une éducation mortifère faite de mauvais traitements, de violences et d’abus, et les conséquences étaient terribles : autodestruction, addiction, suicide, vie gâchée… À l’inverse, j’ai pu observer que de nombreuses personnes venaient de milieux très modestes économiquement, avaient grandi dans des environnements avec peu de ressources financières mais avaient été aimées, entourées, encouragées ; ces personnes semblaient avoir une confiance en soi, un élan de vie inné. Ces personnes, une fois adultes, étaient totalement capables de s’élever socialement, de construire un foyer sain, de transmettre. Elles semblaient avoir reçu un capital de départ très précieux qui assure une vie apaisée pendant toute une existence. Les autres, même si elles détenaient des actifs financiers, avaient été cassées et brisées bien trop tôt pour avoir ce bon élan de vie qui nous maintient et semblaient vouées à des vies de souffrance. Le manque d’amour les avait freinées.
Il y a, selon vous, une sorte d’indicateur universel qui détecte l’existence de ce déséquilibre : le manque d’amour parental. « L’amour vrai ne se mesure pas », écrivez-vous. Qu’est-ce qu’un parent non aimant ou mal aimant ?
Je dis dans le livre que le point d’alerte peut être de se poser cette question : Suis-je aimé(e) par mon ou mes parents ? À partir du moment où un tel doute existe, cette question se justifie. L’amour est un ressenti, une consolidation intérieure ; lorsqu’on est aimé, on est aimé. Il n’y a pas de mesure, de chantage, de contreparties, ou de faveurs à accorder en échange. Ce n’est pas une monnaie transactionnelle, c’est un état d’âme qui se perçoit, se ressent. Après, il y a des marques et des preuves d’amour. Mais dans l’amour familial et filial, c’est plus du domaine du ressenti ; celui qui est aimé le perçoit et est souvent reconnaissant à un moment donné de cet amour. Dans certaines familles, les liens sont haineux, il y a de la violence, des insultes, une volonté permanente de diminuer autrui, l’enfant ou les enfants, ou un conjoint. Dans ce type de famille, la question de l’amour est fondamentale ; il est difficile pour moi de dire que l’amour peut cohabiter avec la violence, je pense que c’est antinomique. En revanche, il y a des familles dans lesquelles il y a pu avoir de l’amour à un moment donné et pourtant, avec le temps, les difficultés de l’existence, une maladie mentale ou physique, ces liens faits auparavant d’amour peuvent évoluer vers des liens haineux, l’autre versant de l’amour possible dans la souffrance. L’amour ne cohabite pas avec la haine mais il peut lui précéder. Le manque d’amour parental se vit et est visible dans les familles où les parents ne s’aiment pas suffisamment eux-mêmes pour pouvoir transmettre un sentiment qu’ils sont incapables d’éprouver. Dans ma famille, il y avait une haine de soi manifeste et l’éducation « voulait » transmettre cette haine de soi aux enfants ; mes parents se haïssaient eux-mêmes, ils n’avaient aucun amour-propre ni respect d’eux-mêmes, je pense qu’il leur était impossible d’éprouver de l’amour pour qui que ce soit, leur langage était haineux envers eux-mêmes aussi. Dans ces familles aux grandes souffrances psychiques et morales, il est parfois difficile de trouver trace du moindre amour.
La métaphore du poulpe qui suffoque avec ses tentacules celui ou celle qui en réalité devrait être aimé en dit long de tout le parcours douloureux d’un enfant non aimé. Pouvez-vous nous décrire en grandes lignes ce processus destructeur et aussi comment s’en sortir ?
La maltraitance psychologique et/ou physique provoque cet effet d’un poulpe qui serre dans ses tentacules et maintiendrait au fond de l’océan l’être. L’enfant s’habitue à la maltraitance ; tristement, si cette situation se répète, il y a comme une soumission à la maltraitance qui s’opère. Tout est fait dans la psychologie humaine pour que les enfants obéissent à leurs géniteurs, à ceux qui pourvoient à leurs besoins élémentaires. Le piège est là : le temps, l’habitude, les mauvais traitements conditionnent, tel un réflexe pavlovien, un être à se laisser dominer, à se laisser battre, abuser, malmener. L’enfant non aimé va chercher dans sa vie, son entourage, ses liens alentour, à rejouer et revivre ces situations qui lui sont familières. Les tentacules le tiennent ! Pour s’en sortir, il faut d’abord un esprit critique aiguisé, une capacité à diagnostiquer le mal vécu, et la force d’agir pour prendre les décisions qui limiteront les maltraitances. C’est par l’action qu’on s’en sort ; il faut poser des actes. Ces actes peuvent être s’éloigner d’une ou de plusieurs personnes, déposer une plainte ou une main courante, se rendre à un groupe de parole, entamer une psychothérapie…
Une autre métaphore, celle de la mémoire blessée, guirlande sans arrêt clignotante et douloureuse ?
Oui, cette métaphore est souvent utilisée dans la littérature dédiée aux traumas ; elle décrit la mémoire traumatique pour un large public. Je ne suis pas scientifique, mais je vais tenter de l’expliquer avec mes mots. Il y a dans la mémoire une partie d’elle-même qui se fige sous l’empire d’un événement traumatique vécu (viol, agression, violence, drame, guerre…). Cette partie figée reste comme en alerte et en éveil dans l’esprit de celui qui a vécu cet incident. Des années peuvent se passer, cette partie de la mémoire pouvait sembler dormante ou tue ; il suffit d’un simple élément, vu ou ressenti (quelque chose en lien avec les sens), pour raviver immédiatement cette partie de la mémoire. « Elle clignote » comme une guirlande ; elle surgit dans le réel de la personne concernée et vient la hanter, la tourmenter. C’est ce mécanisme qui fait que des vétérans de guerre peuvent, des années après, faire des crises en entendant à la télévision un son qui se rapproche d’un bombardement, ou que des femmes abusées dans l’enfance peuvent avoir un comportement de rejet instinctif dans une manifestation de tendresse ou un acte charnel. Les sens sont là, et l’espace-temps mémoriel concerné n’existe pas ; une partie de l’être est toujours là-bas, quelque part dans l’enfer vécu. Les maltraitances répétées pendant l’enfance et l’adolescence laissent cette empreinte, mais dans ce type de violences intrafamiliales, la répétition parfois fréquente rend difficile le travail thérapeutique sur la mémoire traumatique. Il est parfois plus simple de guérir un événement marquant que d’en soigner des milliers qui étaient le quotidien de vie de certains êtres devenus adultes aujourd’hui. La mémoire et l’espace-temps sont dissociés.
À ce stade de notre discussion, il nous faudrait aborder le sujet de la résilience esquissé déjà dans la question précédente. Le sous-titre même de votre ouvrage parle de « rupture familiale et reconstruction », et plusieurs chapitres abordent un long trajet de ce que vous appelez « un chemin de guérison ». Si la blessure est profonde, elle n’est pas inguérissable. Comment faire ?
Il n’y a pas de recette magique, malheureusement la tragédie de la maltraitance est dramatique, les conséquences sont tenaces, il y a quelque chose d’irréversible. Toutefois, il peut y avoir une guérison ; une vie peut se faire avec ces vécus, une vie apaisée, heureuse, aimante peut se construire sur un champ de ruine. Tous n’y ont pas accès, il faut des ressources, des actions ciblées…
Pour ma part, ce qui a permis de « guérir » a été une action radicale : la rupture familiale totale. Il m’a fallu être totalement coupée de ces personnes détruites pour avoir accès à une reconstruction, ensuite j’ai passé des milliers d’heures en groupe de discussion, j’ai réalisé plusieurs thérapies, et je n’hésite pas à revoir des thérapeutes régulièrement. Le travail a été aussi vertueux pour moi, de gagner une indépendance économique très tôt, de pouvoir apprendre des compétences, les exploiter, cela a eu un effet vertueux, comme un ancrage réel. Et bien évidemment, l’écriture, quel outil merveilleux de compréhension, quel outil de guérison ! Il y a une écriture qui guérit, qui bâtit, qui construit, c’est indéniable. Mais pour d’autres, cela sera ailleurs, dans un art, dans une action humaniste et militante, dans l’amour d’un foyer, dans la rencontre avec un être particulier, dans les voyages… La société regorge de moyens de compenser, de guérir nos âmes blessées. Il faut seulement aller vers ce qui nous fait du bien, fuir telle la main du petit enfant sur le poêle de la cuisine, les situations génératrices de souffrance et si ces situations sont le fruit de plusieurs relations, il ne faut pas hésiter à mettre des distances avec les êtres qui créent ces souffrances.
Aussi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne consomme pas de substances qui joueraient sur les états d’âme et cela fait aussi partie du chemin de guérison, il faut tenir à distance certaines addictions et surveiller son rythme de vie. Peut-être les plus grands blessés de l’enfance doivent adopter une hygiène de vie plus stricte que le commun des mortels, mais cela en vaut la peine.
D’autres outils peuvent aider en fonction des symptômes vécus, comme la méditation, le yoga… toutes les actions qui peuvent faire du bien et maintenir dans le monde réel sont à prescrire et toutes celles qui génèrent de la souffrance, de l’isolement ou de la dépendance seraient à proscrire !
Si des symptômes restent, il faut aussi accepter par moment d’avoir des vulnérabilités liées à notre passé, à nos enfances, cela fait aussi partie de la guérison. Des cicatrices restent mais n’empêchent pas de vivre. Guérir, c’est aussi avoir la capacité de ne jamais se mettre une pression pour être comme tout le monde. Les séquelles peuvent être vécues au quotidien sans être trop handicapantes.
Justement, l’écriture : « J’ai écrit ce texte pour permette à d’autres de ne pas vivre cette honte », notez-vous. Quel est le but ultime de ce livre ? Faut-il comprendre qu’au-delà du témoignage il y a toujours une main tendue ?
J’ai longtemps eu honte d’avoir grandi dans cet environnement, d’avoir entendu, vu et assisté à des choses que je n’aurais pas dû connaître en tant qu’enfant ou adolescent. J’avais terriblement honte du système moral de la famille dans laquelle je suis née. Ils étaient sans repères moraux, déviants, avec de la perversité dans leur fonctionnement. En grandissant, on a tendance à protéger le groupe, à ne pas vouloir ternir l’image du groupe, ainsi j’ai caché pendant des années ce à quoi j’avais assisté, et cela a cultivé une honte terrible en moi, le sentiment d’avoir grandi dans la vase. L’absence d’humanité de mes géniteurs, les réflexions effroyables ou les actions dégoûtantes qu’ils pouvaient avoir, me faisaient honte. Écrire, dire, en quelque sorte, c’est une façon de rompre avec la honte. Il y a évidemment une volonté de révéler ce qu’on a vu, aussi absurde ou indicible que cela soit. Et puis, en groupe de parole, j’ai pris conscience que cette triste réalité est partagée par beaucoup d’autres. Témoigner c’est aussi une façon de se relier à tous ces autres, de se sentir moins seul(e) et peut-être, qui sait, de donner l’envie à autrui de « dire » aussi. La parole libre sauve, j’en suis convaincue ; les témoignages sont nécessaires pour cela. Il faut que la parole soit prononcée mais aussi entendue. La guérison commence ici. On perd la honte quand elle est partagée par d’autres.
Une dernière question plus personnelle, si vous me permettez. Qu’est-ce devenir mère, alors que vous vous apprêtez à le devenir ?
Devenir mère est un sentiment unique à chacune, je pense. Devenir mère quand la nôtre a été profondément défaillante est complexe ; il est important d’être bien entourée. Je ne suis plus très jeune, j’ai trente-cinq ans, j’ai attendu ce moment, et c’est une bonne chose, car j’ai eu le temps de réfléchir à mon vécu, d’identifier ce qui a été défaillant et ce qui méritait d’être préservé. C’est naturellement merveilleux d’accueillir cette nouvelle, vécue comme une grâce. La maternité avait été un sujet entaché dans mon éducation. Cependant, il y a des moments où l’absence de « mère » peut être douloureusement ressentie ; on pourrait souhaiter vivre ce moment avec sa propre mère aussi, comme le lien béni d’une transmission de génération en génération, et malheureusement, je ne connaîtrai pas ce plaisir d’avoir une « mère » avec qui partager.
C’est aussi en devenant mère que l’on réalise à quel point nos géniteurs ont souffert. Quand notre expérience est radicalement différente, on comprend à quel point les personnes qui nous ont donné la vie étaient vulnérables et défaillantes.
Propos recueillis par Dan Burcea
Crédit photo © Maddyness
Tamara Magaram, Survivre à la famille toxique, Rupture familiale et reconstruction, Éditions L’Harmattan, 2023, 128 pages.

