
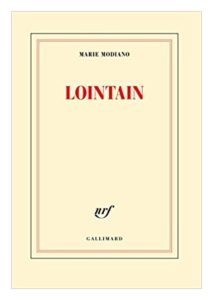 Dans le vocabulaire théâtral, «le lointain» désigne la partie de la scène la plus éloignée du public, le fond de celle-ci, lieu opposé, par conséquent, à celui qui demande aux acteurs de se mettre dans une perspective plus visible et facilement détectable, et cachant, quant à lui, leur vulnérabilité. Le choix de Marie Modiano de donner ce nom comme titre à son roman n’est pas dû au hasard. Son personnage, Valentine, avec lequel elle a beaucoup de traits communs à la fois de par son métier d’actrice et de chanteuse et de par sa démarche romanesque qui la pousse à se retrancher dans les coins les plus éloignés d’une existence à la recherche de sens et d’amour. Les deux plans narratifs suivent la même logique, prenant vie dans deux discours différents, un à la première personne – un je qui raconte la vie de Valentine l’actrice et la chanteuse dans le présent de ses dix-neuf ans –, l’autre à la troisième personne – un elle qui lui permet de retourner quelques années en arrière, lorsqu’elle rencontre à Paris, sur le Pont des arts, un jeune américain qui veut et qui va devenir un écrivain célèbre. Rien donc de plus beau que cet âge accessible aux rêves et préfigurant un destin dont la jeunesse et l’amour promettent un vertigineux épanouissement. Mais alors comment expliquer ces affirmations pour le moins troublantes que la jeune amoureuse note dès le début du roman :«Que la vie me paraît lointaine… Je n’ai que dix-neuf ans et l’étrange impression que tout est déjà derrière moi» ?
Dans le vocabulaire théâtral, «le lointain» désigne la partie de la scène la plus éloignée du public, le fond de celle-ci, lieu opposé, par conséquent, à celui qui demande aux acteurs de se mettre dans une perspective plus visible et facilement détectable, et cachant, quant à lui, leur vulnérabilité. Le choix de Marie Modiano de donner ce nom comme titre à son roman n’est pas dû au hasard. Son personnage, Valentine, avec lequel elle a beaucoup de traits communs à la fois de par son métier d’actrice et de chanteuse et de par sa démarche romanesque qui la pousse à se retrancher dans les coins les plus éloignés d’une existence à la recherche de sens et d’amour. Les deux plans narratifs suivent la même logique, prenant vie dans deux discours différents, un à la première personne – un je qui raconte la vie de Valentine l’actrice et la chanteuse dans le présent de ses dix-neuf ans –, l’autre à la troisième personne – un elle qui lui permet de retourner quelques années en arrière, lorsqu’elle rencontre à Paris, sur le Pont des arts, un jeune américain qui veut et qui va devenir un écrivain célèbre. Rien donc de plus beau que cet âge accessible aux rêves et préfigurant un destin dont la jeunesse et l’amour promettent un vertigineux épanouissement. Mais alors comment expliquer ces affirmations pour le moins troublantes que la jeune amoureuse note dès le début du roman :«Que la vie me paraît lointaine… Je n’ai que dix-neuf ans et l’étrange impression que tout est déjà derrière moi» ?
Curieuse distanciation qui mérite bien une attention particulière, surtout parce que l’attitude du personnage de Marie Modiano est loin de ressembler à une quelconque posture romanesque. Elle ne peut pas non plus être assimilable à un bovarysme précoce. Son repli face à la réalité et au temps la pousse vers un plongeon quasi irréversible dans les eaux troubles d’une mémoire incapable de retrouver ses repères dans le réel, la faisant «déambuler parmi les ruines et le silence». La source de ce désespoir est la solitude engendrée par la promesse non tenue de son amoureux, en laissant derrière lui ces mots éperdument inconsolables et mystérieux : «Je serais de retour avant la tombée de la nuit». Cette phrase devient pour Valentine l’antienne de l’oubli et de l’absence, preuve incontestable de la fragilité de la parole donnée dans le jeu de la séduction, devenue par son altération le symbole du mensonge amoureux, une sorte de scribere in aqua, pour reprendre la formule catullienne. C’est une des raisons pour laquelle elle note désespérée : «Combien de fois la nuit était-elle tombée depuis qu’il les avait prononcées ? Autant de questions auxquelles il lui était impossible de répondre».
Cette solitude amoureuse n’est pas pour Valentine son unique calvaire. Sa vie professionnelle, pour utiliser ici un barbarisme du monde plus que réel, en est également bouleversée : ses prestations théâtrales et ses concerts dans des piano bars sont loin de la ravir et de compenser le sentiment omniprésent d’insatisfaction voire d’exclusion d’une humanité dont elle a du mal à comprendre et encore moins accepter les codes. Lorsqu’elle intègre la troupe théâtrale de Haens Brugge, elle sait que les quelques lignes de versification qu’elle aura à prononcer sur scène ne feront pas d’elle une grande artiste. C’est d’ailleurs à se demander si c’est cela qu’elle veut. En tout cas, pour Valentine la différence entre artiste et comédienne est si tranchante et tranchée que celle-ci finit par refléter la vraie conscience qu’elle a de son talent et de son avenir sur les planches, y compris dans des lieux prometteurs d’une célébrité invraisemblable. Au lieu de cela, elle notera plutôt les humeurs, les caprices, les routines qui guettent les vies itinérantes de ses camarades artistes, mais aussi sa solitude à elle, ses doutes quant à sa vocation et à son avenir, son indifférence devant la beauté des lieux et devant le présent qui somnole. Valentine se laisse emportée par «un parcours fléché pour ne pas perdre pied et sombrer». Plus grave encore, elle est convaincue que son «avenir est donc déjà tout tracé, de théâtre en théâtre, de chambre d’hôtel en chambre d’hôtel, jusqu’à ce que tout cela se confonde et qu’il soit impossible de distinguer un lieu d’un autre».
Arrivée à ce point de l’intrigue, Marie Modiano sait que son héroïne a besoin de s’affranchir de cette asphyxie du réel d’où elle cherche en vain à se soustraire à coup de verres de vin, de whisky ou d’autres alcools, et surtout d’apaiser le poids du «profond sentiment de ne venir de rien pour aller nulle part». Pour cela, Valentine n’aura pas besoin d’aller trop loin, cette traversée du miroir a lieu étonnamment dans les mêmes couloirs du théâtre, un soir où elle ressent le besoin salvateur, presque enfantin, de s’enfermer à clé, dans le calme des loges et des salles de maquillage. Selon elle, «tout est ici une imitation de la vie, mais la vie même n’existe pas, elle a déserté la scène», alors que «la mort, quant à elle, est invisible, joué à court ou à jardin». Ces phrases prononcées à la hâte dans une obscurité qui se veut rassurante comme un aparté jamais avoué, nous mettent devant le vrai spectacle qui se joue cette fois dans la vraie vie de Valentine, celui de la fragilité de l’être face au mutisme de l’attente, à la solitude et à l’incessant travail destructeur de la routine.
Pour guérir de cet abandon elle a besoin d’une factualité sublimée. Une avalanche de questions envahit alors son discours, juste au milieu du roman : «Comment ne pas craindre ce que la vie nous réserve quand on joue en permanence un rôle ? Comment ne pas redouter que tout votre monde s’écroule quand ce dernier est construit de brins de paille prêts à s’enflammer à chaque instant ?» Voguer sur les crêtes de la fiction, s’aventurer sur des océans où rêve et réalité coexistent sans même crier gare, deviendrait chose impossible devant ce monde fait «de sous-entendus, de mystères, de non-dits… de trac». Tout est dit dans cette énumération réconfortée dans sa brièveté par un cynisme qui démolit dans l’âme amoureuse de Valentine l’espoir du retour annoncé et jamais tenu de son amant écrivain avare de son identité, ne signant que par ses initiales M. J.
Il est évident que, vu de cette perspective de l’abandon, le roman de Marie Madiano prend ici toute sa force. Mais n’y a-t-il pas un autre angle de vue de ce dense récit? Malgré sa relevance, le sentiment d’abandon n’est pas l’unique thème de cette narration qui est aussi imprégnée du regard inductif sur la condition de l’artiste, sur ses interrogations voire ses tribulations pour arriver à l’accomplissement de son destin créateur. Il suffit de refaire le portrait de ce mystérieux M.J., de considérer la fragilité de son être, de comprendre son cheminement, sa fuite en avant, la possession exercée par la fiction et par sa folie pour s’en rendre compte de sa vraie identité. N’est-elle pas, cette damnation, la part réservée depuis toujours au combat des génies avec le monde et avec eux-mêmes ? La réponse renouvelée ici par Valentine arrive à nous convaincre de la véracité de ce combat entre fiction et réalité, entre l’écrivain et le monde : «La fiction avait pris le dessus depuis longtemps sur la réalité et c’est cela même qui lui donnait de l’oxygène et qui parvenait, non sans mal, à le maintenir debout. Ainsi, en glissant chaque parcelle de vécu dans son œuvre et en sacrifiant tout afin de le transcender à travers l’écriture, il se consommait à petit feu sans s’en rendre compte».
Munie d’une Photomaton usée qu’elle finit par égarer dans une de ses pérégrinations d’artiste dans une ville de province, l’inconsolable Valentine se contentera-t-elle du seul trésor des mots si sagement rangés dans des vers comme ceux-ci : «Des mots précédés de tirets/Qui s’alignent, dénués de sens,/Illusion de contenir le monde,/Celui qui me semble si vaste,/Effrayant.» ? Arrivera-t-elle malgré ces paroles qui transcrivent ses peurs à faire durer le souvenir d’un temps heureux qui se dérobe à la captativité de sa mémoire ? Ou sera-t-elle «condamnée à observer pour toujours, à travers la vitre» un monde qui ne garde «qu’une impression lointaine, celle d’une histoire qu’elle n’était plus si sûre d’avoir vécue» ?
Tout cela reste à découvrir dans les pages de ce roman passionnant qui invite le lecteur à suivre le chemin sinueux de son héroïne vers un bonheur qui se dérobe à l’évidence, renvoyant sans cesse son désir à un lointain dont on finit par comprendre la vraie signification fuyante et goûter à sa saveur douce-amère, alors que du côté cour ou jardin se joue un autre spectacle qui n’a pas finit par nous émerveiller et nous effrayer en même temps.
Dan Burcea
Marie Modiano, Lointain, Editions Gallimard, 2017, 176 p.19 euros.

