
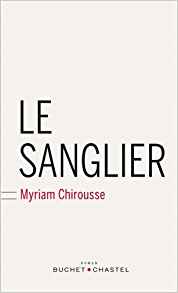 Voici un livre dont il serait injuste de faire l’économie de l’éloge : discret, sans éclats de voix ni gestuelle ou pirouettes de style, mais avec une juste tonalité et une très bien dosée tension narrative, «Le Sanglier» est un exercice littéraire très abouti que Myriam Chirousse assume parfaitement, et cela malgré des contraintes de style qui renvoient au genre dramatique et donc étrangères au roman qui s’accommode difficilement avec ce type d’assujettissements. Car, sinon, comment qualifier cette préférence pour la concision et cette résistance aux tentations d’expliquer les choses si ce n’est par une intelligente adaptation du récit à une intention auctoriale qui maîtrise parfaitement l’art de la construction narrative et le subtil secret des vies complexes des protagonistes de son récit ? Dans une récente interview, Myriam Chirousse insiste sur le refus d’accorder à son texte une quelconque valeur d’épiphrase.
Voici un livre dont il serait injuste de faire l’économie de l’éloge : discret, sans éclats de voix ni gestuelle ou pirouettes de style, mais avec une juste tonalité et une très bien dosée tension narrative, «Le Sanglier» est un exercice littéraire très abouti que Myriam Chirousse assume parfaitement, et cela malgré des contraintes de style qui renvoient au genre dramatique et donc étrangères au roman qui s’accommode difficilement avec ce type d’assujettissements. Car, sinon, comment qualifier cette préférence pour la concision et cette résistance aux tentations d’expliquer les choses si ce n’est par une intelligente adaptation du récit à une intention auctoriale qui maîtrise parfaitement l’art de la construction narrative et le subtil secret des vies complexes des protagonistes de son récit ? Dans une récente interview, Myriam Chirousse insiste sur le refus d’accorder à son texte une quelconque valeur d’épiphrase.
Pour mieux comprendre sa démarche, tournons-nous vers la dramaturgie classique avec ses bons vieux outils des trois unités et placer son récit sous les bien connues contraintes de temps, de lieu et d’action. Inutile d’espérer de croiser, en revanche, les somptueux héros dont nous ont habitués Corneille et Racine : Christian et Carole, le couple de trentenaires dont parle le roman de Myriam Chirousse, ces êtres plongés dans une existence banale, convaincus de naviguer comme «des gouttes dans un océan, trop petits, incapables en fin de compte de choisir le sens de la vague» ressemblent plutôt à M. et Mme Smith, leurs aînés de la «Cantatrice chauve» d’Eugène Ionesco. Le décor semble, lui aussi, emprunter la même insignifiance qui renvoie vers le monde dans lequel ils évoluent, préférant le village à la grande ville et espérant ainsi retrouver le calme tant rêvé du décor montagneux qui les entoure. Cet isolement s’accommode très bien avec l’obscurité qui règne à l’intérieur de leur foyer, et qui s’insinue non seulement dans leur maison, mais aussi dans leur regard. Il suffit de lire les premières phrases du livre qui font ici office d’une véritable didascalie : «Dehors tout est noir. C’est une nuit de gel à pierre fendre mitée d’étoiles, sans lune qui argente les montagnes. Dedans, la maison est aussi sombre qu’une mine. […] Les yeux ouverts, ils ne regardent rien. Ils écoutent immobiles le règne infini du silence, le temps qui ne coule plus.» Les dialogues qui se tissent entre Christian et Carole prennent à leur tour la forme discontinue et déclarative des répliques théâtrales, entrecoupant le temps narratif en une succession de phrases parcimonieuses qui pulvérisent la communication en une multitude de platitudes qui érodent le discours et ouvrent ainsi la porte à l’absurde. C’est ainsi que se produit l’entrée en matière du récit, reposant sur la base d’un faux semblant de paronymie sur fond de confusion auditive entre deux êtres à peine sortis du sommeil et dont on se demande s’ils sont capables de relever le sens de ce quiproquo. Voici reproduit ici, pour illustration, ce dialogue qui use de la stichomythie pour nourrir son dynamisme. C’est Carole qui parle la première :
– « Tu avais l’air de faire un cauchemar.
– Quoi ?
– Tu faisais un cauchemar ?
– Pas vraiment.
– Tu rêvais de quoi ?
– De rien. D’un truc débile.
– Mais c’était quoi ?
– Que j’avais les dents cassées. […]
– Tu as dit quelque chose.
– J’ai dit quoi ?
– Je ne suis pas sûre, je crois que c’était un mot comme sanglier.
– Sanglier ?
– Oui, je crois. Pourquoi tu as dit ça ?
– Je ne sais pas.
– Ça ne te dit rien ?
– Non, c’est quelle heure ? »
En choisissant de décrire une journée de leur vie ordinaire, Myriam Chirousse ouvre à ses personnages le décor d’une scène à la mesure de leur vie tout aussi banale. Le décor central est le supermarché, lieu de l’uniformité et de l’ennui, laissant transparaître plutôt la difformité des êtres et les renvoyant ainsi vers un miroir bancal et donc traître. Dans l’aparté d’une cabine d’essayage, Carole a le sentiment d’avoir trop vieilli, «le miroir lui révèle un corps qui lui rappelle sa mère autrefois […] avec le même creux sur les hanches, les mêmes seins, la cellulite et cette peau pâle et caoutchouteuse qui deviendra flasque en vieillissant». L’expérience que fait à son tour Christian dans le magasin «ModHom» en essayant de profiter du bon-cadeau offert par Mamivette relève de la même désillusion, «ce magasin n’est pas pour lui, rien ne lui correspond». De quoi perdre le nord, pense Carole, voyant son homme incapable de se mouvoir dans ce labyrinthe de gens, de voitures, de machines à retirer des sous et de tant d’autres complications, et se demander si elle sera capable de garder la flamme de l’amour qui la lie à cet être tellement fragile, gauche, presque psychorigide. C’est, pour elle, «une mission d’un autre âge, magdalénienne, caverneuse : garder le feu allumé pour que ne s’éteigne pas la tribu, que perdure le foyer». Sauf que, malgré toute leur bonne volonté, tout part de travers dans ce samedi vraiment maudit, tant les incidents s’enchaînent prenant des proportions insurmontables. Même la visite chez Mamivette, qui était le but principal de leur aventure urbaine, a la couleur du déjà vu, d’une banale répétition, d’une routine hebdomadaire sans place pour le lien familial.
Arrivée à ce stade, la narration pourrait s’effondrer sur elle-même, imploser et succomber à l’aridité qui ferait pâlir toute compassion et tout empathie avec le lecteur. Ce serait sans compter sur l’humanité dont Myriam Chirousse inonde son récit, en plaçant ses personnages dans une lumière qui nous aide à voir au-delà des apparences, à l’intérieur de ces âmes blessées par le doute, contaminés par l’insignifiance et la laideur du monde. Cette touche de sensibilité nous fait penser aux personnages de Gogol, à ces êtres perdus dans les couloirs d’une implacable condition humaine avec laquelle ils semblent s’accommoder au prix d’une incommensurable candeur avec laquelle ils essayent d’atténuer (ou de tromper ?) leur souffrance. C’est justement le crédo de Christian et Carole et, sans doute, de tant d’autres comme eux, exprimé ainsi : «Ils se disent parfois que tout ça, la scierie (où travaille Christian, n.n), les vieux habits (que reconditionne et essaie de vendre Carole, n.n.), c’est du provisoire, qu’ils vont faire autre chose. Ils s’inventent des projets, s’imaginent autrement, ailleurs, pendant que le vent souffle sur le toit de la maison».
Tout pourrait donc finir par s’arranger, rentrer un jour dans l’ordre, tenir jusqu’à de meilleurs jours pourvu que ce provisoire ait une fin. Sauf qu’ici, dans l’obscurité permanente et le silence des montagnes, le seul signal audible, c’est le bruit du vent sur le toit de la maison de Carole et Christian, et que ce bruit a toutes les chances d’abîmer leur bonheur – la moitié du toit s’est envolée, et c’est une toile qui la remplace, encore un symbole d’une immanquable soumission à tous les dangers de tant de vents contraires.
Dan Burcea (30.01.2017)
Myriam Chirousse, Le Sanglier, Editions Buchet Chastel, aout 2016, 180 pages, 14 euros.

