
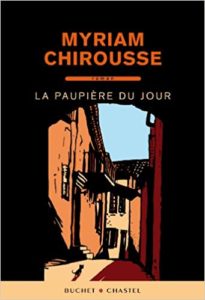 Lorsque Cendrine Gerfault, l’héroïne principale du roman de Myriam Chirousse, franchit la frontière du village de Barjouls, elle est loin d’imaginer qu’elle foule sous ses pieds un territoire totalement inconnu, un monde à part, un huis clos où elle devra résoudre une des plus compliquées équations de sa jeune existence, celle de venger la mort tragique de son fiancé Aymeric. Et, même si elle n’a aucune idée de la stratégie qu’elle va utiliser, elle possède une volonté à faire bouger les montagnes pour atteindre son but.
Lorsque Cendrine Gerfault, l’héroïne principale du roman de Myriam Chirousse, franchit la frontière du village de Barjouls, elle est loin d’imaginer qu’elle foule sous ses pieds un territoire totalement inconnu, un monde à part, un huis clos où elle devra résoudre une des plus compliquées équations de sa jeune existence, celle de venger la mort tragique de son fiancé Aymeric. Et, même si elle n’a aucune idée de la stratégie qu’elle va utiliser, elle possède une volonté à faire bouger les montagnes pour atteindre son but.
Mais alors pourquoi, à la fin de cette aventure, elle note dans son journal ces phrases surprenantes: «Je ne peux pas dire ce qui s’est passé. Comme tout le monde, je ne fais qu’imaginer» ? Que s’est-il donc passé entre temps ? A-t-elle inventé ces paroles ou ne fait-elle que répéter par mimétisme ce qui semble être devenue une devise bien rodée du monde dans lequel elle vient d’atterrir ? Pourquoi ce glissement qui la fait prendre soudainement une curieuse distance avec la réalité, et pourquoi ce refuge dans un imaginaire tellement étrange ?
Ces questions ont ici toute leur importance : elles nous plongent dans le vrai questionnement de ce roman, surtout lorsque l’on vient à aborder la surprenante maîtrise avec laquelle Myriam Chirousse construit son discours narratif, contournant ainsi les pièges qui risquent de confisquer l’action de son roman au bénéfice de tel un tel genre littéraire. Préférant naviguer avec aisance du roman à suspense au polar et du huis clos à un récit où intrigue et guérison de soi se dévoilent dans toute leur splendeur, elle préfère ouvrir larges les portes d’un monde fictionnel où son héroïne doit se réinventer à la lumière de toute une série de nouveaux repères qui prendront brutalement le dessus sur ses projets initiaux. Dès lors, un permanent dialogue intérieur va s’installer bouleversant tous les projets de Cendrine jusqu’à modifier complétement, comme nous l’avons formulé plus haut, sa manière de voir le réel. Mais, avant d’aborder en détail l’intrigue de ce roman, arrêtons-nous un instant sur la démarche littéraire de Myriam Chirousse, démarche dont le but est, à mon sens, d’illustrer avec les moyens de la narration le contenu de la métaphore qui donne le titre du roman – «la nuit n’est que la paupière du jour» – provenant d’un quatrain d’Omar Khayyâm. Ainsi, pourrait-on considérer l’action de ce livre comme un battement de paupières, suprême liberté pour des yeux qui semblent «cousus cil à cil» – comme ceux de Cendrine – liberté de vaincre l’obscurité par la lumière, de pouvoir passer de la réalité brutale et de la cruauté des hommes à la lumière du regard intérieur, du silence à la mémoire et à la parole capable de guérir les blessures des créatures plongés dans une impossible cohabitation avec leur passé.
Myriam Chirousse aime faire avancer l’action de son roman au gré de ces réalités contrastées qu’elle décrypte sous un regard en noir et blanc, vision plutôt proche de la tragédie, tant ces vies sont soumises à la déclivité d’un instant décisif, irréversible, fatal et définitif dont elles en dépendent entièrement : moment de la mort qui surgit de nulle part, jalousie qui rode, corruption et crime, des maux qui sévissent ailleurs, si lointains, si proches. Voilà pourquoi espace et temps vont prendre une place à part dans la construction de sa narration, un espace/temps déjà blessé par une antériorité tragique, mais aussi un espace/temps soumis sans cesse, comme nous allons le voir, à une fatale et tant redoutée finitude. Désormais, des mots comme «déluge», «apocalypse», «cauchemar» vont parsemer les pages du roman pour traduire soit des éléments de paysage, soit des inquiétudes humaines portant sur une sorte d’imminent danger, une apocalypse annoncée. C’est donc avec cette sensation d’asphyxie que vit Cendrine depuis l’événement tragique de la mort d’Aymeric, son fiancée, lors du braquage d’une bijouterie. Depuis ce jour, elle vit comme si une balle transperçait son cœur tous les matins, après des nuits de cauchemar, sa salive a «un goût de fatigue, de plateau d’aire d’autoroute, de kilomètres interminables».
Alors, dix-huit ans après les faits, elle décide de partir chercher l’assassin d’Aymeric, le débusquer dans sa tanière et de venger sa mort. C’est ainsi qu’elle débarque presque à minuit dans ce village de montagnards d’où était originaire Benjamin Lucas, l’assassin, et où il vivait après avoir purgé sa peine de prison. L’endroit est particulier, une sorte de «bourgade animée, d’un autre monde déjà, avec son école primaire, sa gendarmerie, ses trois bar-tabacs, son bureau de poste, son centre médical et une boutique d’artisanat local […]». Ses habitants sont encore plus étranges, «des gens qui se faisaient la guerre pour trois fois rien, une peuplade de villageois primitifs qui poussaient des grands cris et se cognaient la poitrine pour des territoires, des femelles, un peu plus de pouvoir au sein du clan». Dans ce décor et en compagnie de ces gens, Cendrine va mener discrètement son enquête pour trouver Benjamin Lucas. D’abord, en gardant un secret absolu sur la raison de sa présence dans ce village isolé «aux confins des Alpes-Maritimes, dans une vallée encaissée, coupée presque de tout». Officiellement, elle est botaniste et sa mission est de prélever des échantillons faisant partie de la diversité végétale de la région. Ce n’est qu’après avoir réussi à se familiariser avec les lieux et les habitants qu’elle commence son discret travail de détective. Sauf que sa curiosité intrigue les villageois, comme, par exemple, le vieil Inca, personnage pittoresque, qui lui conseil la prudence : «Parce qu’ici, mademoiselle, on ne cherche pas à savoir. Ici on règle ses comptes, un point c’est tout. […] Méfiez-vous de la curiosité des gens. Et méfiez-vous surtout de votre propre curiosité».
Véritable huis clos où des regards indiscrets s’espionnent à profusion mais, surtout, où chaque habitant cache le secret de toute une communauté condamnée à vivre avec des drames insoupçonnés. C’est la raison pour laquelle la mission de Cendrine va être confrontée à beaucoup d’obstacles et va prendre un tournant dans son déroulement. Myriam Chirousse transfère petit à petit l’attention du lecteur vers les éléments narratifs appartenant aux secrets de famille de ses personnages et fait lever le voile des lourds drames qui perdurent depuis des générations parmi les habitants de ce village condamné au silence. Cendrine semble submergée par cette accumulation de secrets et de drames qui la conduisent vers une vérité tout-à-fait différente de celle avec laquelle elle était arrivée et qu’elle imaginait, des drames encore plus profonds dont les protagonistes sont à chercher ailleurs. Mais, surtout, des drames qui marquent à tout jamais des êtres définitivement blessés. Le seul refuge est cette indélébile souffrance qui revient sans cesse hanter leur conscience. Tel est le cas de Charlotte Lucas, personnage complexe, plein de contrastes et marqué par la souffrance. Elle note dans son journal : «Parce que je voudrais croire à une autre réalité que la réalité, et c’est comme un bistouri dans le crâne qui me fait des petites entailles».
Quel remède pour guérir cette douleur, quelle force plus forte que la justice des hommes ?
Devant ces questions, il ne reste à Cendrine que de s’abandonner entre les mains confiantes de la vérité qui resurgit brutalement du passé, dans une sorte d’ultime confrontation avec le principal coupable de toutes ces tragédies et dans une sorte d’intimité avec la mort, scène digne d’une tragédie grecque. Il ne lui reste que faire le deuil de son premier amour, se laisser emporter par d’autres rêves pour que ses matins ne suffoquent plus son âme sous le poids de la tragédie et pour que ses draps «sentent bon comme le lait chaud». Curieuse odeur du bonheur dont elle seule a le secret… mais que chacun de nous, se laissant transporter par son désir de redevenir enfant, porte dans ses souvenirs les plus lointains. Et c’est peut-être celui-ci le grand secret d’écrivain de Myriam Chirousse : celui de prendre soin de ces âmes abandonnées pour leur offrir à la fin un coin de paradis dont elles avaient oublié de rêver ou dont elles ignoraient depuis toujours l’existence.
Vu de cet angle, «La paupière du jour» devient le roman de la victoire timide de la vie sur la mort, nous rappelant sans cesse qu’au-delà de toutes nos douleurs, la vie nous réserve bien des surprises dont elle seule a le secret. Il nous rappelle également qu’au-delà de toute obligation que le passé nous impose, il reste écrit dans les étoiles ce que nulle intelligence n’est capable de déchiffrer. Et cela porte le nom de l’intelligence du cœur ou le discret nom du bonheur intérieur.
Dan Burcea (11.08.2014)
Myriam Chirousse, «La paupière du jour», Éditions Buchet Chastel, 2013, 505 pages, 22 euros.


Soyez le premier à commenter