
Motto: «Pourquoi s’obstiner à écrire si l’on n’a plus rien à dissimuler?» (Alexandre Jardin)
Homo mediaticus et la permanence de l’idéal esthétique
«Vivre, c’est voir», s’extasie dans une ample respiration romanesque, dédiée à la peinture de Delacroix, Florentine Galien, le personnage principal du livre de Michelle Tourneur, La beauté m’assassine, publié récemment aux Éditions Fayard. Occasion pour nous de nous demander si cet éloge du regard est encore en mesure aujourd’hui d’embrasser le monde, en donnant du sens aux verbes «voir» et «vivre», et si l’homme contemporain, dans son hypostase de homo mediaticus, doté de tous les attributs de la virtualité numérique où cohabitent l’instantanéité, la gratuité et l’ubiquité de l’accès à l’image, peut encore avoir accès à l’unicité et à la permanence du modèle esthétique intrinsèque liée aux arts de l’image.
 Et pourtant, jamais avant, les musées n’ont connu une telle affluence de visiteurs. Un exemple éloquent est le récent communiqué de presse qui annonce en ce début d’année que l’exposition dédiée au grand peintre américain Édouard Hopper, inaugurée en octobre 2012 au Grand Palais, et qui devait fermer ses portes le 28 janvier, sera ouverte 6 jours de plus, le musée parisien restant ouvert sans interruption pour faire face au nombre impressionnant de visiteurs – 6800 personnes par jour en moyenne, 580 000 visiteurs, en 4 mois.
Et pourtant, jamais avant, les musées n’ont connu une telle affluence de visiteurs. Un exemple éloquent est le récent communiqué de presse qui annonce en ce début d’année que l’exposition dédiée au grand peintre américain Édouard Hopper, inaugurée en octobre 2012 au Grand Palais, et qui devait fermer ses portes le 28 janvier, sera ouverte 6 jours de plus, le musée parisien restant ouvert sans interruption pour faire face au nombre impressionnant de visiteurs – 6800 personnes par jour en moyenne, 580 000 visiteurs, en 4 mois.
La force inégalable de la peinture, comme hommage à l’instantanéité, comme fête jubilatoire pour l’œil, résiderait donc dans l’exigence de cette rencontre unique, de ce face-à-face vécu comme une suprême victoire du visuel qui réussit à ignorer les moyens et la profusion des reproductions en faveur d’un dialogue intime avec les vrais tableaux, consacrés par l’histoire de l’art et par les générations comme des chefs-d’œuvre.
Dans ce contexte, Paris abrite un lieu où l’art exerce auprès de millions de touristes une vraie attraction, comme un mirage, tel que l’académicien Frédéric Vitoux le décrit dans son livre Paris vu du Louvre : «L’immuable et l’éphémère, l’éternité et l’instantané, le passé et le présent échangent leurs attributs. Paris devient un miroir, un prisme où se reflètent et dialoguent la pierre et la chair, le désir et la sérénité, le mouvement et l’attente. Difficile de ne pas se laisser gagner par la beauté ou, mieux, par la sagesse d’un tel lieu. Le Louvre instille un peu d’art à Paris, entraîne les siècles, les styles, les formes, les hommes, les statues, les tableaux vivants tout court dans une sorte de maelström où tout s’oppose, se complète et s’enrichit. Cela s’appelle peut-être la culture.»
Voir Manet, de Frédéric Vitoux : Un essai passionné et vagabond
C’est avec ce syntagme que l’éditeur parisien présente la très réussie incursion que Frédéric Vitoux de l’Académie française réalise dans un territoire réservé d’habitude aux critiques d’art. Connu surtout par ses œuvres romanesques, l’auteur n’est pas étranger aux écrits à caractère biographique, s’il fallait noter dans ce sens son livre sur Gioachinno Rossini (Seuil, 1982) et surtout sa magistrale Vie de Céline (Grasset, 1988). D’autres textes sur le patrimoine culturel français, comme celui du Paris vu du Louvre, cité plus haut, témoignent de l’intérêt que l’auteur porte aux beaux-arts.
Sans vouloir réécrire une nouvelle biographie d’Édouard Manet – «tant de biographes se sont déjà attelés à cette tache!» – l’auteur, muni, à travers son expérience de romancier, d’un sens aigu capable de saisir la profondeur des sentiments humains, débute son livre en essayant de répondre à une série d’interrogations liées au sentiment de refus de communication éprouvé devant les tableaux de Manet : «On a parfois le sentiment que les tableaux de Manet se dressent devant nous, semblables à un rempart, le dernier refuge du peintre avant qu’il ne cède, ne s’abandonne à des flux d’émotions ou de confessions qui entraîneraient sa perte, sa liquéfaction.» Ainsi, le but de sa démarche serait d’explorer le territoire secret, intime de l’esprit du peintre, territoire vu comme dépositaire de ses silences – le mot silences ayant ici plutôt le sens de secrets – comme dans la phrase: «Silences qui l’ont accompagnée, dont les ombres n’ont cessé de peser ensuite sur son œuvre, comme pour l’éclairer d’une lumière trouble».
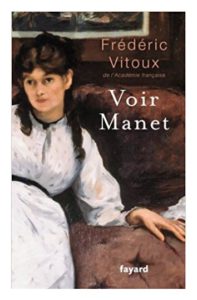 Le génie de Manet résiderait donc dans cette manière de conjurer les ressources de l’art pour pouvoir, par ce biais, créer «une sorte de suspension romanesque et d’angoisse diffuse qui n’ose pas dire son nom», qui «refuse l’excès de l’éloquence et, donc, du mensonge», «une subtilité maladroite» derrière laquelle il puisse se cacher. Difficile, par conséquent, d’écrire une biographie construite sur le manque de communication, sur un mur situé entre l’artiste et le monde. L’auteur assume, pourtant, son choix : «Évoquer les silences de Manet ne serait pas la plus médiocre façon de raconter sa vie – de raconter ce qu’il ne racontait pas, ce qu’il ne voulait pas ou ne parvenait pas à traduire dans sa peinture, ouvertement du moins, et qui touchait à l’essentiel.» Plus encore, il essaie de définir de façon encore plus large les chimères qui peuplent le monde intérieur du peintre, celles sur qui reposent ses sentiments, ses peurs, ses doutes et ses convictions. Les secrets de Manet «touchent l’essentiel», nous dit Frédéric Vitoux, tout en les identifiant : «La vie, la naissance, la maladie, l’amour, la mort, la religion.»
Le génie de Manet résiderait donc dans cette manière de conjurer les ressources de l’art pour pouvoir, par ce biais, créer «une sorte de suspension romanesque et d’angoisse diffuse qui n’ose pas dire son nom», qui «refuse l’excès de l’éloquence et, donc, du mensonge», «une subtilité maladroite» derrière laquelle il puisse se cacher. Difficile, par conséquent, d’écrire une biographie construite sur le manque de communication, sur un mur situé entre l’artiste et le monde. L’auteur assume, pourtant, son choix : «Évoquer les silences de Manet ne serait pas la plus médiocre façon de raconter sa vie – de raconter ce qu’il ne racontait pas, ce qu’il ne voulait pas ou ne parvenait pas à traduire dans sa peinture, ouvertement du moins, et qui touchait à l’essentiel.» Plus encore, il essaie de définir de façon encore plus large les chimères qui peuplent le monde intérieur du peintre, celles sur qui reposent ses sentiments, ses peurs, ses doutes et ses convictions. Les secrets de Manet «touchent l’essentiel», nous dit Frédéric Vitoux, tout en les identifiant : «La vie, la naissance, la maladie, l’amour, la mort, la religion.»
Nous comprenons mieux maintenant le sens de l’invitation contenue dans le titre. Voir Manet veut moins dire regarder ses tableaux sous un angle inédit, les scruter pour y déchiffrer on ne sait quelle prouesse technique novatrice – l’auteur refuse, nous verrons, même le titre de moderne accordé au peintre par la critique, préférant celui de classique –, voir Manet a, donc, pour Frédéric Vitoux la valeur d’une douloureuse et exigeante autopsie sur un être tourmenté, soumis à l’irrésolvable équation d’une société bourgeoise où le vécu intérieur doit être tenu sous le couvercle du secret. Ainsi, le but de la démarche de ce livre pourrait être résumé par l’explication même que l’auteur propose en parlant de la ressemblance artistique entre Chardin et Manet : «S’affirme ainsi la proximité de ces deux peintres bourgeois, si l’on veut, aussi soucieux de réalisme que de modestie, rongé, d’un siècle à l’autre, par une sourde peur, et qui ont eu besoin de faire éclater la surface bien lisse, bien continue, bien mensongère du monde et de ses apparences, de l’atomiser picturalement ou chromatiquement pour la retrouver, conforme à leur attente, à leur (vain ?) souci de paix et de cohérence.»
Un paradigme du déguisement
Mais comment faire autrement, si cette dictature du secret semble s’imposer comme un véritable credo, tel que nous l’apprenons par le biais d’Ambroise Vollard, parlant de Manet : «Un peintre peut tout dire avec des fruits et des légumes ou des nuages seulement»? Et quel sens donner à une autre déclaration du peintre concernant l’intrusion de l’imaginaire dans ces constructions picturales ? «La couleur est une affaire de goût et de sensibilité. Par exemple, il faut avoir quelque chose à dire ; sans quoi, bonsoir… Il ne suffit pas de connaître son métier ; il faut encore être ému. Très bon, la science ; mais pour nous, voyez-vous, l’imagination vaut mieux.» Ce serait donc imprudent de réduire l’essai de Frédéric Vitoux au périmètre réducteur d’un éloge de l’impasse de la communication. Loin de vouloir théoriser un tel échec, l’Académicien français invoque d’une manière directe les vertus du métalangage pictural – formalisé, celui-ci, par Roland Barthes dans la Rhétorique de l’image – pour expliquer à l’aide des vertus figuratives des formes et des couleurs la démarche de Manet, en mettant en lumière le paradigme artistique qui domine l’œuvre du peintre, celui de la dissimulation, du travestissement – véritable détournement sémiotique et subtile stratégie de la pudeur : «Tel est le paradoxe de son œuvre : cet effort qu’il ne cessa de faire pour se mettre à l’abri, ne rien livrer aux autres de lui-même, de sa vie intime, de ses émotions, de ses pulsions, cet effort pathétique et vain qui est devenu l’une des aventures picturales le plus singulières et les plus bouleversantes de la peinture française.»
Prenons un exemple des secrets qui ont traversé la vie de Manet: il s’agit de sa paternité, jamais avouée. En 1849, madame Manet, la maman du peintre embauche Suzanne Leendorf pour donner des cours de piano à son fils. Édouard avait 18 ans, Suzanne, 2 ans de plus que lui. En 1852, Suzanne donne naissance à un garçon, Léon Édouard, qu’elle va présenter comme étant son petit frère. Manet accepte de signer le registre des naissances comme parrain de l’enfant. Manet va peindre Suzanne, qui deviendra sa femme, dans un tableau d’inspiration hollandaise au nom de Nymphe surprise. On sait aujourd’hui que ce tableau ne représente qu’une partie découpée par le peintre d’un ensemble inachevé qui portait le nom de Moïse sauvé des eaux, que l’on pourrait interpréter comme une manière discrète de saluer la venue au monde de Léon, dont Manet n’assumera jamais la paternité. «L’histoire de Léon, l’histoire de Suzanne et d’Édouard, écrit Frédéric Vitoux, c’est avant tout une histoire de convenances et d’apparences. Dans le milieu que fréquentait la famille Manet, il fallait dissimuler ce qui portait atteinte à la bienséance.» Or, ce rideau ne se lèvera qu’après la mort du peintre, par la lecture de son testament par lequel Manet confie tout son héritage à Léon.
La peinture comme image mentale
Approchant un autre aspect de l’esthétique de l’œuvre de Manet, celui du sens donné à la capacité introspective de cette esthétique, Frédéric Vitoux insiste sur le sens que nous devrions accorder au syntagme avec lequel Manet invite le public à regarder ses tableaux, en les nommant «des œuvres sincères», attributs que l’essayiste relie à celui d’images mentales dont parle Mallarmé lorsqu’il affirme : «Chaque œuvre doit être une nouvelle création de l’esprit». C’est le cas du tableau Le balcon que le peintre présente au Salon de 1869. Ce tableau – inspiré de l’œuvre de Goya – n’a rien d’un vrai balcon, car, de sa perspective, il ne domine rien, étant plutôt «un balcon de comédie», comme l’appelle Frédéric Vitoux, un balcon de campagne, d’après la couleur verte de se barres et représentant un groupe fantomatique qui observe avec résignation le spectacle extérieur du monde : «Voilà l’étrangeté du tableau – son climat presque léthargique de temps suspendu. Chacun de ces jeunes gens est enfermé dans sa sphère, barricadé dans ses murs, ses idées fixes, ses espoirs, ses ambitions, sa suffisance ou ses mélancolies. Aucun n’est capable de s’ouvrir à ses proches, de leur témoigner un minimum de chaleur, de s’apercevoir même qu’ils existent. Parmi ces personnages du balcon, un seul attire particulièrement notre attention par son regard absent envers le peintre mais dirigé vers le monde extérieur: il s’agit de Berthe Morisot envers qui Manet avait une grande admiration – un amour platonique ? – et qui sera son modèle pour de nombreux tableaux. La série de portraits dédiés à Berthe Morisot renferme toute une histoire secrète, une série narratologique, dirions-nous, dans le sens donné par Paul Ricœur lorsqu’il écrit : «Le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif.» Car, en effet, la suite de portraits réalisés par le peintre, observe Frédéric Vitoux, peut être contemplée comme «un roman bourgeois, un roman tragique» dont nous pouvons suivre facilement les épisodes dans les tableaux de Manet et qui ne sont que «l’histoire d’un éloignement», d’une séparation inévitable et définitive, par le mariage de Berthe avec Eugène Manet, le frère du peintre.
Nous sommes loin d’avoir épuisé tous les secrets contenus dans les tableaux de Manet. Impossible de les présenter ici sous toutes les facettes de la rencontre avec l’œuvre du peintre proposée par Frédéric Vitoux dans son livre Voir Manet. La lecture de ce livre exceptionnel dont nous souhaitons vivement la traduction en roumain pourra offrir aux lecteurs cette immense joie. Retenons pour l’instant cette fascination d’une rencontre complice entre peinture et littérature, entre deux grandes sensibilités, dans laquelle la finesse d’esprit et la perfection de l’écriture réussissent à bâtir un harmonieux ensemble d’érudition et d’élégance.
Dan Burcea
Michelle Tourneur, La beauté m’assassine, Fayard, janvier 2013, 320 pages, 19 €
Frédéric Vitoux, Voir Manet, Fayard, janvier 2013, 392 pages illustrées en couleur, 25,90 €

