
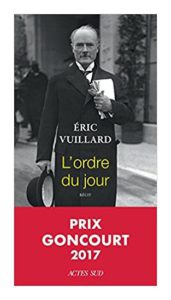 «Je n’entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l’empêcher de s’ouvrir sur le bleu de l’air et la soif de partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit ne devienne introuvable». (René Char, «Marthe»)
«Je n’entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l’empêcher de s’ouvrir sur le bleu de l’air et la soif de partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit ne devienne introuvable». (René Char, «Marthe»)
On connaissait le tableau des Onze membres du Grand Comité de l’an II, connu aussi sous le nom de Comité de la Terreur, fixé pour l’éternité par François Élie Corentin, le peintre fantôme de Pierre Michon. Voici celui créé avec la même attention romanesque dans L’Ordre du jour par Éric Vuillard et représentant les vingt-quatre « vénérables patriciens » régnant sur une sorte de « nirvana de l’industrie et de la finance », réunis sous la coupole du petit salon du palais du président du Reichstag, Hermann Goering. Savent-ils, en ce jour du 20 février 1933, comme Michon le dit pour ceux qui vécurent un siècle et demi auparavant, que « l’Histoire à sa ceinture porte une poche de chance, une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles » ? Difficile à dire lorsque l’on sait que ce n’est pas les choses impossibles qui les réunissent dans ces murs, mais les calculs et les compromissions. Et c’est pourquoi rien de l’ardente folie de leurs vieux prédécesseurs, à la fois « des saints, des tyrans, des larrons, des princes », ne transparait sous « les vingt-quatre chapeaux de feutre » et encore moins sous « les vingt-quatre crânes chauves ou [sous leurs] couronnes de cheveux blancs ». Eux-mêmes ignorent à ce moment précis de cette réunion secrète, que, dans la demi-heure qui va suivre, ils vont délibérément vendre pour peu leur âme et signer un pacte avec le diable déguisé en Führer, aidant ainsi l’arrivée au pouvoir du parti nazi. Ils vont brutalement apprendre que le vrai ordre du jour ne tient pas de l’organisation d’une garden-party, mais d’une exigence cavalièrement formulée : « Et maintenant, messieurs, à la caisse ! ». Tout est ainsi dit : les voici subitement transformés en « vingt-quatre machines à calculer aux portes de l’Enfer », convaincus que le jeu en vaut la chandelle et que cette générosité suffira à « en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d’être un Führer dans son entreprise ».
En effet, il s’agit de leurs entreprises, car tous sont des patrons de la grande industrie du Reich. L’auteur reproduit d’ailleurs dès le début du récit (page 18) la liste complète des noms avec la précision d’un inventaire de « masques archétypaux » en train d’accomplir le geste définitif et irrémissible du pacte faustien avec le diable. Énumérons-les pour mémoire: Hjalmar Schacht, Gustav Krupp, Alebrt Vögler, Günther Quandt, Friederich Flick, Ernst Tenglemann, Fritz Springorum, August Rosterg, Ernst Brandi, Karl Büren, Günther Heubel, Georg von Schnitzler, Hugo Stinnes Jr., Eduard Schulte, Ludwig von Winterfeld, Wolf-Dietrich von Witzleben, Wolfgang Reuter, August Diehn, Erich Fickler, Hans von Loewenstein zu Loewenstein, Ludwig Grauert, Kurt Schmitt, August von Finck et le Dr. Stein. Plus encore, accolés à ces noms, il y a ceux de leurs entreprises – BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken – pour rappeler pour la même mémoire la continuité du sang d’une monstrueuse désertion des principes démocratiques qui coule dans les veines de ces entités. La présence de ces hommes de pouvoir et de finances dans cette antichambre de la fabrique de la trahison n’a peut-être rien d’étonnant si l’on pense, encore une fois comme Pierre Michon, que « chaque chose réelle existe plusieurs fois, autant de fois peut-être qu’il existe d’individus sur cette terre ». Chaque répétition n’est-elle un renforcement de la signifiance capable d’expliquer la perpétuation de ces choses ? Sinon, comment comprendre l’enchaînement de lâcheté, de peur et de démission qui va suivre ?
Une fois épuisée, la scène du salon du palais va être remplacée par d’autres simulacres de rings aux décors symboliques d’une diplomatie à bout de souffle où l’indifférence s’érigera en aveuglement, permettant à la lâcheté de se prévaloir du déguisement de la démission, dans « un mélange de coups de force et de bonnes paroles ». C’est ce que fait lord Halifax, président du Conseil, en visite personnelle, en répondant à l’invitation de Goering : rien sur l’annexion de la Sarre, rien non plus sur la remilitarisation de la Rhénanie ou sur le bombardement de la Guernica, car la chasse, le dîner et les preuves de sympathie de la part de son hôte suffisent pour effacer tout de la gravité environnante. Jusqu’où allait cette ignorance si bien feinte ? « Lord Halifax – nous dit l’auteur – tout comme les vingt-quatre grands prêtres de l’industrie allemande, devait en savoir un bout sur Goering, il devait un peut connaître son histoire, sa vie de putschiste, son goût pour les uniformes de fantaisie, sa morphinomanie, son internement en Suède, le diagnostic accablant des violences, de désordre mental, de dépression, ses penchant suicidaires. Il ne pouvait pas s’en tenir au héros du baptême de l’air, au pilote de la Première Guerre, au marchand de parachute, au vieux soldat. »
Véritable césure dans le cours du récit, cette remise au point de la véritable personnalité de Goering est censée à remettre en cause la question même du type de l’antihéros sur lequel se construisent les mythes des plus féroces dictatures et dont l’Histoire est le plus souvent oublieuse. Cette falsification ne semble pas, encore une fois, interpeller Lord Halifax qui, lors de sa rencontre avec Hitler, semble lui laisser entendre que « les prétentions allemandes sur l’Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie ne semblaient pas illégitimes au gouvernement de Sa Majesté, à condition que cela se déroule dans la paix et la concertation ».
Or, de la concertation devait être aussi le cas dans la rencontre de Hitler avec le chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg dans la résidence d’été de Berghof du Führer. Alors que la discussion glisse sur des aspects de rapports historiques entre l’Allemagne et l’Autriche que l’accord de 1936 n’avait pas réussi à tempérer, Schuschnigg, surpris par la dureté des propos de son interlocuteur, se retrouve dans l’impossibilité d’une réplique logiquement tenable. D’ailleurs, que répondre à un homme qui vous parle de la Providence qui l’aurait destiné à une mission historique sans précédent ? Le déséquilibre de taille dans le sens politique le plus commun entre les deux hommes ne joue pas en faveur du chancelier autrichien : ses hésitations, son manque de réparti, sa prudence et sa peur le placent d’emblée dans une position de second degré devant l’agressivité de premier degré du Führer. On connait la suite. Le 12 mars 1938, les blindés allemands ouvrent la parade en franchissant la frontière autrichienne. Ce qui suivra à Munich ne sera que le corolaire de cette ignorante et candide lâcheté dont Daladier et Chamberlain sont submergés jusqu’au moment où encadrés par Hitler et Mussolini, ils seront obligés de signer.
Mais, alors que cette opération est un échec presque total, comment se fait-il que la mémoire collective ait gardé l’image d’une triomphale avancée, d’une armée puissamment préparée et victorieuse ? La falsification de la réalité est un autre thème majeur du livre d’Éric Vuillard, après celui de la démission des démocraties devant l’arrogance et l’outrecuidance des usurpateurs et des imposteurs, comme ce fut le cas des nazis. Le filtre des films de propagande a constitué le support par lequel sont arrivées les images du front, rendant impossible la distinction du vrai et du faux, dans « ce sortilège effarant ». « Les actualités allemandes deviennent le modèle de la fiction » sous la baguette du grand mystificateur Goebbels. Elles subiront aussi des modulations hollywoodiennes. Que dire de l’avancée complètement ratée des panzers sous le soleil froid du printemps vers Vienne, de la multitude de 250 000 personnes rassemblées de force ou de plein gré sur la Heldenplatz pour écouter le discours d’Hitler ? Comment regarder ces réalités mensongères avec le filtre de la bonne foi ? « Les manœuvres terrassent les faits – écrit le narrateur ; et les déclarations de nos chefs d’État vont être bientôt emportées comme un toit de tôle par un orage de printemps ».
Et c’est à ce moment précis que réapparaissent les vingt-quatre comparses de la première heure. Cet épisode, toujours présent dans la mémoire du lecteur, sera convoqué pour justifier autant que peut se faire à la fois le tissu d’intérêts et de profits dont ces hommes et leurs entreprises ont pu bénéficier pendant la guerre et leur impunité ultérieure, grâce à tant d’accommodements de couloir. Faut-il encore préciser la présence, si on pense à notre quotidien, de leurs entreprises se traduisant aujourd’hui par des structures qui concernent « nos voitures, nos machines à laver, nos produits d’entretien, nos radio-réveils, l’assurance de notre maison, la pile de notre montre » ? Que toutes cette continuité se nourrit, elle aussi, d’une insidieuse falsification de l’Histoire qui exonère les réalités du passé de leur poids devenu invisible aujourd’hui ? Pourquoi le silence des dictionnaires sur les milliers de morts de faim et d’épuisement des travailleurs forcés dans ces usines ?
Cet appel à la mémoire vigilante est sans doute la première vertu de ce récit troublant par sa manière directe et sans concession avec laquelle il interroge nos consciences avec une pédagogie qui n’a rien perdu de sa méthode et de son utilité, malgré les humeurs d’une certaine tentation à l’amnésie. Ne s’agit-il plutôt de l’inverse? L’humanité se trouve confrontée, par l’inéluctable caprice de l’Histoire, aux mêmes problèmes qui résident au fond de nous-mêmes et dont voici ici un petit inventaire non exhaustif des horreurs qu’ils engendrent : lâcheté, indifférence, calcul, légèreté, doute, impossibilité de discerner le vrai du faux, indolence, apathie devant de grands problèmes et tant d’autres dont « L’Ordre du jour » relate en détail les méfaits et les conséquences catastrophiques.
Au fond, ce livre n’a rien perdu ni de son actualité ni de l’urgence avec laquelle il interpelle notre mémoire. Oserions-nous plaider aujourd’hui le contraire et tenter l’oubli de tant de vies disparues à cause de nos confortables et lamentables certitudes ? Qui pourrait prononcer de nos jours le mot dictature et regarder sans cligner des yeux l’humanité entière ?
Nul ne pourra douter de l’actualité du livre d’Éric Vuillard qui nous invite sur « la scène où se jouent les vaudevilles de notre existence ».
Dan Burcea
Éric Vuillard, « L’Ordre du jour », Éditions Actes Sud, 2017, 160 p., 16 euros.

