
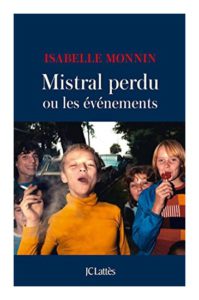 On connaissait déjà, depuis Les Vies extraordinaires d’Eugène et Les Gens dans l’enveloppe la propension d’Isabelle Monnin d’interroger l’absence ou « la banalité familière, bouleversante » des gens, ainsi que sa patiente volonté d’examiner les sédimentations de l’Histoire, en géologue expert des strates karstiques dont sont imprégnés les vestiges de la mémoire de ses personnages. Avec son dernier roman, Mistral perdu ou les événements, ce sont ces mêmes tentatives de « pouvoir attraper les images comme on s’empare d’une poussière volante » qui osent pousser son geste à une écriture quasi automatique, « sans les passer au filtre de la pensée » pour « garder leur entièreté précise, leur profondeur cachée ». Le registre des métiers n’a pas changé, il s’est même enrichi d’une profession nouvelle, celle du géo-linguiste qui, par la minutie des mots, rend possible à travers le récit l’auscultation de la fragilité des êtres. Porter à la lumière les sédiments de la mémoire consisterait donc « à fouiller, gratter le sol, écorcher les roches pour mettre les phrases au jour ». Écrit sous forme de journal, le roman rassemble les joies et les insouciances, mais aussi « les fêlures clandestines, et les effrois » d’une génération qui ignore encore tout de la trahison du temps et de l’entropie de l’Histoire. L’obsolescence programmée des rêves est en marche, elle finira par avoir le dernier mot. « Les événements – nous prévient la narratrice – naissent bien avant leur irruption, ils sont comme une maladie lentement couvée, quand ils arrivent, c’est à la fois une fin et un début ».
On connaissait déjà, depuis Les Vies extraordinaires d’Eugène et Les Gens dans l’enveloppe la propension d’Isabelle Monnin d’interroger l’absence ou « la banalité familière, bouleversante » des gens, ainsi que sa patiente volonté d’examiner les sédimentations de l’Histoire, en géologue expert des strates karstiques dont sont imprégnés les vestiges de la mémoire de ses personnages. Avec son dernier roman, Mistral perdu ou les événements, ce sont ces mêmes tentatives de « pouvoir attraper les images comme on s’empare d’une poussière volante » qui osent pousser son geste à une écriture quasi automatique, « sans les passer au filtre de la pensée » pour « garder leur entièreté précise, leur profondeur cachée ». Le registre des métiers n’a pas changé, il s’est même enrichi d’une profession nouvelle, celle du géo-linguiste qui, par la minutie des mots, rend possible à travers le récit l’auscultation de la fragilité des êtres. Porter à la lumière les sédiments de la mémoire consisterait donc « à fouiller, gratter le sol, écorcher les roches pour mettre les phrases au jour ». Écrit sous forme de journal, le roman rassemble les joies et les insouciances, mais aussi « les fêlures clandestines, et les effrois » d’une génération qui ignore encore tout de la trahison du temps et de l’entropie de l’Histoire. L’obsolescence programmée des rêves est en marche, elle finira par avoir le dernier mot. « Les événements – nous prévient la narratrice – naissent bien avant leur irruption, ils sont comme une maladie lentement couvée, quand ils arrivent, c’est à la fois une fin et un début ».
Quoi de plus urgent, de plus impérieux, dans ce cas, que d’accorder les pleins pouvoir au verbe « être » dont le sens plénier dit aussi l’essence des êtres et des choses ? Le conjuguer avec le je et le nous est pour la narratrice le moyen de donner corps à la relation fusionnelle qu’elle entretient avec sa sœur cadette, figure solaire, qui « a trouvé le secret de la vie ». Sa proximité transmet à l’ainée enchantée « une force mystérieuse, peut-être tellurique » et lui assure une connaissance de soi traversée par la certitude d’exister à travers elle, ce qui la fait proclamer avec la force d’un aphorisme : « nul ne me dit comme elle qui je suis ». Ce syntagme devient le mot crochet qui ponctue le tissu narratif laissant à la mémoire le temps de se fixer comme sur une bande magnétique, au fur et à mesure que le récit se déploie en une histoire commune y compris dans l’absence de l’autre. Chaque chapitre s’allume à la lumière de cet adage « Nous sommes deux », disant tout sur l’enfance et sur l’adolescence de deux sœurs insouciantes et complices.
Plus encore, « Nous somme deux, nous sommes les filles » devient un passeport assurant le passage d’un âge à l’autre, sans pour autant rompre une relation fusionnelle qui dit tout et qui laisse s’incruster dans la roche de la fratrie une lumière magique qui renferme tout le secret de la vie. Chaque retrouvaille prend sens dans la cérémonie d’une complicité rituelle que la narratrice définit comme une « reconnexion » aux mystères, permettant au monde d’infuser leur duplicité et de transformer leur quotidien en « une alternance d’école et de vacances dont la mémoire est un magma où se mélangent aujourd’hui les dates, les années, les lieux ».
Inutile d’insister sur ce cours – trop rapide, trop cruel ? – du temps. C’est plutôt à la contemplation d’un temps suspendu, des moments heureux et des instants éternels – enfantins et pubères – que le récit d’Isabelle Monnin nous invite. Dans cette scène émerveillée, habillée du décor des années 1980, on aperçoit d’abord les parents « Trente glorieuses » qui portent, chacun d’une manière indélébile, leur cortège d’habitudes et d’unicité, imprégné à jamais sur la rétine et l’odorat de la narratrice. Il y a ensuite une autre apparition, celle du chanteur Renaud qui impressionne par sa désinvolture et sa lumière novatrice qui laisse entendre une voix nouvelle et porteuse de rêves. Dans une interview, Isabelle Monnin parlera même du langage cru de ces chansons comme d’une nouveauté tentatrice pour une adolescence trop restrictive quant aux mots du quotidien. Emportées par ce nouveau récit d’une époque qui semble avoir trouvé le langage idéal pour exprimer sa contestation et donner corps à ses rêves, les deux sœurs deviendront des inconditionnelles de leur chanteur préféré à bandana rouge.
Et puis, il y a les événements, ces incidences du réel, ces déclivités incontrôlables et insouciantes, comme seul le destin sait creuser dans le magma des vies de ces personnages. Annonçant une déliquescence inscrite dans les lois de l’Histoire qui emporte tout, les événements ne tarderont pas à montrer leur force de transformation et leur poids de regrets qui vont redonner à la nostalgie son sens qui renvoie vers le temps qui passe emportant à tout jamais jeunesse, insouciance et bonheur, ce cortège qui fait des « twin sisters » des immortelles des rêves et du bonheur. Car, s’il faut faire siennes les paroles du « Mistral gagnant », les sœurs ne doivent pas ignorer que souvent « le temps est assassin » et que son lot d’inattendues décrets a le plus souvent le visage d’une lame impitoyable et tranchante.
Que vont-ils apporter dans la vie fusionnelle de ces sœurs, héroïnes d’un roman qui enregistre avec une respiration haletante toute l’avalanche avec laquelle le réel – ou au moins son habit historique – s’invite dans le cours de leurs vies ? À partir de quel moment le je va prendre la place du nous, pour quelle raison et avec quelles conséquences ? Et quand le ton de la narration va-t-il s’écrire non pas en mineur, mais en minuscule, comme « les minuscules résistances où se nichent les preuves de l’unicité de chacun, les infimes fantaisies qui disent j’existe, écoute-moi comme j’existe » ?
Laissons au lecteur la curiosité de découvrir le cours inattendu de cette histoire. Retenons, quant à nous, son côté rempli d’humanité son refus de tout dolorisme et sa dignité dans les épreuves. Refusant le larmoyant et le côté obscur du fatalisme et gardant de cette lumière descendante tout l’or du crépuscule, le roman d’Isabelle Monnin redit avec talent tout sur la vie, sur la mort et sur le sens de nos existences, et, plus encore, sur nos espoirs et nos déceptions.
À qui la faute si les Mistrals gagnants deviennent perdants et déjà perdus, à qui la faute si les idoles d’hier deviennent des ombres épuisées de nos espoirs ? Que dire lorsque « tout est mélangé contradictoire, entortillé des milliards de molécules qui constituent un individu, baigné des courants de l’époque, d’un terroir, d’une famille, imprégné des événements, leur otage on pourrait dire tant il dépend d’eux longtemps après avoir cru y échapper » ? Lorsque « le réel ne suffit plus », lorsque la mémoire de soi, de ce qui nous constitue, devient « une ironie cruelle et triste » la seule issue semble reposer sur la force des mots, ce pouvoir que la littérature confère à toute tentative avec laquelle la mémoire tend à s’accrocher à l’éternité.
La prose d’Isabelle Monnin impressionne justement par cette force lénifiante et juste avec laquelle elle s’oppose à la colère du destin, à ce mélange de fatalité et de hasard qui semble dicter les vies de ses personnages. Devenue « conservatrice en chef, l’archéologue (des) petits riens » elle nous invite à explorer son monde, là où les souvenirs n’ont rien perdu de leur lucidité amère et de leur vérité. Voilà pourquoi – nous dit-elle – il faut « fuir les atermoiements d’autrefois, refuser les encombrements inutiles, les mépriser » afin de pouvoir afficher, comme elle – épinglées côté cœur – ses « minuscules médailles de la guerre perdue ».
On appelle cela tout simplement de la grande littérature.
Dan Burcea
Isabelle Monnin, «Mistral perdu ou les événements», Éditions JC Lattès, 2017, 208 p., 17 euros.

