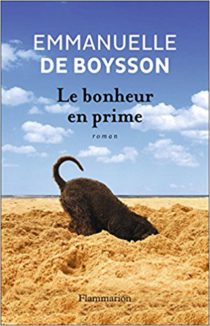
Ceux qui continuent à s’imaginer – et Dieu sait qu’ils sont nombreux – que, pour être heureux, il faut d’abord être riche, devraient impérativement lire le livre d’Emmanuelle de Boysson, «Le bonheur en prime» qui vient de paraître aux Éditions Flammarion. Il nous dit ceci à propos de l’alchimie qui s’opère entre nos humeurs et notre compte en banque : «Laissez vos mines grises au vestiaire, oubliez coups bas et ressentiments. Tout deviendra possible. Rêvons un peu». Précisons dès le début que la profession d’Emmanuelle de Boysson n’est ni celle de psychologue ni celle de coach de vie – des gens qui font un honorable travail pour apaiser les détresses de nos contemporains – et que son livre n’est donc pas un traité sur le bonheur, dans ce sens explicite. C’est, en revanche, de littérature qu’il s’agit ici, chose beaucoup plus implicite, si l’on se réfère à sa totale liberté de créer des caractères et à explorer sans contrainte nos consciences, voire nos âmes, pour en saisir et nous faire cadeau de la trace que laissent en nous l’éclat de notre désir de vivre et le pouls de nos faiblesses. Mais dire qu’en tant que roman «Le bonheur en prime» bénéficie de toutes ces libertés, comme d’un luxueux privilège dont seule l’invention littéraire serait sans doute capable, c’est aussi relever les nombreux dangers qu’Emmanuelle de Boysson réussit à éviter à faire subir à sa construction narrative : tentation d’un discours moralisateur, attraction pour la description zolienne, problématisation du rapport de l’homme contemporain aux jeux, tentation psychologisante pour expliquer la tendance de plus en plus addictive de nos comportements, etc.
Loin de ces chimères, Emmanuelle de Boysson nous propose ici un roman lumineux, «une folle parenthèse où la fantaisie est une invitation à se dépasser», mélange de prose intimiste et de dramaturgie aussi légère qu’un vaudeville et divertissante comme une comédie de boulevard. En construisant l’édifice de son roman autour du majordome Gaspard, elle nous renvoie vers des productions littéraires et cinématographiques telles que le célèbre «The Remains of the Day», adapté par James Ivory d’après le roman éponyme de Kazuo Ishiguro ou télévisuelles dont la plus célèbre reste la série britannique «Downton Abbay». «Sigmaringen», le récent roman de Pierre Assouline, s’inscrit dans la même veine. Quant à Gaspard, le personnage principal du roman «Le bonheur en prime», ce «vieux garçon tellement maigrichon», surnommé pendant sa jeunesse «haricot vert» justement à cause de sa frêle nature, il est encore plus secret et plus ténébreux, et, en ceci, plus dostoïevskien, que ses comparses, le majordome Stevens qui veille sur le domaine de Darlington, de Mister Carson, le chef de la domesticité de Downton Abbay, ou de Monsieur Stein, le majordome du château des Hohenzollern. Fidèle à son service depuis plus de quatre décennies, il veille sur Jules Berlingault, riche propriétaire entre autres des usines de bonbons Cadubon, familier des grands artistes et des écrivains célèbres, aujourd’hui veuf, depuis qu’Églantine, sa feue femme «aux yeux lapis-lazuli» l’a quitté pour l’éternité. Ni le deuil ni l’âge avec tout son cortège de déconvenues et de petits soucis de santé, n’ont en revanche diminué son appétit pour la bonne chair ou l’ingéniosité de son esprit farceur ainsi que sa curiosité jamais innocente de faire la connaissance des gens. Pour ce qui est de sa santé ou de sa relation avec sa famille, Jules n’a que faire des conseils des médecins qui prônent la modération, encore moins de l’acharnement de son harpagon de neveu qui guette l’héritage : le vieil homme continue à savourer son Mouton-Rothschild, ses cigares, et à ignorer dédaigneusement les prétendants qui tournent autour de sa richissime personne.
Justement, en parlant de sa fortune, il décide sur un coup de tête de tout léguer à son fidèle majordome Gaspard qui, lui, commence à se rêver dans la peau d’un richissime héritier, chose tout-à-fait naturelle, pense-t-il, si l’on s’en tient à la juste récompense que mérite son inconditionnel service rendu depuis des décennies à son maître. Il se presse dès lors à consigner dans son carnet les effluves que provoque dans son âme toute cette émotion, car, en effet, depuis l’âge de onze ans, Gaspard tient avec minutie un journal où choses intimes et compte-rendu de ses accès paranoïaques font bon ménage. Seulement, voilà, une chose s’invite à l’improviste, servant d’intrigue à cette histoire qui risquait de rester jusque-là plate, insignifiante. D’autres personnages vont faire leur apparition, un monde bigarré fait des locataires de la maison parisienne de Jules Berlingault, où Antoine, écrivain raté, Rose et Patrick, un couple en rupture et Luna, ex-salariée en communication, poussée au bord du suicide par la perte de son emploi, mènent une existence jusque-là des plus communes.
Une idée traverse alors l’esprit de Jules Berlingault : et s’il allait léguer toute sa fortune à tout ce beau monde, au grand dam, il est vrai, de Gaspard ? Les règles du jeu que Jules établit sont simples: «Pour jouir de mes biens, une seule condition : que vous soyez heureux». Projet difficile à mettre en pratique, chacun ayant sa propre définition du bonheur, et l’adage de Jules pour qui «le bonheur est une chose fragile qui s’éveille parfois par la magie d’un déclic, d’une rencontre» n’aide pas beaucoup les protagonistes, surtout lorsqu’en tant qu’«homme pressé et exigeant», il veut imposer ses règles : «Si l’un de vous fait faux bond, le jeu s’arrêtera». En fine maîtresse de cérémonie, Emmanuelle de Boysson sait que ce qui s’adapterait le mieux à ce type d’intrigue c’est un huis clos, raison pour laquelle elle fait déplacer tout ce beau monde sur l’Île de Ré, là où son riche personnage détient une propriété, et qui, très rapidement, prendra la forme d’une scène où vont se jouer, un après l’autre, les actes d’un véritable vaudeville. Rien ne manque à ce spectacle, ni les éléments pittoresques émanant de la personnalité de chacun des personnages, ni les quiproquos, ni les imbroglios, ni les malentendus qui tourmentent surtout le pauvre Gaspard qui se transforme en un Sherlock Holmes parano, n’hésitant pas à «user de mille astuces pour faire capoter ce simulacre de course au bonheur».
Qui de Rose, qui «fait partie de ces gens qui jouissent de leur malheur», de Patrick, son militaire de mari, homme colérique et un peu rustre, de Luna, cette fille perdue dans les couloirs sans issue d’une existence ordinaire, ou d’Antoine, l’écrivain sans livres condamné à faire le nègre, qui va craquer en premier, faisant ainsi capoter ce projet loufoque? Même le riche Jules Berlingault, le vrai metteur en scène de ce spectacle vivant, l’ignore. Mais, pour donner cours à sa fantaisie sans bornes, il se met à pousser chacun et chacune de ces concurrent(e)s à réveiller les qualités qui sommeillent à l’intérieur d’eux-mêmes. Ainsi, Luna, Rose, Antoine et Patrick devront se mettre à la peinture, à la haute couture, à la vraie écriture et, enfin, à l’organisation de la fête aux Moules qui a lieu tous les ans sur l’île. Arrivé à ce stade, la débordante imagination de Jules pourrait être soupçonnée de cynisme. Car quoi de plus ingrat de la part d’un riche comme lui que de manipuler ces gens ordinaires et de leur demander d’être heureux malgré eux, et, par-dessus tout, d’exiger d’eux de s’auto-dépasser, en créant l’illusion d’une réussite à tout prix? Ne doit-on pas croire plutôt Gaspard pour qui «Berlingault s’est offert un beau divertissement, une de ces comédies à la Molière»? N’a-t-on pas affaire à un vrai scénario digne d’un «dîner de cons» ? Et c’est justement ici qu’intervient dans toute sa splendeur l’art littéraire d’Emmanuelle de Boysson. Elle va réussir à gommer toute trace d’ombre supposée assombrir le visage de son personnage. Car, au fond de lui-même, Jules n’est qu’un homme fragile et rêveur, démuni de tout désir insidieux ou de cynisme. Et c’est justement en cela que réside la beauté de ce roman plein d’humour: reposant sur une vérité dépourvue de toute outrance, prêt à tout moment à servir une idée farfelue mais tellement pleine d’humanité, comme un réenchantement d’un monde en quête de sens.
La démarche n’est pas sans risque. Antoine, notre écrivain en herbe, le sait bien. «Comment écrire un roman sur le bonheur – se demande-t-il – sans tomber dans les histoires niaises qui se vendent à cent mille exemplaires alors que des chefs-d’œuvre sont virés de librairies au bout d’un mois ?» La réponse ne peut pas être étrangère au secret qu’Antoine dévoile par la même occasion. Pour réussir un tel roman il faut savoir «allier comique et dramatique», autrement dit réussir le mélange des genres, procédé nécessaire pour qu’une narration ne tombe pas dans un maniérisme futile. Car, au-delà des lubies de Jules Berlingault, «Le bonheur en prime» tire sa sève dramaturgique dans l’évolution en miroir de Gaspard, son personnage central dont le comportement et le secret intérieur vont surprendre le lecteur par un virage des plus inattendus. Cette curieuse antithèse entre Gaspard et Jules réussit à créer le dynamisme nécessaire à cette dramaturgie et finit par toucher avec grâce à la fois la folie de l’un et la vaine envie de changer les gens.
L’heureux gagnant de toute cette mise en scène est le lecteur à qui Emmanuelle de Boysson fait le splendide cadeau de pouvoir assister à un procès où le seul verdict auquel est soumis son personnage Jules Berlingault reste celui d’avoir voulu infliger à ses amis la peine d’être heureux à prix avantageux, et cela sans aucune circonstance atténuante, car avec l’intention ferme de l’imposer.
Reste à savoir s’il va aller jusqu’au bout de sa promesse.
Mais ça, seul le livre le dira…
Dans ce cas, il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne lecture, Amis bouquineurs!
Dan Burcea
Emmanuelle de Boysson, «Le bonheur en prime», Éditions Flammarion, 2014, 304 p. 18 euros

