
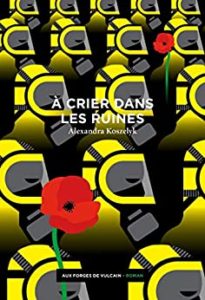 À crier dans les ruines est un roman traversé par plusieurs interrogations majeures sur les vicissitudes de l’Histoire et sur tout ce que celle-ci amène comme « perte de territoires, perte d’identité » chez un peuple déchiré qui voit sa nature déchiquetée par une catastrophe technologique. Au milieu de tout cela, Léna et Ivan, deux jeunes qui tentent de résister par ce qui le lie le plus : leur innocence et leur amour. Pour son premier roman, Alexandra Koszelyk réussit une performance très remarquée faite de maîtrise narrative et de grande humanité dans la construction de ses personnages.
À crier dans les ruines est un roman traversé par plusieurs interrogations majeures sur les vicissitudes de l’Histoire et sur tout ce que celle-ci amène comme « perte de territoires, perte d’identité » chez un peuple déchiré qui voit sa nature déchiquetée par une catastrophe technologique. Au milieu de tout cela, Léna et Ivan, deux jeunes qui tentent de résister par ce qui le lie le plus : leur innocence et leur amour. Pour son premier roman, Alexandra Koszelyk réussit une performance très remarquée faite de maîtrise narrative et de grande humanité dans la construction de ses personnages.
Elle nous parle ici de la genèse de son roman et des grandes lignes qui le construit.
Vous venez de publier votre premier roman « À crier dans les ruines » qui rencontre un franc succès, faisant partie des livres vedettes de cette rentrée littéraire. Quel mot pour décrire cet accueil ?
Publier un premier roman est un saut dans le vide, surtout lors de la rentrée littéraire qui est un moment très particulier en France. Je suis vraiment fière de voir que mon roman rencontre ses lecteurs. C’est un pari fou, un rêve qui devient réalité. Chaque jour je mesure la chance que j’ai.
Votre livre nous amène en Ukraine, et plus précisément à Pripiat, un village à la lisière de la Centrale de Tchernobyl. Pourriez-vous résumer l’histoire que raconte votre roman ?
C’est l’histoire de deux êtres séparés de force par la catastrophe de Tchernobyl. Quand l’accident a lieu, ils ont 13 ans et s’aiment comme des adolescents. Léna part en France et très rapidement ses parents lui demandent d’oublier d’où elle vient. Léna tente alors de se construire, notamment à travers la littérature. Je voulais aborder l’exil et le déracinement à travers la fiction, mais aussi traiter de résilience, que ce soit chez les personnages ou pour la nature.
Sachant que vous êtes vous-même d’origine ukrainienne, y a-t-il un lien entre l’histoire racontée dans votre livre et celle de votre famille ?
Ma famille est arrivée en France dans les années 30, bien avant l’accident de Tchernobyl. Malgré tout, je pense que l’exil ne marque pas seulement la première génération, que les autres sont elles aussi marqué par ce sceau. L’exil était un thème qui me passionnait en littérature, tout comme la transmission intergénérationnelle. Lorsque j’ai commencé à écrire ce roman, « mes fantômes » sont venus s’inviter dans la danse et j’ai à mon tour écrit sur ce qui me hantait et me constituait.
D’où provient le titre de votre roman et comment l’avez-vous choisi ?
Il provient d’un poème peu connu d’Aragon « poème à crier dans les ruines ». La légende raconte que c’est Gilles Marchand qui m’a parlé de ce poème lors d’un dîner avec d’autres auteurs des Forges. Le titre m’a tout de suite interpellée, un peu comme si ce ne pouvait être que lui. Quand je suis rentrée chez moi, je l’ai immédiatement lu : dans le poème, Aragon parle d’Ivan Mazeppa un hetman (un chef) des cosaques ukrainiens. La coïncidence était très belle, ce titre s’imposait !
En effet, le poème de Louis Aragon prend plus que jamais ici valeur de prémonition. Diriez-vous que ces deux vers, par exemple, « Écoute ces pays immenses où le vent/Pleure sur ce que nous avons aimé » réussissent à résumer la substance de votre récit ?
Oui, tout à fait, c’est une coïncidence incroyable avec cette URSS jadis immense et aujourd’hui démantelée, mais aussi cette nostalgie qui parcourt les personnages tout au long du roman.
La critique a retenu au moins deux coordonnées qui régissent sa structure narrative : celle de l’exil et celle du refus d’une séparation semblable à une désertion. Croyez-vous que cette démarche axiologique pourrait être appliquée pour expliquer ce qui arrive à vos personnages Léna et Ivan ?
Je voulais effectivement faire parler la petite histoire, pas la grande, mais celle des gens qui subissent des décisions gouvernementales ou des choix politiques. C’est toujours ainsi que ça se passe : les civils sont les premiers touchés quand une guerre éclate ou quand une catastrophe a lieu. De là naît sans doute ce sentiment de la nostalgie, partir ici n’est pas une décision mûrement réfléchie mais bien un arrachement subi. Comment se construire alors, si ce n’est en regardant le passé à travers le prisme d’un idéal qui n’existe plus ?
Obligée de quitter son pays et son ami d’enfance, Léna arrive avec sa famille à Vauville, en France. Quel rôle joue l’école et l’étude de la littérature dans son parcours que l’on pourrait qualifier de palingénésie culturelle ?
Il y a d’abord l’incompréhension face à ses parents quasi mutiques. Ces derniers s’occidentalisent à l’extrême, vont même jusqu’à changer leur prénom pour le franciser. Léna de son côté reste avec ses questions, mais le cerveau humain a horreur du vide, alors il comble : ici c’est bien la littérature qui permettra à Léna de se reconstruire, puisque dans les livres se trouvent toutes les questions à nos réponses, surtout dans les mythes, les contes et les légendes. Je voulais aussi montrer que l’être humain a une force incroyable en lui, un peu comme un phénix (puisque l’on parle de palingénésie.)
Ivan quant à lui refuse de quitter les lieux, et, malgré tous les interdits, va rester fidèle à cette région. A quel prix ? Ne cherche-t-il pas à confier aux mots une sorte de résilience, plus douce et moins efficace, par les lettres qu’il écrit à Léna, sa bienaimée ?
Ivan est tout de même forcé de quitter la zone, il part habiter d’abord à Kiev, puis à Slavoutytch. Chez lui, l’absence se comble partiellement par des lettres qu’il écrit à Léna sans les lui envoyer, puisqu’il n’a pas son adresse. L’écriture épistolaire a toujours permis de combler un vide, écrire à un absent permet de croire à une certaine forme de présence tout de même, même si au final on se parle plus à soi qu’à l’autre. Malgré tout, cela permet à Ivan d’espérer, d’y croire encore un peu, avant de faire son deuil face à la situation désespérée.
Que pourriez-vous nous dire de ces samossiols, ces gens tourmentés par les défiances de leur âmes slaves et incapables de se séparer de ce territoire ? Pour ces gens, écrivez-vous, « la peur du nucléaire est un luxe des pays riches ».
C’est un samossiol qui un jour a eu ces paroles et je les ai trouvées très justes. Pour ces hommes et femmes revenus dans la zone interdite de Tchernobyl l’attachement à la terre est le plus fort, ils ne peuvent pas vivre ailleurs et ont décidé délibérément d’habiter une zone dangereuse pour eux. Ce sont des personnes pauvres, souvent sans trop de revenus pour lesquels la préoccupation première est la survie. Je voulais montrer cette scission qui existe entre eux et des habitants des pays « riches ». Ces hommes sont très proches de la terre et ont un contact avec la nature que nous avons pour la plupart perdu.
En revenant à, et sans dévoiler la fin de l’intrigue, que pourriez-vous nous dire ? Est-ce l’histoire d’amour entre Ivan et Léna est dans l’économie de votre roman la partie la plus fictionnelle ?
Selon moi, un auteur écrit au plus proche de ce qui le meut ou le hante, qu’il prenne le parti d’écrire de l’autofiction ou de la fiction. Ici, j’ai choisi d’aborder mon livre sous un angle fictionnel, seuls les faits historiques appartiennent à une réalité passée. L’histoire d’amour suit le même processus, j’ai crée cette histoire qui prend des allures odysséennes lorsque Léna décide de retourner chez elle vingt ans après. Dans la littérature slave, l’amour occupe une grande place, peut-être ai-je voulu écrire moi aussi une histoire d’amour pour aller au plus proche de mes racines littéraires ? Comme une sorte d’hommage.
La catastrophe de Tchernobyl est reliée à une suite de malheurs qui ont marqué l’histoire de l’Ukraine. Il suffit de mentionner ici le tragique « Holomodor » que Zenka, la grand-mère, laissa comme testament à sa petite-fille. Dans quelle mesure ce pays où naquit l’orthodoxie slave, qui est situé au croisement des grandes puissances a-t-il souffert tout au long de son histoire ?
Si l’on regarde l’Histoire d’un pays comme l’Ukraine, on verra très rapidement que l’Ouest du pays a été tour à tour autrichien, polonais, soviétique et ukrainien. Comment se construit une identité dans un pays où les frontières bougent sans cesse ? Comment ne pas voir aussi une sorte de fatalité qui marquerait le pays ? A commencer par ce qu’on appelle la Rus de Kiev qui sépare encore à l’heure actuelle les historiens russes et ukrainiens. Avoir été l’Etat le plus vaste et le plus puissant des Etats d’Europe, mais aussi un carrefour commercial important a été à la fois une richesse et une malédiction pour ce pays. Aussi, quand arrive l’accident nucléaire en 1986, comment ne pas y voir une forme de malédiction ? Du moins c’est ainsi que je le perçois, mais peut-être est-ce une déformation professionnelle ? A force de lire des mythes et des histoires tragiques mon regard s’est sans doute déformé.
Dans vos pérégrinations dans les pays de l’Est de l’Europe, vous vous êtes arrêtée à plusieurs reprises en Roumanie. Dans quelle région et pourquoi ?
Dans le cadre d’une formation Erasmus + j’ai rencontré des enseignants de différents pays européens (Des portugais, italiens, espagnols, belges et roumains). A cette occasion je suis allée trois fois en Roumanie : à Bacau et à Iasi. A chaque fois l’accueil fut incroyable, nos hôtes nous ont reçus comme si nous étions de leur famille. Je me souviens d’une visite dans un lycée où une fête folklorique avait été organisée, c’était un moment très touchant, proche des coutumes et de l’esprit encore intact qui règne dans cette région. J’ai aussi visité quelques monastères bleus. Là bas la région n’est pas encore trop touchée par le tourisme, j’ai pu rencontrer la Mère supérieure du monastère de Voronet et discuter avec elle. C’est une autre vie que la mienne, un rythme hors du temps, proche de la nature : loin du consumérisme et de l’immédiateté que je connais en région parisienne. Je suis toujours revenue vivifiée de ces voyages.
La ville de Iasi est un endroit rempli d’Histoire et sa vie culturelle actuelle foisonne grâce à une jeunesse qui veut écrire un autre récit. Avez-vous eu l’occasion d’apercevoir ou de partager ce sentiment ?
Lorsque je suis arrivée à Iasi, j’ai effectivement été étonnée par sa richesse culturelle, on m’a d’ailleurs dit que cette ville était la capitale culturelle de la Roumanie. J’y ai rencontré des jeunes francophiles, animés par une envie de renouveau et de partages entre nos différentes cultures. J’ai d’ailleurs gardé des liens avec des professeurs roumains : c’est toujours instructif de comparer nos systèmes éducatifs.
La Roumanie partage une longue frontière avec l’Ukraine. Avez-vous ressenti cette proximité lors de vos voyages ?
Tout à fait, notamment lorsque j’ai fait route vers les monastères bleus, il n’y avait que les Carpates qui nous séparaient de l’Ukraine. Dans cette région, j’ai découvert là aussi un lieu morcelé de cicatrices historiques, ce sont des pays chargés d’Histoire, comment ne pas y être sensible lorsque nous visitons ces régions ? Pour la formation, j’ai d’ailleurs écrit un poème qui est publié sur le site Paysage et Patrimoine sans frontière : la région m’a énormément inspirée[1].
Auriez-vous un message à adresser aux futurs lecteurs roumains, si votre livre serra traduit, comme on l’espère en cette langue ?
La première fois que j’ai parlé avec des roumains, j’ai été étonnée de voir les similitudes entre le latin (que j’enseigne) et le roumain, nos racines linguistiques sont très proches : la langue me rappelle le latin et le folklore de cette région me remémore les coutumes ukrainiennes partagées avec ma famille. Ce serait un honneur d’être lue par des lecteurs roumains, comme un symbole d’un héritage commun.
Que peut-on souhaiter à votre roman dans cette période de promotion et de rentrée littéraire en France et à l’étranger ?
Que ses coquelicots continuent de fleurir longtemps chez les libraires.
Interview réalisée par Dan Burcea
Crédits photo : Patrice Normand
Alexandra Koszelyk, « À crier dans les ruines », Éditions Aux Forges de Vulcain, 2019, 254 p.
Longtemps n’ont résonné en moi
Que de sombres borborygmes
Echos sourds d’une langue ancestrale oubliée
Mes bottes lourdes d’un passé méconnu
Heurtaient l’asphalte de leur cacophonie singulière :
Je n’étais qu’un pantin bilboquet
Tiraillé par un Est perdu.
Mais déjà au loin se profilaient
Des silhouettes amies
Sombres et charnues :
Leur verticalité m’élevait.
Ô Muntii Carpati
Terre d’accueil aux reflets escarpés
Vous avez ouvert vos couronnes d’épines
Et avez susurré à mon oreille blessée
De doux chants oubliés.
Alexandra Koszelyk
Formateur Lettres
Association Paysage et patrimoine sans frontière

