
Antoine Wauters fait, comme on disait autrefois, coup double, en publiant pour cette rentrée littéraire non pas un, mais deux romans, « Pense aux pierres sous tes pas » et « Moi, Marthe et les autres », les deux parus aux Éditions Verdier dont tout le monde connaît l’exigence vis-à-vis de la qualité de l’écriture.
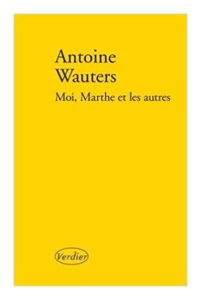 Pourquoi deux romans, et quel lien entre eux, si lien il y a ? S’agit-il d’un ensemble ou y a-t-il une préoccupation voire une obsession commune à ces deux livres ?
Pourquoi deux romans, et quel lien entre eux, si lien il y a ? S’agit-il d’un ensemble ou y a-t-il une préoccupation voire une obsession commune à ces deux livres ?
J’ai tendance à voir ces livres comme deux entités différentes. Pourtant, lorsque j’y regarde de plus près, je suis forcé d’admettre que la matière, l’énergie, j’allais dire le terreau, sont les mêmes. J’ai écrit ces livres simultanément, à une époque où j’étais au plus bas, et je crois que l’un et l’autre sont marqués par cette énergie-là, cette forme de désespoir et des questionnements qui sont le propre des périodes dépressives. Ceci étant, je crois que c’est parce que j’ai pu vaincre ces ombres et traverser tout cela, que les livres ont aussi reçu la lumière. C’est à mon sens ce qui les lie le plus. L’un et l’autre, tant « Pense aux pierres sous tes pas » que « Moi, Marthe et les autres », sont des livres qui laissent passer la lumière, l’espoir et la joie. Ils sont nés et ont grandi dans la douleur, mais je les ai amenés ailleurs, comme des enfants que j’aurais voulu protéger du pire. Je pense que c’est cela qui en fait des jumeaux, des complices. Et puis, au-delà de tout ça, il y a le fait que, dans les deux livres, j’ai déposé quelques colères, le fait de voir notre monde se disloquer, de voir des espaces de beauté massacrés par le pouvoir de l’argent, des peuples piétinés par la cécité de leurs dirigeants, de voir, surtout, que ce qui était uni finit par être divisé, séparé.
Pour vous faire une confidence, j’ai relevé le défi de trouver un lien entre vos deux romans : vous serez sans surprise d’accord avec moi, il s’agit de votre style. Quoi que l’on en dise de ce terme devenu un peu désuet, j’insisterais pour dire que vos deux narrations s’emparent du lecteur d’abord par votre manière si subtile de donner à la langue la possibilité de créer à elle seule une géographie de l’imaginaire. Est-ce que je me trompe en disant cela ?
Merci. C’est un beau compliment que vous me faites là. Je pense effectivement que l’histoire est avant tout dans l’écriture. Je ne supporte plus les livres qui se résument à des histoires bien ficelées. Je crois que quand les livres ne raconteront plus que des histoires, indépendamment de la manière dont ils le font, indépendamment de la langue et de ce travail d’écriture qui ne peut pas se résumer à une approche journalistique, factuelle, logique, je crois qu’alors, c’en sera fini du travail d’écrivain – et des promesses de rêveries pour les lecteurs. Mon seul plaisir, c’est de partir, de me plonger dans des territoires d’imagination et de les développer. Ces territoires, pour moi, sont comme d’immenses toiles d’araignées que j’essaye de tisser, et qui ont une double fonction : me protéger des horreurs du monde, et me permettre de les comprendre, de les mettre en relief, de les creuser. Parfois aussi de les changer en quelque chose de beau. Qui nous permette, c’est ce que je souhaite, de rester en vie.
Cela m’amène à vous interroger sur votre manière d’écrire : de manière élaborée?, d’un trait ? Certains auteurs préfèrent les plans, d’autres se laissent emporter par l’action. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
J’écris sans plan. Comme si quelque chose de plus intelligent que moi me guidait. Je ne peux pas le dire autrement. Je crois que j’écris avec la part la moins intelligente de moi. J’écris avec mes monstres. Avec mes parts honteuses. Avec mes obsessions. J’écris aussi avec beaucoup de nostalgie. Par contre, je retravaille beaucoup. J’enlève. Je coupe. Je colle le texte sur les murs de mon bureau et, quand je finis par pouvoir faire le tour de la pièce sans rien changer, pas un mot, pas une virgule, c’est que le texte est prêt. Je l’envoie alors à mon éditrice.
Que dire des deux mondes que vous nous invitez à découvrir ? Le premier, complétement délité, dystopique dans « Moi, Marthe et les autres », l’autre, au bord de la déliquescence sous le coup d’une dictature implacable.
Dans « Moi, Marthe est les autres », j’ai imaginé un Paris dévasté par une catastrophe dont je ne dis jamais le nom. Au milieu de tout ça, de ce désastre, des survivants s’accrochent et cherchent ce qu’ils appellent les « raisons d’espérer ». Nés après la « cassure », ils vivent au milieu de restes de produits alimentaires, de stations de métro et de grands magasins dont les noms ont été amputés. Ils fument donc, par exemple, des Marlbro et boivent du Gewurztramin. Mais le plus important, et c’est le projet même du livre, c’est qu’il s’agit d’une humanité revenue à un état quasi primitif, une humanité inquiète, qui s’interroge sur sa raison d’être dans un monde violent, dangereux et cruel, où l’on souffre plus qu’on ne vit et où l’on doit, comme dans le nôtre, improviser la joie. L’inventer et la rejouer, à chaque instant.
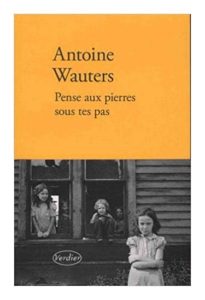 Dans « Pense aux pierres sous tes pas », la tonalité est tout autre. Je retrace le parcours d’un frère et d’une sœur qui s’aiment d’un amour absolu. Leur vie est difficile. Ils naissent et grandissent dans une famille peu aimante, au milieu d’un monde bouleversé par des changements politiques importants, un monde où seul le travail semble compter. J’ai voulu montrer comment ce monde allait les séparer. Puis comment, allant puiser en eux, ils parviennent à se relever et à devenir qui ils sont réellement. Dans un sens, leur vie est un combat en trois rounds : ils se battent d’abord contre la morale austère de leurs parents, puis contre la morale d’un monde qui veut les transformer en machines de guerre, en machines à produire et générer de l’argent. Enfin, c’est un combat intérieur, contre eux-mêmes, pourrait-on dire, un combat qui les mène d’un état de séparation à un état de réparation et de recréation, sur un mode absolument libre. C’est un texte politique, dans le sens où leur destinée et leur bonheur sont nécessairement liés à un devenir collectif.
Dans « Pense aux pierres sous tes pas », la tonalité est tout autre. Je retrace le parcours d’un frère et d’une sœur qui s’aiment d’un amour absolu. Leur vie est difficile. Ils naissent et grandissent dans une famille peu aimante, au milieu d’un monde bouleversé par des changements politiques importants, un monde où seul le travail semble compter. J’ai voulu montrer comment ce monde allait les séparer. Puis comment, allant puiser en eux, ils parviennent à se relever et à devenir qui ils sont réellement. Dans un sens, leur vie est un combat en trois rounds : ils se battent d’abord contre la morale austère de leurs parents, puis contre la morale d’un monde qui veut les transformer en machines de guerre, en machines à produire et générer de l’argent. Enfin, c’est un combat intérieur, contre eux-mêmes, pourrait-on dire, un combat qui les mène d’un état de séparation à un état de réparation et de recréation, sur un mode absolument libre. C’est un texte politique, dans le sens où leur destinée et leur bonheur sont nécessairement liés à un devenir collectif.
« Pense aux pierres sous tes pas » est à la fois le titre du roman et un mot d’ordre de deux enfants essayant de fuir une autorité parentale et se jeter dans un vaste inconnu. Qui sont réellement ces deux héros ?
Je vais le dire simplement. Pour moi, Marcio est un petit garçon qui rêve d’être une fille. Et Léonora, elle, est une petite fille qui rêve d’être un garçon. Ils s’aiment au-delà de tout et, pour moi, ils sont comme les deux versants d’un même être. Lorsqu’ils sont séparés par leurs parents, ils tombent, littéralement. Ils sont perdus. Déboussolés. Je crois que c’est un livre qui parle de ce sentiment de vertige qui suit une séparation, puis des forces qui reviennent et nous permettent, parfois, de nous réinventer.
Pour reprendre l’idée des lieux, quand je parle d’une géographie de l’imaginaire, je pense d’abord à votre manière de nommer les choses : prénoms, toponymie, dialecte. On sait, par exemple, que l’on est à Paris dans « Moi, Marthe et les autres », par la réalité des lieux mais aussi par le jargon ; on est plus intrigué, en revanche, par le fait que dans le « Pense aux pierres sous tes pas », l’on a affaire à un pays inconnu (corse ? sarde ? africain ? j’oserais même dire roumain ?). Comment fonctionne votre boussole narrative, si vous me permettez cette expression ?
Dans « Pense aux pierres sous tes pas », on est dans un pays que j’ai inventé. Je voulais qu’il soit la synthèse de l’Italie de Berlusconi, de la Roumanie de Ceaușescu, de certaines républiques bananières, d’une certaine Amérique, aussi. C’est un mélange, si vous voulez. Le mélange de différents types de pouvoirs. Ce qui me plaisait, c’était de laisser le propos ouvert et de créer une cartographie des lieux qui, en-deçà de ces questions politiques, permettraient à Marcio et Léonora de respirer. J’ai donc inventé des fleuves, des plaines, des montagnes, en me disant que ces espaces leur offriraient ce qu’ils ne connaissent pas ailleurs, une forme d’ouverture et de liberté. Ma boussole narrative m’amène, je pense, à chercher des effets de résonance entre la vie intérieure de mes personnages et la nature environnante. Parfois, c’est une nature ou un environnement qui les accable, comme dans « Marthe ». Mais dans « Pense aux pierres », la nature que j’ai imaginée, avec ses noms précis et sa langue très étrange, offre à Léonora et Marcio de quoi tenir le coup, un espace où se réfugier et se cacher, entre autres, de leurs parents.
Ces mondes en ruine ont chacun leur lot de déshumanisation. Des luttes et des mythes ancestraux renaissent du fin fond de l’Histoire : des batailles pour des territoires, pour garder ses bêtes ou pour les tuer en guise d’ultime désespoir, seul ou en groupe. Ce sont des communautés à bout de souffle. Peut-on dire que c’est l’objectif à travers lequel vous regardez notre monde présent ou futur ?
Disons que quand je nous observe, nous, humains, je me dis que nous sommes arrivés à ce moment étrange où, en même temps, on peut lire dans ce qui nous entoure des signes d’aboutissement de ce qui serait notre belle et grande histoire, et des signes de déclin, de fin. Comme si nous vivions les deux à la fois : le point d’orgue et la fin de notre histoire. C’est très étrange. Je crois que ces deux dimensions sont présentes dans mes livres. Il y a à la fois une sidération et un questionnement face à la grande violence du monde et à la destruction de notre environnement, mais il y a aussi une volonté de ne pas céder, d’en découdre et de préserver ce qui peut l’être. Mieux, un désir de recréer ce qui n’est plus. De relancer les choses avec une confiance et une joie nouvelles. La catastrophe ayant déjà eu lieu, l’espoir et l’énergie me semblent être les seules réponses possibles, à condition qu’elles soient liées à une dimension collective, qui nous manque beaucoup.
Loin de tomber dans le catastrophisme, vous laissez entrevoir une lumière, souvent timide, d’une possible sortie de l’impasse où mène la vie, « cette horreur délicieuse », comme vous la nommez. J’ai beaucoup aimé, dans « Pense aux pierres », les quiz de la guérisseuse Mama Luna, mélange d’exercices de boy-scouts et d’orthophoniste qui ont la vertu de rendre les gens « moins imbéciles » mais « plus joyeux, vivants ». En quoi consiste cet exercice original ?
Mama Luna est une vieille sorcière botaniste. C’est elle qui donne aux personnages un majuscule coup de pied au derrière, en leur disant qu’il est temps qu’ils se bougent un peu. « Vous êtes vivants, bande d’abrutis ! Encore faudrait-il que vous vous en souveniez ! » Pour cela, elle les soumet à d’étranges exercices. Endurance, dictées, énigmes, défis. Mais elle les oblige surtout à inventer des listes de mots, et à les répéter à voix haute. « Papa, pipeau, coquetier, pépite, plumier ». Ou : « Séquelle, sucre, sachet, tampon, parpaing, pompier. » Pour elle, le seul fait de répéter des mots à voix haute possède un pouvoir salvateur. Les mots ont une puissance inouïe, que l’on oublie souvent. « Essayez. Posez-vous dans votre fauteuil, oubliez tout et criez les mots qui vous viennent. Criez-les plusieurs fois, doucement puis de plus en plus fort. Si vous ne ressentez rien après quelques minutes, c’est hélas qu’on ne peut rien pour vous : sans que vous le sachiez encore, vous êtes morts. »
Je voulais terminer avec deux citations. La première : à la fin de « Moi, Marthe et les autres », Hardy lance de l’au-delà ces mots qui ont valeur de testament, en s’adressant à ses compagnons d’infortune « qu’ils ne voient pas la vie comme tuée par la mort ». En réponse, Marthe assure les autres qu’en arpentant les lieux dévastés tout autour, ils trouveront « les raisons d’espérer ». La seconde, c’est Mama Luna qui dit à Léo et Marcio, vos deux héros, que malgré « des peurs couleur corbeau » et « des manques venus de l’enfance », ils resteront toujours avec leur joie, avec « ce bonheur qui se cache, mais qui est le leur depuis toujours ».
Comment commentez-vous ces deux textes ?
Vous citez des passages importants parce que, comme je vous le disais, je crois qu’on peut connaître des moments dramatiques dans nos vies, et se relever quand même, malgré tout. Cette idée que la vie n’est pas tuée par la mort ou que le bonheur se cache mais demeure quand même, quelque part au fond de nous, ce n’est pas de la fiction. La vie, après m’avoir fauché et mis en pièces, m’a prouvé qu’on pouvait renaître, et renaître non seulement plus vivant, mais plus heureux. Croyez-moi, je n’aurais pas fini ces livres sans cela. Ils ont beau être sortis de la douleur, je les ai terminés dans la joie.
Interview réalisée par Dan Burcea (oct. 2018)
Antoine Wauters, « Moi, Marthe et les autres », Éditions Verdier, 2018, 71 pages, 12,50 euros.
Antoine Wauters, « Pense aux pierres sous tes pas », Éditions Verdier, 2018, 181 pages, 15,00 euros.

