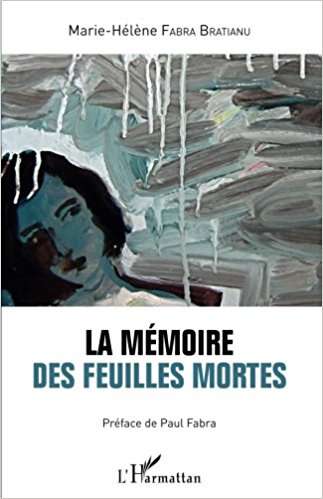
C’est ainsi que l’on pourrait définir l’œuvre de mémoire que nous propose Marie-Hélène Fabra Bratianu dans un livre qui veut mettre des couleurs sur un passé en noir et blanc étendu sur trois générations d’une des familles les plus connues d’intellectuels et hommes politiques de la Roumanie d’entre-deux guerres, dont elle est la descendante : les Bratianu. Texte dense où l’histoire personnelle croise l’Histoire majuscule avec la violence et la brutalité que seuls les grands changements de régime peuvent provoquer, «La mémoire des feuilles mortes» emprunte un discours qui renvoie vers des rituels de langage censés protéger «l’homme […] pris au piège d’un mirage où l’histoire se répèterait».
Redessiner et remplir avec des mots les contours d’un néant suspendu entre l’inclémence du passé et l’impasse d’un présent oublieux ne pouvait être qu’un exercice délicat pour Marie-Hélène Fabra Bratianu. Pour le réussir, elle n’hésite pas à s’appuyer, avant de s’essayer à l’écriture, sur son expérience d’artiste-peintre et de cinéaste. S’en suivra une longue série d’hésitations et de recherches qui ponctueront ce travail de mémoire. La rédaction du récit ne surviendra qu’après plusieurs tentatives de mise en images – cinématographiques ou picturales –, et ne sera accomplie que grâce aux encouragements, si ce n’est aux injonctions des proches ou d’inconnus rencontrés au hasard des voyages qui sauront vite saisir l’importance d’un tel exploit, « pour ne pas laisser mourir cette histoire ».
Les raisons de ces tâtonnements sont multiples. Elles prennent la forme d’une litanie où « la généalogie que l’on égrène comme un chapelet » rappelle « la manière de présenter les personnages de la tragédie grecque ». Tout aussi réelle et multiforme, celle des Bratianu peut s’écrire comme un scénario bouleversant où la haine des hommes incarnée par les idéologies de la mort, fasciste, puis stalinienne, occupe une place centrale: trahisons, révolutions, dépossessions des biens et privations de liberté, arrestations, détentions politiques et exécution sans procès, exil, effacement pendant une longue période du droit à la mémoire.
La charge d’un tel héritage ne peut que peser très lourd sur les épaules de l’auteur qui sait que la démarche à laquelle elle s’attèle exige, en plus d’un travail minutieux de restauration, un acte semblable à un sacerdoce apte à arracher de l’oubli ses êtres chers dont elle ne sait plus si l’existence se trouve dans le réel ou dans une symbolique qui fait d’eux de vraies icônes. S’arracher à cette mythologie qui devient encore plus peuplée d’ombres après le départ pour l’éternité de sa mère est pour elle une condition primordiale, libératrice, qui lui permet de sortir du domaine du merveilleux et d’essayer de mettre en récit ce qu’elle croyait voué pour toujours à la légende familiale et, donc, au territoire de l’intime.
Deux textes que nous n’hésitons pas à citer en entier, tellement ils sont importants, illustrent cette démarche.
Le premier, précède la série de tableaux peints par Marie-Hélène Fabra et intitulée Archives familiales :
« Cette série appartient à une sorte d’enquête que je mène depuis la mort de ma mère sur son passé familial – et donc sur elle – et donc sur moi ? Elle était née en Roumanie et pendant longtemps j’ai cru que je ne pourrai jamais connaître son pays natal, qu’elle quitta à 14 ans, en 1944. Je prends appui sur des photographies et des manuscrits que j’ai retrouvés chez elle et qui proviennent de sa propre mère dont la vie fut un vrai roman. En noir-et-blanc, ces images évoquent un monde élégant, tantôt insouciant, tantôt chargé d’une gravité prémonitoire. Ma mère voulait que je les regarde comme si elles provenaient de l’Atlantide. Les textes inachevés de ma grand-mère qui a connu successivement les splendeurs des grandes familles de la Mittle Europa puis les rigueurs des prisons politiques roumaines renforçaient à mes yeux le caractère extraordinaire de ma mère. En un sens, ces peintures sont les fragments d’un dialogue avec des morts, dont parfois je ne sais rien de plus que la forme de leur moustache ou la manière de se tenir ».
Le second surgit dès les premières pages du livre comme un vrai argumentaire du récit :
« Elle était la descendante d’une grande famille roumaine, les Bratianu. Son arrière-grand-père puis son grand-père contribuèrent à la constitution de l’Etat roumain ; il y a des rues, des places, des statues qui portent son nom. Son père était historien et homme politique. Il est mort dans un camp et ma grand-mère fit trois ans de prison politique. Tout cela, autant le dire, je l’ai entendue à satiété. Ma mère me racontait les palais de la famille de sa mère, une authentique princesse roumaine, les réunions familiales avec des vieux généraux à qui on faisait des blagues, des jeux dans des parcs avec un vrai roi, des enfants princes, des gouvernantes allemandes et moi j’écoutais cela un peu ahurie que ma mère puisse avoir connu de telles merveilles. Puis j’ai grandi et ma mère continuait à me raconter ses belles histoires mais j’en connus d’autres ; des huissiers bien français qui réclamaient des amendes négligées, des comptes en banque bloqués, des escrocs qui lui faisait miroiter de belles histoires, eux aussi. Quand je lui demandais de tenir compte de la réalité, elle me répondait un pourr quoi fairre ? désarçonnant. Je me rappelais alors que ma mère venait d’une autre planète, noir et blanc, comme les photographies accumulées dans une malle, à la maison. »
On comprend dès lors que son plus grand défi d’artiste et d’écrivain est de pouvoir garder le cap dans une narrativité chancelante qui perd pied à chaque tentative de franchir la frontière entre réel et fictionnel. Difficile de s’y retrouver dans ce cas, si nous restons circonscris à une quelconque stratégie réductrice qui mettrait au premier plan des intentions ou des tournures esthétiques aux penchants maniéristes. Car si la narration n’a pas besoin d’invention pour obtenir un effet romanesque – les personnages le sont de la façon la plus naturelle et pittoresque, tchekhovienne – cela ne veut pas dire qu’elle est dépourvue d’une substance fortement tragique. Le vrai regard du lecteur doit se porter au-delà de ces apparences pour comprendre que ce qui se cache derrière ce refus d’accepter ce que le commun des mortels appelle la vie réelle tire sa source dans quelque chose de beaucoup plus profond, dans le traumatisme de l’exil, de la dépossession brutale dès l’âge de 14 ans de l’amour familial protecteur et de la perte d’identité.
La même grille de lecture est valable pour le personnage de la grand-mère que la narratrice a peu connue mais qu’elle découvre en recopiant ses mémoires retrouvées dans des carnets épars. Ce geste met la fidélité de la réécriture au service du récit tout en aidant le texte à déployer toutes ses vertus biographiques. La séparation des genres est ici beaucoup plus nette : nous avons affaire à un vrai texte littéraire où l’identité des protagonistes se cache derrière des personnages bien ciblés, Ioana et Georges deviennent Anne et Alexandre, et où le passage de « je » à « elle » accentue le caractère fictionnel du texte, sans rien perdre de sa force d’évocation, surtout lorsqu’il s’agit de la période de détention dans les geôles communistes où cette femme est rendue coupable d’avoir des racines princières et forcée à ramasser une à une les feuilles mortes d’un arbre dominant la cours du pénitencier. Inutile d’ajouter que le titre du livre prend sa force dans cet épisode.
Là encore, nous sommes invités à franchir le seuil du premier degré de lecture et rejoindre la trajectoire tragique qui traverse le récit. L’histoire de l’arrestation et de l’assassinat de Georges Bratianu, le grand-père de la narratrice, pèse de tout son poids sur l’économie du récit. Toute sa vie, raconte Marie-Hélène Fabra Bratianu, ses relations avec sa mère «ont été marqués par cette absence et par cette irruption de l’innommable».
Et c’est avec cette absence et avec un héritage qu’elle se doit aujourd’hui de gérer qu’elle se retrouve liée à la Roumanie contemporaine et que le pays de ses ancêtres devient tout naturellement le sien. L’enterrement de sa mère dans le caveau familial, les aller-retour pour des raisons de succession et de procès engendrés par de compliquées démarches administratives, ne font que lui renforcer la conviction que désormais elle devra assumer cette identité inscrite dans son sang.
Réussira-t-elle ce chemin de retour, seule voie capable à effacer les douleurs profondes de l’exil qu’avait connues il y a un peu plus d’un demi-siècle sa famille dans un pays où des rues et des boulevards portent le nom de ses ancêtres et où des statues les représentent avec solennité ?
Quel sens donner aujourd’hui à cette tragédie familiale et nationale dont il est encore trop tôt à espérer un remède définitif et efficace ?
Ce sont des questions auxquelles le lecteur trouvera des réponses dans ce livre émouvant, sincère et si important pour comprendre le siècle passé et pourtant si proche, et tous les travers de tant de convulsions de l’Histoire.
La riche collection de photos ayant appartenu à la famille complète le contenu narratif de l’œuvre.
Dan Burcea (20/09/2016)
Marie-Hélène Fabra Bratianu, La mémoire des feuilles mortes, Éditions L’Harmattan, 2016, 260 p., 26,50 euros.


Soyez le premier à commenter