
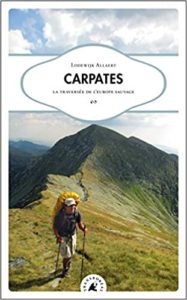 Carpates, La traversée de l’Europe sauvage. C’est sous ce nom frappant comme un bloc de roche sur la surface de l’imaginaire que Lodewijk Allaert nous présente son nouveau livre de voyage à travers l’Europe Centrale et Orientale, de Bratislava, la capitale slovaque et jusqu’à Orșova, sur les rives du Danube, en Roumanie. L’auteur n’est pas à sa première expédition. Avec Kristel, sa coéquipière, il avait décrit déjà dans Rivages de l’Est (2012) pour raconter leur expédition de 110 jours en kayak, de Budapest à Istanbul.
Carpates, La traversée de l’Europe sauvage. C’est sous ce nom frappant comme un bloc de roche sur la surface de l’imaginaire que Lodewijk Allaert nous présente son nouveau livre de voyage à travers l’Europe Centrale et Orientale, de Bratislava, la capitale slovaque et jusqu’à Orșova, sur les rives du Danube, en Roumanie. L’auteur n’est pas à sa première expédition. Avec Kristel, sa coéquipière, il avait décrit déjà dans Rivages de l’Est (2012) pour raconter leur expédition de 110 jours en kayak, de Budapest à Istanbul.
Nous rencontrons cet auteur passionné pour parler de l’irrésistible appel des cimes carpatiques qui est à l’origine de son livre passionnant, sensible et rempli d’humanité.
Vous êtes un écrivain et un infatigable voyageur. Comment sont nées ces deux passions qui sont l’incarnation de votre désir de découverte, de contemplation et de mise en parole de la beauté du monde ?
Lorsque j’avais dix-huit ans, j’avais besoin de mettre de l’ordre au milieu de mon chaos. Je voulais hurler dans le vent alors j’ai écrit, parce que « écrire, c’est hurler sans bruit » écrivait Duras. C’est aussi un moyen de donner vie à sa propre fiction et donc de s’inventer. À cet âge-là, je suis parti vivre seul aux Pays-Bas sans savoir que j’y resterai plusieurs années. En soi cela n’avait rien d’une expédition et pourtant un mouvement s’initiait à travers l’immersion culturelle. Je vivais une métamorphose. Aussi paradoxal que cela puisse paraître j’apprenais à devenir moi-même en devenant autre. Depuis, je n’ai cessé d’entretenir cette mue par l’expérience de l’altérité et de l’écriture. C’est pour moi la seule façon de ne pas fixer mon récit dans les certitudes et de conserver une forme de transcendance.
Arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur ces deux phrases prononcées par des amis rencontrés auparavant en Roumanie : « Allez voir dans les Carpates […]. C’est un monde à l’abri de notre temps ». Peut-on dire que ces phrases ont été l’élément déclencheur de votre projet de voyage ?
Oui, en grande partie. J’aime beaucoup l’idée que certaines paroles agissent comme des énigmes qui prennent le temps de cheminer avant de s’accomplir. C’est ce qui est arrivé avec ces mots de Micu et Florica. Ils ont refait surface quelques années après avoir été prononcés. C’est comme s’ils avaient attendu le moment opportun pour révéler leur part de mystère et infléchir mon destin.
Comment prépare-t-on une expédition d’une telle ampleur et de combien de temps avez-vous eu besoin pour établir l’itinéraire, l’intendance et d’autres détails, vu le parcours qui est devant vous : Slovaquie, Pologne, Ukraine, Roumanie ?
Pour cette expédition de quatre mois il a fallu environ un an de préparation. Le plus long a été de définir l’itinéraire de crête sur les différents massifs, ainsi que les points de ravitaillement. Les ressources topographiques sont très variables selon les pays. La Pologne et la Slovaquie sont bien dotées, la Roumanie est en bonne voie, mais pour l’Ukraine, qui ne se trouve pas dans l’espace Schengen, c’est plus compliqué. Les seules cartes que nous ayons trouvées dataient de 1982. En trente ans, la végétation avait repoussé…
En définitive, même si l’on est en mesure d’établir une route théorique et un cadre logistique, il faut se faire à l’idée qu’on ne maîtrise pas tout et qu’il y aura toujours une part de galère et une part de mystère. C’est le principe même de l’aventure.
Pour fixer le cadre général de notre discussion, je ferais référence à ce que les spécialistes de la littérature de voyage appellent « l’ère des cartes pleines » pour parler, en opposition aux « cartes vides » de Joseph Conrad, du sentiment éprouvé par le monde moderne qui pense que tout a été découvert, que rien ne viendrait plus bousculer notre curiosité. Comment commenteriez-vous cette idée de la disparition des espaces vierges et, avec elle, de l’appauvrissement par « la raréfaction de l’altérité et la répétition forcée des mêmes clichés », selon les mêmes sources ?
Que les cartes soient vides ou pleines cela n’a aucune espèce d’importance car l’expérience du voyage ne se limite pas à la géographie. Voyager ne consiste pas seulement à traverser un paysage mais aussi à devenir poreux, perméable au dehors. Il faut qu’à son tour le paysage vous traverse.
Néanmoins, la question est pertinente car l’idée selon laquelle la véritable aventure se trouve là où l’homme n’a jamais mis les pieds est encore largement répandue, y compris chez certains écrivains voyageurs contemporains.
Cette vision territoriale de la planète dit deux choses sur notre occident intérieur. D’une part, qu’il est aussi asséché en émerveillement que la mer d’Aral en eau. D’autre part, qu’il est aujourd’hui encore, imprégné par l’héritage expansionniste des puissances européennes du XVIe siècle.
Qu’on l’admette ou non, notre rapport à l’ailleurs est culturellement influencé par l’époque des grandes explorations et l’histoire du colonialisme. Lorsque je lis un récit de voyage dans lequel l’auteur égrène les kilomètres et les pays traversés, j’y vois en filigrane l’empreinte d’un atavisme conquérant. Pour cette raison, je ne regrette qu’à moitié que la planète soit totalement cartographiée. Je me dis qu’après avoir voyagé pendant quatre cent ans en regardant sa boussole, le voyageur va peut-être enfin relever les yeux et se mettre à regarder le monde. L’aventure sensorielle pourra alors commencer.
Un élément, tout aussi symbolique, est, lui aussi, de nature purement cartographique. Il concerne la position particulière des Carpates comme lieu inconnu du centre de l’Europe. « Aujourd’hui, au XXIe siècle, – écrivez-vous – personne ne sait vraiment ce qu’est l’Europe, où elle commence et où elle se termine ». Comment expliquer cet impasse que l’on pourrait nommer « les cartes impossibles » ?
Il est quand même assez ironique de constater que notre Vieux Monde s’est donné pour mission de cartographier la planète et qu’aujourd’hui les géographes sont incapables d’établir une définition consensuelle des limites de l’Europe.
J’ai fait ce constat en cherchant le centre géographique du continent. Je pensais naïvement qu’il se trouvait en Europe centrale. Or, selon les paramètres et les méthodes utilisés, il peut aussi bien se situer en Roumanie qu’en Norvège. Tout dépend du tracé des frontières. Du reste, L’Europe centrale, elle non plus n’a pas de limite bien définie. C’est une zone floue, indistincte. Cela est plutôt pour me réjouir puisque cela signifie qu’il reste une inconnue et que, dans cette petite part de mystère, nous pouvons continuer à imaginer notre monde.
Votre voyage se déroule sous le signe de l’émerveillement. « Je m’émerveille de tout », écrivez-vous dans un chapitre au titre suggestif, Premiers pas. Parlez-nous de l’exaltation qui vous pousse en ce début d’aventure. Dans le même contexte, quels sont les plus beaux souvenirs de la beauté des lieux avez-vous gardé ?
Les débuts sont toujours accompagnés d’ivresse. Dans une aventure au long cours la promesse du voyage s’ajoute à l’exaltation procurée par la marche et le grand air. L’acuité se développe. Chaque petit événement, chaque couleur, chaque sensation, est une éclaboussure d’émotion. Tout devient propice à l’émerveillement : un insecte posé sur une ombelle, l’eau clair d’un torrent, le vert de la forêt et le bleu du ciel, un visage qui se fend d’un sourire, une main tendue, les cantilènes des cueilleuses, le son des clarines, la silhouette d’un berger, une harde de chevaux sauvages, l’aube claire et la fraîcheur de la rosée, un chemin de transhumance sur le dos d’une colline, un crépuscule incandescent, une accalmie dans la tempête, les sommets escarpés et l’horizon qui s’étire, une gorgée d’eau-de-vie dans un matin glacé, du fromage et du pain à l’heure du repos, la saveur d’une tomate, la flamme du réchaud et le crépitement d’un feu, un rayon de soleil dans un jour de pluie, un vêtement sec, le souffle du vent sur la peau, le parfum des fleurs, le chant des arbres et des oiseaux. Je pourrais continuer ainsi, tant ce voyage est tout entier un beau souvenir.
Plus loin, vous faites cette déclaration d’amour à la beauté de la nature : « Parfois, je me mets à penser que la nature a créé l’homme pour qu’il soit témoin de la beauté du monde ». Est-ce que c’est avec cette belle promesse de récompense que vous êtes partis à l’aventure ?
C’est en effet une déclaration poétique mais aussi une considération épistémologique tout à fait sérieuse basée sur ce qu’on appelle le « principe anthropique ». C’est passionnant ! Le principe anthropique fort nous dit que la présence d’une forme de vie évoluée sur la planète terre n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’ajustements fins déterminés par les paramètres fondamentaux dont l’Univers dépend. En clair, cela signifie que nous avons été programmés pour rendre possible la constatation et même l’existence d’un univers observable.
Je trouve cette approche métaphysique extraordinairement stimulante. Le seul fait d’y penser me donne le sentiment que la vie est une aventure merveilleuse, et peut-être aussi une entité investie d’une intelligence dont n’avons pas la mesure.
Au-delà de la beauté des lieux il y a celle des gens, à la fois dans la solidarité et l’hospitalité. Je cite à l’appui cette phrase : » Je suis fasciné par les regards que je croise dans les Carpates ». Que pouvez-vous nous dire de ces rencontres ?
Il faut d’abord reconnaître que la solidarité et l’hospitalité s’accomplissent plus facilement dans les hautes solitudes que sur la ligne 13 du métro. Lorsqu’on vit sur de grands espaces on cherche l’autre ; lorsqu’on vit l’un sur l’autre on cherche son espace.
Mais ce n’est pas l’unique raison. Bien souvent les populations montagnardes sont issues de lignées de paysans insoumis, de déserteurs, d’exilés, de réfugiés et autres minorités en tout genre venues chercher dans les plissements alpins un supplément de liberté en réaction à l’oppression qu’exerçait sur eux l’autorité de la plaine. Aujourd’hui, les populations montagnardes conservent ce sens de la justice et du partage.
On pourrait évoquer également les difficultés liées à une vie agricole et pastorale, le hasard des récoltes ou l’austérité de l’hiver, lorsque le sol devient dur comme la pierre et que l’eau gelée se fend à la hache. Dans une vie à la dure, la solidarité et l’hospitalité sont tout simplement vitales.
Il y a eu des peurs et des rencontres inattendues avec des animaux. Pouvez-vous nous raconter l’incroyable face-à-face avec l’ours des Carpates ?
C’était à l’aube, dans les Maramures. La veille au soir je m’étais endormi sur les cartes en m’enfilant des rasades de ţuicà (l’alcool blanc distillé de prunes roumaine, n.n). Je cherchais un passage pour redescendre vers la vallée de Vaser mais je ne trouvais pas. Ma coéquipière et moi, avions donc suivi le lit asséché d’un torrent jusqu’à une corniche perchée au-dessus d’une rivière. L’obscurité levait doucement son voile. L’être humain ne semblait jamais être venu ici, ou si peu que les montagnes l’avaient oublié. La forêt vibrait d’une seule force et nous avancions à pas de velours, aspirés par la puissance des lieux. Quand soudain, dans la courbure de la piste, il est apparu lentement, tel le souverain de ce monde sauvage.
Vous évoquez la marche, l’effort comme un élixir qui nourrit le corps et le mental. Sans pouvoir vraiment le mesurer, mais plutôt le subir, comment l’avez-vous ressenti, vécu ? Y a-t-il un seuil au-delà duquel l’équilibre d’une marche de longue haleine devient impossible ?
Lorsque vous marchez en moyenne dix heures par jour, chaque jour, durant plusieurs mois, vous accoutumez le corps à un taux élevé d’endorphines, ce qui vous prémunit de la douleur et atténue la sensation d’épuisement.
Il arrive même parfois que le corps et l’esprit atteignent une forme de transe : le temps et l’espace se dilatent, une vague d’énergie vous submerge. Elle anesthésie la faim, le doute, la douleur et vous disparaissez dans le paysage, comme si vous deveniez de l’énergie pure. J’ai vécu cet état extatique deux ou trois fois pendant l’aventure. L’épisode dont je parle à la page 124 du livre a duré plus de deux heures. Il était accompagné d’une sensation d’éternité et d’un sentiment d’unité avec le monde. C’est ce que Romain Rolland appela le « sentiment océanique ».
Quant au seuil d’équilibre, je dirais qu’au-delà de dix d’heures d’efforts intenses sur une marche au long cours, on prend le risque de sombrer dans l’écœurement.
J’ai cherché un fragment capable de définir votre livre. Je pense que celui-ci en dit presque tout. Il résonne comme un poème. « Quantité de formes, de couleurs, de visages, de paysage et même d’émotions, sont absorbés dans le ventre de mes pages ». Peut-on le mettre en guise de frontispice de votre ouvrage ?
Cela résume bien en effet ma volonté de capter et de restituer la polyphonie du voyage. Mais un livre n’est que du papier frappé d’un peu d’encre. L’auteur n’est qu’un intermédiaire. Il faudrait y inclure les lecteurs, car en définitive ce sont eux qui font de cette encre une histoire.
Propos recueillis par Dan Burcea
Lodewijk Allaert, Carpates, La traversée de l’Europe sauvage, Éditions Transboréal (24 octobre 2019), 257 pages.

