
Qui êtes-vous, où êtes-vous née, où habitez-vous ?
Une seule certitude, je suis née à Paris XIV et j’ai grandi dans une banlieue pavillonnaire, au Perreux-sur-Marne. Enfant, j’étais enfant dans un jardin, avec mon chat. La mort est entrée, brutalement : il fut tué par un chien. Fin de l’enfance. Le chat de mon adolescence était noir : nous l’avons laissé en partant à Paris, après la mort de mes grands-parents. Je lui jurai de revenir, et revins trop tard. Dix ans après, il ne vint pas, il ne répondit pas à mes appels, d’ailleurs c’était une femelle, noire et stérile, aussi fantasque que les étoiles. Heureusement un homme qui m’aimait me gifla, m’enfonça dans la voiture, et démarra. Ce fut le plus précieux cadeau que j’aie jamais reçu : une gifle, qui cuit sur ma joue chaque fois qu’un trou noir veut m’avaler. Je n’ai aucune nostalgie ; je marche vers l’avant. Comment aurais-je eu une nostalgie du Perreux-sur-Marne et de pâles souvenirs : la queue chez Suplisson, la mort de Claude François, les majorettes. Je lui ai très tôt donné un nom de substitution, Pérou, un jour où une amie de ma sœur nous parla de ce pays où elle ne pouvait plus aller, à cause du Sentier lumineux.
À la place de la nostalgie, j’ai une mémoire incertaine du passé ; les uns et les autres me racontent des histoires d’avant aujourd’hui, et j’ai toujours oublié ; peut-être inventent-ils, l’une un voyage en Hollande, l’autre un lieu où j’aurais vécu. J’ai toujours oublié. J’aime demain. C’est pour demain que je bâtis des scénarios ; il n’y a pas une histoire qui m’aurait été transmise. L’imagination nargue les coups du sort, plus encore aujourd’hui où il semble que je doive être privée de cet aujourd’hui où j’avais réussi à construire une demeure et à planter une glycine. Le reste, ce sont des bouts de bois flottant entre l’ancien et le nouveau monde, ma mémoire naufragée. Cela me paraît bien flou, et tout particulièrement ces jours-ci, obscurs. Dans le fond je n’ai connu qu’adversités et luttes, je les affronte, mais elles ne m’intéressent pas. Elles ont une tête de formalités administratives.
Reste la joie de vivre. Eclatante comme le cri du coq qui vient de déchirer la nuit de l’hiver austral.
Un jour, le cheikh d’une tariqa soufie nourri de l’idée de la Tradition primordiale me parlait des racines fondamentales : K-R, donnant Christ ou Coran. P-R signifiant la lutte. Je ne crois pas à la Tradition primordiale, mais j’aime que toute conversation m’entraîne quelque part : Perreux, Paris, Pérou, disons que je cherche une ville régie par le P-R. Ou bien la deuxième moitié de ma vie (je m’accorde cent ans) se passera-t-elle bas les armes ?
Vivez-vous du métier d’écrivaine ou, sinon, quel métier exercez-vous ?
Je vis de ma plume et de ma tête, de mon imagination et de mon intuition, de mes observations et conversations, de mon expérience du monde : plus gidienne que proustienne, plus cornélienne que racinienne, même si sur la route a parfois été l’espace de mon lit. J’ai un métier de chercheur en sciences sociales et en humanités, qui est bon s’il est liberté. D’ailleurs les articles, avec leurs cinq cents notes de bas de page et les milliers de lecture, sont plutôt les promenades au fil de mes pieds.
Mes chères promenades, je les appelai naguère les perditions : il suffit d’un point de départ et de savoir marcher. Mais comme fille j’ai une boussole dans le cerveau et ne m’égare jamais vraiment. Je fais semblant.
Je fais aussi semblant de croire qu’écrivant des articles et des livres savants je ne m’égare pas tant que cela. Comment savoir ?
J’ai été épuisée par un énorme roman qui m’a pris six ans de travail – Dans les plis sinueux des vieilles capitales (paru en 2011, mais terminé en 2006, quelques jours avant une opération bénigne où j’ai failli laisser et ma peau et mes os) – et comme je ne suis pas morte, il fallut quand même qu’après mon corps, mon âme aussi se remette en route et finisse par murmurer : la vie est belle.
Mon métier ? Je ne le vois pas comme le voit mon employeur, et nos rapports ne sont pas cordiaux. Tel que je l’exerce, il me convient : quand je vivais au bistrot, j’interrogeai les gens ; quand j’ai travaillé aux Puces j’ai fini par me faire virer car je regardais les gens comme entomologiste ; faisant des entretiens sociologiques, le passage des années ayant exacerbé mon émotivité et ma nature d’éponge, j’entends ce qui m’est dit. Puis, m’envolant vers les hauteurs géopolitiques, je prends une échelle où l’humain recule. Maintenir les deux à la fois, toujours, ce grand écart, à tout prix, voilà ce que je fais. Dans ce sens, ce n’est pas si différent d’un roman, où l’on saisit le plus mince détail et l’ensemble de la construction. Les deux, et tout le reste entre. Mon métier me plaît car je m’y barricade et protège ; il me déplaît car il érige trop de barricades et protections.
Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?
Je n’ai pas de rapport avec la littérature – je peux même dire que j’ai détesté cette matière en khâgne. Faire des commentaires composés et lire Gérard Genette… heureusement il y avait le thème latin.
Quel est l’auteur/le livre qui vous ont marqué le plus dans la vie ?
Sans hésiter : Autant en emporte le vent. Combien de fois l’ai-je lu. Plus je le lisais, plus je commençai tôt dans l’histoire à sangloter. Puis Pelléas et Mélisande ou les Scènes de la vie de Faust, mais ce serait dire que la musique, surtout quand la voix y est instrument, compte plus que la littérature. Eh bien non. Mais un roman qui ne fût pas un opéra, éveillant tous les sens, s’engloutit. Je lis donc plutôt des essais. Il y a aussi Dersou Ouzala, qui est mon cher ami. Pas beaucoup de littérature, finalement. Des bouts de Corneille. Un peu de Catulle. Toujours dans sa langue originelle – la Sonate à Kreutzer. Puis L’homme sans qualité, oui vraiment l’homme sans qualité et La Bible dans une petite traduction rouge que j’ai.
Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?
J’ai répondu dans le désordre à vos questions. Les reclasserez-vous ? en tout cas ma réponse ici m’a été soufflée par ce que je réponds non pas à la suivante mais à celle d’après. Pour mes articles et essais, la méthode est la même que pour les romans : je ne peux l’écrire que si cela existe. Dans ce sens je n’ai aucun métier et ne me repose sur rien. A chaque fois je pars de rien (enfin, n’est pas rien ce qui vient des sens) ; il faut tout construire. Si l’on regarde le très vaste ensemble de ma production dite scientifique d’un côté et littéraire de l’autre, les cohérences sont évidentes, mais par le petit bout de la lorgnette la tapisserie devient mille fleurs dans des champs séparés de milliers de kilomètres.
La réalité (je pose le mot tout en le sachant suspect, mais tout de même il n’y a pas que des volonté et représentations) me conduit ; je suis frappée par des faits qui paraissant divergents portent une cohérence, et pourtant je ne crois pas non plus à la grande cohérence. Pas de microcosme et macrocosme, pas de théosophie, mais tout de même l’idée d’un chemin qui se découvre au fil des pas pourvu qu’on marche au bon endroit.
Ces temps-ci, je suis enfermée dans la production universitaire, sachant cependant que je suis la même personne qui la conçois et la rédige, et je doute : est-ce la même ? l’autre, où est-elle ? n’y a-t-il pas un moment où je me dépouillerai de ma trouille ? ou bien le masque posé sur mon visage l’a-t-il irrémédiablement déformé ? et puis mon devoir social et politique…
Contrariée, tourmentée, toujours les cris de l’adolescence et la persévérance confiante de l’enfant.
Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?
J’écris d’un trait comme sous la dictée, enthousiaste, et je fais environ trois cent cinquante à mille reprises, jusqu’à ce que cela sonne juste et ne soit plus « écrit », mais un chant retrouvé. Travail de dépersonnalisation, comme dirait Gide. Le moment où la phrase exacte existe, ce qu’elle dit n’est plus accessible à moi. Jusqu’à la sensation mienne n’est plus en moi : je ne la retrouverai qu’en lisant. Cela exige donc une troisième personne. Je peux passer à la phrase suivante.
Il y a de moi un livre à la première personne, mais je crois que la première personne dit surtout le présent absolu. Sinon c’est plutôt à la troisième personne. Dans mes choses universitaires je ne mets jamais « nous », mais je, car c’est quand même bien moi qui le dis, je l’ai vérifié et n’ai pas besoin de parachute.
D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?
Mes livres sont comme des personnes. J’explore cette personne que j’aime et ne connais pas. A la fin je ne la connais pas davantage, mais elle existe comme personne. Cette personne ce ne sont bien sûr pas les personnages, mais celle-là qui me prend par la main. Le temps est long ; car elle n’est pas forcément vêtue d’habits clinquants. Je dois beaucoup contempler, et espérer autant. La chercher quand elle se laisse trouver, pour paraphraser Isaïe, et oui c’est une attente mystique. Puis je dois me promener beaucoup avec cette personne, la regarder, apprendre à l’aimer. J’écris – tout à la main – mais il arrive parfois que la personne n’en était pas une, il n’y a rien à explorer, c’était juste une idée, ou bien une projection, ou bien un désir d’écrire, et cela s’arrête là. Je jette. Je détruis tous les manuscrits. Je détruis les cinquante étapes intermédiaires (peut-être cent, en fait). Cela ne me paraît pas une fiction mais la réalité même, et les mots doivent être tout à fait exacts. Pas de différence entre la prose et la poésie, c’est un et le même.
Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?
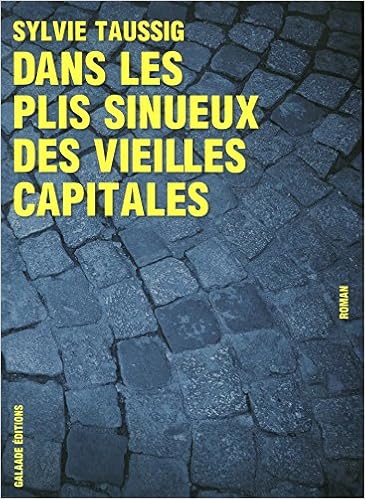 J’ai rarement un titre. Pour Les Plis sinueux, c’est une belle histoire. Je suis chez Jean Dutourd et lui raconte ce que je suis en train de fabriquer ; de son bureau il sort une carte de l’Académie française et écrit dessus « dans les plis sinueux des vieilles capitales ». C’est beau comme du Baudelaire.
J’ai rarement un titre. Pour Les Plis sinueux, c’est une belle histoire. Je suis chez Jean Dutourd et lui raconte ce que je suis en train de fabriquer ; de son bureau il sort une carte de l’Académie française et écrit dessus « dans les plis sinueux des vieilles capitales ». C’est beau comme du Baudelaire.
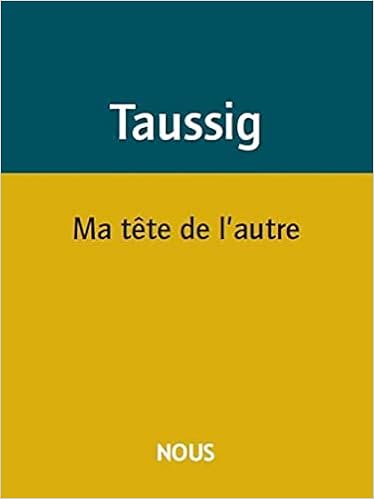 Je suis très fière de Ma tête de l’autre, car c’est moi qui l’ai trouvé, et en plus le titre est exact. Sous le nopal aussi, mais je ne me rappelle plus à quel moment je l’ai inventé. Patron titan ? est-il de moi ? de qui d’autre ? et Prison ? Il ne faut rien me demander qui sollicite ma mémoire, ma grande passoire.
Je suis très fière de Ma tête de l’autre, car c’est moi qui l’ai trouvé, et en plus le titre est exact. Sous le nopal aussi, mais je ne me rappelle plus à quel moment je l’ai inventé. Patron titan ? est-il de moi ? de qui d’autre ? et Prison ? Il ne faut rien me demander qui sollicite ma mémoire, ma grande passoire.
Il y a aussi des manuscrits dans un placard (mais quand je suis partie, j’ai dispersé mes affaires dans différents placards, et ne saurai dire où elles sont, où ils sont). Je m’amuse toujours à dire à mes enfants : je souhaite bonne chance à mes biographes, il va se noyer, entre mes vies réelles et mes vies imaginaires, mes vies oubliées, mes vies secrètes. Il me faut beaucoup de volonté pour maintenir à flot une existence. Dans les romans, c’est béatitude et compagnie : je ne choisis rien. L’artisan que je suis arrange et cisèle ensuite.
Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?
J’ai moins de rapports avec les personnages qu’avec le roman lui-même, dans son ensemble. Le tout qui me hante. J’y verse tout. Je devrais écrire à l’imparfait, car justement en ce moment c’est le désert. Il n’y a personne. Or je me sens bien surtout dans la peau de l’autre – la mienne ne regarde que moi et mes proches.
Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.
![Le Système du complotisme par [Sylvie TAUSSIG]](https://m.media-amazon.com/images/I/41lGkBso9DS.jpg) Je n’ai pas envie de parler du Système du complotisme qui vient de sortir. Mon moi romancier ne se réconcilie pas avec mon moi essayiste, qui pourtant travaille avec entièreté. Les notes de bas de page m’estropient et pourtant je les trouve justifiées, nécessaires. J’ai fait, m’a-t-on dit, un travail singulier ; et, comme pour mes romans, l’attachée de presse qui turbine rame. Mais « nous ne voyons jamais que l’envers des destinées, l’envers même de la nôtre ». Un jour il y aura quelque chose, mon projet est qu’il y ait quelque chose plutôt que rien.
Je n’ai pas envie de parler du Système du complotisme qui vient de sortir. Mon moi romancier ne se réconcilie pas avec mon moi essayiste, qui pourtant travaille avec entièreté. Les notes de bas de page m’estropient et pourtant je les trouve justifiées, nécessaires. J’ai fait, m’a-t-on dit, un travail singulier ; et, comme pour mes romans, l’attachée de presse qui turbine rame. Mais « nous ne voyons jamais que l’envers des destinées, l’envers même de la nôtre ». Un jour il y aura quelque chose, mon projet est qu’il y ait quelque chose plutôt que rien.
Photo de l’auteure : © Colette Taussig

