
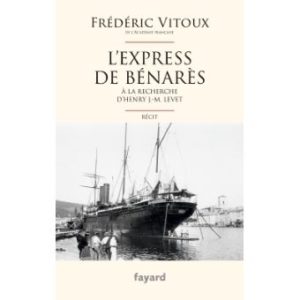 Parler des autres n’est‑il pas le meilleur moyen de parler de soi ? Sinon, comment expliquer cette soif qui pousse Frédéric Vitoux de l’Académie française à s’aventurer à travers « une forêt de questions » à la recherche de son héros, le poète et diplomate Henry Jean‑Marie Levet, mort en 1906 à l’âge de 32 ans ? Loin de se contenter du titre de biographie « semblable à tant d’autres », son nouveau livre, L’Express de Bénarès, est en réalité « une quête plus intime » possédant un code capable de déchiffrer une vie proche de la fiction. Frédéric Vitoux ne pouvait pas rester indifférent à cet homme si romanesque et plein de contradictions, dont « les bizarreries volontaires » faisaient de lui « le plus odieux des snobs », selon le portrait dressé par Francis Jourdain, et qui apparaît « si sage, si rangé » sur une photo de 1902 dans son uniforme officiel, diplomatique. C’est par « ferveur, par attendrissement et par fidélité » que l’académicien français sonde, plus de cent ans après, le destin de celui qui avait enchanté son adolescence avec sa poésie hermétique et si percutante. Voilà pourquoi il conçoit son récit comme un « accusé de réception » aux Cartes postales écrites pas Levet, ce qui est loin d’être un simple détail, sachant que Frédéric Vitoux a débuté lui‑même en littérature en 1973 avec un roman portant le même titre.
Parler des autres n’est‑il pas le meilleur moyen de parler de soi ? Sinon, comment expliquer cette soif qui pousse Frédéric Vitoux de l’Académie française à s’aventurer à travers « une forêt de questions » à la recherche de son héros, le poète et diplomate Henry Jean‑Marie Levet, mort en 1906 à l’âge de 32 ans ? Loin de se contenter du titre de biographie « semblable à tant d’autres », son nouveau livre, L’Express de Bénarès, est en réalité « une quête plus intime » possédant un code capable de déchiffrer une vie proche de la fiction. Frédéric Vitoux ne pouvait pas rester indifférent à cet homme si romanesque et plein de contradictions, dont « les bizarreries volontaires » faisaient de lui « le plus odieux des snobs », selon le portrait dressé par Francis Jourdain, et qui apparaît « si sage, si rangé » sur une photo de 1902 dans son uniforme officiel, diplomatique. C’est par « ferveur, par attendrissement et par fidélité » que l’académicien français sonde, plus de cent ans après, le destin de celui qui avait enchanté son adolescence avec sa poésie hermétique et si percutante. Voilà pourquoi il conçoit son récit comme un « accusé de réception » aux Cartes postales écrites pas Levet, ce qui est loin d’être un simple détail, sachant que Frédéric Vitoux a débuté lui‑même en littérature en 1973 avec un roman portant le même titre.
Entre vous et la poésie d’Henry J.‑M. Levet il y a une complicité de longue date, comme si l’auteur comptait parmi vos proches. Vous écrivez même que son volume « dont les pages se détachent et dont la couverture tient encore bon » appartient à votre vie. Pourriez‑vous nous en dire plus ?
En effet, il s’agit d’une très longue complicité qui s’est nouée entre le poète Henry J.‑M. Levet et moi‑même. Je l’ai découvert un peu par hasard dans une anthologie poétique de 1928 qui devait appartenir à mon grand‑père et qui était restée dans les rayonnages de la bibliothèque qui est maintenant le bureau où je travaille. À 17 ans, j’avais entrouvert cette anthologie et j’étais tombé sur ce poème qui s’appelait Outwards et qui commençait par : « L’Armand‑Béhic (des Messageries Maritimes) / File quatorze nœuds sur l’Océan Indien… ». Ce qui est amusant, c’est que mon père, me voyant lire ce poème m’a simplement dit la phrase suivante : « C’est curieux, tu sais que ton grand‑père a voyagé à bord de ce bateau ». Brutalement, cette poésie un peu étrange, exotique, rieuse, romanesque qui m’avait vraiment émerveillé prenait d’un seul coup presqu’un air de parenté familiale, comme si je pouvais relier ce poète totalement inconnu à ma propre histoire familiale. Mais il y a un autre mystère : pourquoi les cinq ou six poèmes de cette anthologie poétique où Levet figurait en bonne place se sont imprégnés dans ma mémoire après que je les aie lus une ou deux fois seulement, sans chercher à les apprendre par cœur ? C’est un mystère que je n’arrive pas bien à m’expliquer. Ce qui est sûr, c’est qu’en quelque sorte, en arrière‑plan de ma vie, Levet a plus ou moins hanté ma carrière d’écrivain, ma vie d’adulte. Grâce à celle qui est devenue mon épouse, j’ai trouvé par la suite une édition plus récente des œuvres de Levet, qui datait des années de l’Occupation faite par le grand écrivain et éditeur Jean Paulhan chez Gallimard. Au fil du temps, il y a toujours eu des rencontres comme ça entre Levet et moi. Les dix principaux poèmes de Levet avaient été regroupés sous le titre Cartes postales, et, curieusement, sans que j’en prenne vraiment conscience, mon premier roman s’appelait aussi Cartes postales. Il y a eu d’autres rencontres. Comme, par exemple, celle avec la préface faite tardivement, en 1921, quinze ans après la mort de ce poète qui avait disparu en 1906, à l’âge de 32 ans, de tuberculose, par son ami Léon‑Paul Fargue, grand écrivain français, poète de grande valeur mais aussi célèbre pour ses écrits sur Paris – je pense en particulier au Piéton de Paris qu’il avait publié dans les années ’30 et qui est vraiment un classique de la littérature de cette époque. Léon‑Paul Fargue et Valéry Larbaud ont été les artisans de cette première édition des œuvres de J.‑M. Levet. À cela, il faut associer Francis Jourdain l’ami de Fargue qui était peintre et dessinateur. Francis Jourdain, Fargue et Levet constituaient un trio d’amis inséparables. Or, Jourdain, artiste un peu oublié aujourd’hui, était quelqu’un dont les œuvres figuraient dans ma maison. Mon grand‑père qui n’était pas un collectionneur d’œuvres d’art – s’il était bibliophile, il s’intéressait modérément, en revanche, aux œuvres plastiques et aux peintres qui étaient ses contemporains, mais malgré tout, il avait collectionné un nombre incroyable d’eaux-fortes de ce fameux Francis Jourdain. Je me suis rappelé alors que Georges Vitoux, mon grand‑père, avait habité, avant de s’installer dans l’Île Saint‑Louis, à Montmartre, dans la rue Lamarck, son immeuble se trouvant très proche de l’atelier de Francis Jourdain. Je me suis demandé s’il n’y avait pas eu des liens d’amitié entre Francis Jourdain et mon grand‑père, sinon la présence de ses gravures chez ce dernier serait peu compréhensible.
Je pourrais citer plein d’autres échos, plein d’autres résonances entre ce poète qui m’avait fasciné étant adolescent et ma famille et moi‑même. Pour toutes ces raisons, je peux dire que Levet appartient en quelque sorte à ma vie.
Comment cette admiration pour ses poésies s’est‑elle transformée en projet de livre ?
C’est une question difficile. Je ne peux que vous répondre a posteriori. Pourquoi ai‑je voulu, après cinquante ans, peut‑être plus, de proximité avec Levet, me dire que j’aimerais quand même en savoir un peu plus sur cet homme et sur cette œuvre si courte, si brève. L’œuvre de Levet ce sont en gros vingt‑et‑un poèmes, dont dix sont vraiment importants. Pourquoi suis‑je parti à la recherche de Levet ? C’est en effet une question vraiment décisive à laquelle je vous répondrai de manière assez simple. D’abord parce que ce Levet était une énigme. J’aime assez les énigmes, les enquêtes, ce qui résiste, ce qui se dérobe. Tout ce que j’avais pu lire sur lui était troué de silence, si j’ose dire. On savait très peu de choses sur cet homme : il était célibataire, il était mort à 32 ans, il avait été consul pour une courte période à la fin de sa vie. Il y avait quelques témoignages très épars, très rares le concernant, mais on ne connaissait aucune lettre de lui, aucun manuscrit, on ne savait donc pratiquement rien. Je me suis amusé à mener une enquête et c’est là où j’en viens à l’essentiel, ce qui explique un peu pourquoi je vous ai répondu si longuement sur mes liens avec ce poète. J’ai eu le sentiment, en partant à la recherche de Levet, que c’était aussi une manière de partir à la recherche de toutes les raisons pour lesquelles Levet m’avait obsédé pendant tant de décennies. Un peu comme dans Au rendez‑vous des Mariniers, mon précédent livre, où, en enquêtant et en faisant une recherche sur la vie d’un bistro de l’île Saint‑Louis pendant les cinquante premières années du siècle dernier, à une époque où je n’étais pas né, j’ai cherché, en essayant de faire revivre ce bistro, de faire revivre ses propriétaires et les écrivains qui l’ont connu, et aussi de tenter de manière indirecte de parler de moi, de ma famille, de mon enfance, de ce qui avait précédé ma naissance. En écrivant ce livre sur Henry J.-M. Levet, j’ai eu l’impression de procéder non seulement à une recherche d’un poète inconnu, d’un poète disparu pour l’essentiel, mais aussi, d’une manière plus secrète, plus allusive, de chercher les raisons de ma fascination et aussi de partir dans une sorte d’introspection personnelle.
Pourriez‑vous nous parler du travail de documentation nécessaire – je pense surtout à votre voyage à Montbrison sur le traces de la famille Levet, de l’enfance et de l’adolescence de Henry J.‑M. Levet.
Comme je vous l’ai dit, peu de choses étaient accessibles sur Levet. Partir à sa recherche m’a obligé à faire un gros travail de documentation et de recherche. J’ai adopté le ton de la conversation avec ce goût des incidences, des parenthèses, que j’aime par-dessus tout en littérature et qui est une démarche littéraire que j’essaie de développer depuis quelque temps. Il fallait quand même que je fouille un peu ce que l’on pouvait découvrir de Levet. Cela supposait des travaux dans de nombreuses directions. Je dois rendre hommage à des chercheurs qui avaient déjà fait par le passé des recherches sur Levet. Il en restait encore tant de choses à explorer ! Henry J.-M. Levet était né dans une petite ville du département de la Loire, à Montbrison, qui se trouve, je crois, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Saint‑Étienne, dans une très belle région. Je voulais aller là‑bas, d’abord pour respirer l’air de cette ville de province, voir si je pouvais trouver des documents, retrouver sa maison natale. Le père de Levet, je le précise tout de suite, était un notable, il avait été maire de cette ville et, ensuite, pendant trente ans, député de la circonscription de la Loire de Montbrison. J’avais retrouvé des photos de la maison où il avait été élevé, mais on ne pouvait pas savoir si cette maison existait toujours. Je suis donc parti pour Montbrison avec Nicole, mon épouse, et j’ai cru retrouver la maison qui avait été entièrement modifiée et qui est devenue une banque maintenant. J’ai aussi rendu visite à une personne, responsable des archives de la ville de Montbrison, qui m’a fait le meilleur accueil et grâce à qui j’ai retrouvé de vieilles photos de l’époque de Montbrison. Elle m’a aussi mis à disposition toutes les coupures de presse du petit journal local de Montbrison qui relatent de manière très détaillée les conditions de la mort du poète et le déroulement de ses obsèques.
J’ai pu mener d’autres recherches comme, par exemple, celles liées au journal Le courrier français, un hebdomadaire illustré qui avait un assez gros tirage, 100 000 exemplaires environ, pour lequel Levet avait travaillé pendant deux ans, à partir de l’âge de dix‑neuf ans. Je voulais relire tous ses articles, même si c’était d’un intérêt littéraire relativement médiocre. Cela avait une importance pour le jeune Levet qui avait gagné Paris, qui avait pris le large par rapport aux attentes de ses parents qui auraient voulu qu’il soit un homme respectable, qu’il fasse de bonnes études. C’était tout ce à quoi rêvait son père qui était un homme brillant, polytechnicien, qui était député. Levet fils avait fait des études médiocres, n’avait sans doute même pas passé son bac, n’avait peut‑être envie que d’écrire de la poésie et de vivre une existence très à l’écart du conformisme provincial et bourgeois de ses parents. Il a d’ailleurs vécu pendant de nombreuses années à Montmartre dans une sorte de bohème un peu effrénée, ayant une attitude un peu provocatrice, avec des tenues extravagantes. Comme je vous disais, j’ai voulu commencer par lire tous ces articles qu’il avait publiés dans ce journal où il avait travaillé, entouré de dessinateurs de grande valeur comme Toulouse‑Lautrec, Jules Chéret, Aubrey Beardsley qui était proche d’Oscar Wilde. C’était un journal tout à fait intéressant, grand public, un peu sarcastique, un peu rieur.
Ensuite, j’ai lu et relu attentivement tous les textes où l’on pouvait parler de Levet, même s’il n’y en avait pas beaucoup. Lorsqu’en 1921 Valéry Larbaud et Léon‑Paul Fargue rassemblent pour la première fois en volume les poèmes de Levet qui n’étaient parus qu’en revue, il y a des échos dans la presse, il y a des gens qui réagissent et qui écrivent des articles où ils évoquent des souvenirs de Levet.
Je pourrais vous donner des exemples d’autres recherches concernant, par exemple, la période où il était consul de France à Manille et à Las Palmas, alors qu’il était déjà gravement atteint par la tuberculose. Mais avant cela, j’insiste, il restait tant de mystères dans la vie de cet homme. Levet avait été aux Indes, à bord de L’Armand‑Béhic sur lequel mon grand‑père avait voyagé. Ainsi, j’ai voulu vérifier si cela correspondait aux voyages de L’Armand-Béhic des Messageries Maritimes qui assurait depuis Marseille toutes les lignes de transport par la Méditerranée vers l’Orient, l’Extrême Orient, la Chine, l’Australie et la Nouvelle Calédonie qui était française. J’ai dû consulter les archives de cette compagnie, les vieux registres des vieux bateaux, faire des regroupements pour savoir s’il avait pu voyager à bord de ce bateau ou d’un autre. C’était un gros travail qui a demandé beaucoup de temps, tout comme celui de consulter ensuite les archives du Ministère des affaires étrangères pour retrouver toute la correspondance – la seule que nous possédions, du reste – entre le consul Levet et le ministère. J’aime beaucoup ce genre d’enquêtes, un travail presque policier à la recherche non pas d’un assassin mais d’un suspect ou d’un homme qu’on reconnaît et dont on essaie de retrouver toutes les bribes pour saisir des éclats de sa vie de manière tout à fait dispersée. Toutes ces recherches, m’ont donné de Levet une image parfaitement contradictoire, je m’en doutais, entre le diplomate, le voyageur, l’homme de la bohème montmartroise, l’homme qui passait ses vacances à Montbrison dans le giron familial, tout en prétendant, par ailleurs, devant d’autres de ses amis, qu’il n’avait rien à voir avec sa famille, qu’il la détestait, ce qui était faux. Il y avait donc toutes ces images contradictoires de Levet et toutes ces zones d’ombre aussi sur ses mœurs. Cet homme qui était grand, maigre, d’un physique sans doute ingrat, qui se jugeait lui‑même assez laid et disgracieux, cet homme à qui on n’a connu aucune liaison sentimentale, semblerait, d’après des témoignages ambigus, avoir eu des tendances plutôt pédophiliques ; qu’il aurait aimé les jeunes garçons. Mais il faut avancer avec prudence, je n’ai pu que recouper des intuitions sans avoir des certitudes.
Et les photos du poète diplomate ?
Comme je viens de vous le dire, toutes les enquêtes que j’ai menées sur Levet me donnaient des images très contradictoires de lui. Il y avait des documents sur sa carrière de consul, d’autres sur sa vie de bohème. Chercher non seulement des témoignages mais aussi des images, des photos de Levet m’était indispensable. Il y avait une photo disponible de lui, celle qui avait dû être commandée par les parents du poète, juste avant qu’il s’embarque comme consul en Extrême Orient. C’est une photo extrêmement composée, extrêmement officielle, probablement retouchée, je pense, qui le représentait en costume de consul de France. C’est une image intéressante qui le montre de manière très compassée, très officielle, représentative et rassurante pour les parents, celle du bon fils qui a réussi, dans un bel uniforme, avec des broderies sur ses manches et son col, tout cela était parfait. Évidemment, cette photo ne pouvait donner qu’une représentation très fragmentaire de Levet.Tous les autres témoignages sur le poète, avec les souvenirs de ses amis de la bohème montmartroise, nous proposent un autre Levet. Il me fallait donc tenter de mettre la main sur d’autres images ou d’autres photos. Mission impossible, hélas ! En revanche, j’avais trouvé un témoignage de Maurice Constantin‑Weyer, ami de Levet, qui expliquait qu’un jour il avait rencontré Levet dans l’atelier d’un peintre très jeune à l’époque mais qui allait devenir illustre et qui s’appelait Jacques Villon, le frère aîné de Marcel Duchamp. Jacques Villon, comme beaucoup d’autres, pour gagner sa vie, faisait aussi des affiches. Constantin‑Weyer raconte que Levet avait posé pour une affiche que Villon faisait pour un cabaret. Il le décrit comme un grand type habillé n’importe comment, adossé à un bar reconstitué dans l’atelier, et il donnait le nom du cabaret comme étant celui des Noctambules. Je me renseigne auprès des spécialistes de Jacques Villon et auprès d’un de mes confrères de l’Académie, Jean Clair, grand spécialiste de Marcel Duchamp, mais je ne retrouve aucune trace de cette affiche. J’étais désespéré, mais, dans mes enquêtes, un jour, je vais à Vichy, la ville natale de Valery Larbaud qui a tant fait pour faire connaître Levet, même s’il ne l’a jamais rencontré mais qui avait lu les articles publiés dans les journaux. À la médiathèque de la ville, qui porte son nom, je demande à la responsable des fonds Larbaud si par hasard elle n’avait pas entendu parler d’une affiche de Villon qui représente Levet. Elle m’invite à la suivre dans un recoin de cette médiathèque où avait été reconstitué le bureau de Larbaud, avec ses objets familiers, certains livres de sa bibliothèque. Sur le mur d’en face, il y a l’affiche. Simplement je ne l’avais pas trouvée parce que le témoin s’était trompé sur le nom du cabaret en question qui n’était pas Les Noctambules mais Le Grillon. Selon la responsable des fonds Larbaud, celui‑ci avait une telle admiration pour Levet qu’il avait fait l’acquisition de cette affiche dès sa publication, il l’avait fait encadrer, il l’avait accroché au mur pratiquement en face de lui. Cette affiche ne l’a jamais quitté. Autrement dit, toute la carrière littéraire de Larbaud, tout ce qu’il a écrit l’a été en face de l’affiche qui représentait Levet. On y découvre un Levet qui s’habille un peu en clown, avec des tenues extravagantes, très dandy anglais et très bohème. On raconte que souvent il se faisait teindre les cheveux à la couleur de ses chaussettes, vert, orange. Il avait un côté punk avant l’époque punk. Tout cela correspond parfaitement avec les témoignages sur lui.
J’ai aussi retrouvé quelques caricatures assez amusantes de Levet dans des journaux, avec ses casquettes invraisemblables. Cette recherche, on peut dire, ne concerne pas seulement les témoignages écrits, mais aussi une recherche visuelle de cet homme si malheureux, comme tous ces gens qui ont dû souffrir de ce qu’ils pensaient être leur laideur. Quand on se juge laid comme ça, soit on se cache, soit, au contraire, par provocation, on en rajoute pour attirer l’attention sur soi, on s’habille comme un clown ou un zigoto. C’était un peu le cas de ce Levet malheureux mais qui devait en rire ou en ricaner plutôt que de chercher à raser les murs, à se faire oublier.
Je compare Levet à un autre de ses contemporains, un peu plus connu des lettrés, je ne parle pas du grand public, et qui s’appelait Jean de Tinan, né quatre jours après Levet mais qui était mort encore plus jeune que lui, à 24 ans, je crois, de faiblesse cardiaque. Jean de Tinan a été dans le même collège que Levet, ses parents qui étaient des provinciaux comme ceux de Levet se sont installés à un moment donné dans la même rue Cambon à Paris, Levet et Tinan ont fréquenté à peu près les mêmes lieux bohèmes, ont eu de nombreux amis communs, dont Léon‑Paul Fargue, en particulier, mais Tinan, qui écrivait de la prose et non pas de la poésie, était ambitieux, il voulait réussir, il avait noué des contacts avec des gens qui comptaient dans la vie littéraire de l’époque, aussi bien Stéphane Mallarmé que José Maria de Heredia, que tout le cercle qui gravitait autour de la revue Le Mercure de France. Il était proche de Willy, premier mari de Colette, signataire d’un nombre incalculable de livres qu’il faisait écrire par ses nègres, comme on disait autrefois. Tinan était donc un homme ambitieux qui s’est fait vite connaître de ses contemporains. Colette se souvient de ce très beau jeune‑homme qui avait su séduire par exemple, la célèbre, fort libre et séduisante Marie de Regnier, la fille de Heredia et la maîtresse de Pierre Louys.
Voilà donc Tinan et Levet, deux contemporains, que tout rassemble, un amour fou de la littérature dans les deux cas. Mais l’un est beau, veut réussir, réussit partiellement et meurt très jeune, et l’autre, écrivant ses poèmes et vivant d’une manière brûlante pour la littérature et pour la poésie, n’a – pour des raisons que je n’arrive pas bien à comprendre – aucune ambition, ne cherche pas à jouer des coudes, si je puis dire, pour connaître des gens influents, comme si il y avait un côté déjà suicidaire ou découragé chez lui. Il publie, certes, quelques poèmes dans des revues, mais ses amis les plus proches comme Léon‑Paul Fargue – et c’est ça qui est le plus déchirant dans le cas de Henry J.‑M. Levet –, ses amis ne soupçonnent pas une seconde la valeur réelle de sa poésie. Ils le considèrent comme un ami charmant, délicieux, fantasque, fidèle, tendre, malicieux qui accompagne leur jeunesse mais, au fond d’eux‑mêmes, ils ne le prennent pas au sérieux. Découragé, Levet va écrire pour finir ses fameuses dix Cartes postales qui vont lui assurer, auprès de quelque centaine de gens, de génération en génération depuis un siècle une forme de postérité. Mais il ne le soupçonne pas une seconde. Il renonce aussitôt après à la poésie, à sa vie de bohème, à tout ce qui lui tient vraiment à cœur et accepte finalement, comme on dit, de se ranger, de redevenir le bon fils qu’il n’avait d’une certaine manière jamais été et de faire une carrière consulaire pour plaire à ses parents. Cette carrière consulaire va d’ailleurs accélérer sa disparition puisqu’il part à Manille dans un climat abominable, déconseillé pour tous les gens qui souffrent de tuberculose, cette maladie qui l’aurait de toute façon emporté. Le climat humide, chaud, malsain de Manille n’a fait qu’accélérer les choses.
Il y a ensuite les voyages de Levet (vrais ou imaginaires ?) – occasion d’évoquer le fameux Express de Bénarès qui donne le titre de votre livre.
C’est une question intéressante car elle touche au cœur d’un des mystères de Levet. Levet est un homme qui rêve sans cesse, qui rêve de grands voyages, d’exotisme. Tous ses amis se souviennent de sa chambre dont les murs étaient couverts de cartes. Avait‑il en réalité envie de voyager, je n’en sais rien. Ce qui est sûr, c’est qu’en 1897 il a envie de partir, peut‑être qu’il ronge son frein à Montmartre, peut‑être que les premiers poèmes qu’il a écrits ne lui plaisent pas, qu’il a envie de s’ouvrir sur des mondes lointains. On ne sait rien de tout ça. Il prétend auprès de ses parents qu’il veut faire une mission d’enquête au Cambodge sur les origines hindoues de l’art khmer. Il s’agit évidemment d’une recherche totalement fantaisiste qui ne repose sur rien, il n’a jamais fait d’études, il n’a même pas son bac, il ne connaît rien à l’art khmer, à fortiori à l’art hindou. C’est vraiment un prétexte pour arracher par les relations de son père une sorte de bourse d’études pour partir là‑bas, pour qu’on lui paye son voyage et quelques mois de séjour. Il arrive à convaincre son père et son père, le député, arrive par piston à lui décrocher cette bourse d’études. Il doit donc s’embarquer. Et voici que tout devient mystérieux parce que on a des témoignages de ses amis qui montrent que, dès lors qu’il a en poche son billet des Messageries Maritimes pour partir en Orient, il semble décomposé, il n’a plus du tout envie de partir. Francis Jourdain va l’accompagner à la gare de Lyon, il le voit pratiquement en pleurs, il n’a aucune envie de partir et il disparaît. Pendant les six premiers mois de l’année 1898, il n’est pas là et ses amis pensent qu’il est vraiment parti en Orient. Mais où ? D’abord, est‑il parti, oui ou non ? Moi, je pense qu’il est parti, mais, d’après tout ce que l’on peut savoir, il y a quand même un doute, il faut bien le reconnaître. De toute façon, s’il est parti, il n’a jamais mis les pieds au Cambodge, il a été uniquement aux Indes et quelques poèmes de lui, par regroupement, parlent d’un bateau qu’il nomme et qui le ramène de Bombay et, selon mes recherches, ce bateau a bien pu l’embarquer. Donc, je pense qu’il est allé aux Indes. Qu’est‑ce qu’il a fait aux Indes ? On n’en sait rien. Encore une fois, toutes les lettres de Levet ont disparu, des lettres qu’il avait reçues mais aussi des lettres qu’il avait envoyées, ceux à qui il écrivait, comme Fargue, comme Francis Jourdain, pour prendre ces deux exemples les plus évidents. Aucune correspondance n’a été gardée, elles ont toutes été dispersées, toutes perdues, on n’en sait rien. Mais il y a une chose qui est intéressante, c’est qu’au retour des Indes il en parle à ses amis qui sont assez frappés comme quelqu’un qui n’aurait jamais dépassé Fontainebleau : ce sont des lieux communs qu’il aurait pu glaner n’importe où, rien de très vivant, aucune « chose vue » indiscutable. Mieux encore, quand il revient des Indes, il est tout heureux de retrouver ses amis de la bohème montmartroise auxquels il raconte qu’il écrit un livre, un grand roman qui s’appelle L’Express de Bénarès. Quand ils lui rendent visite à Montmartre, il habite Rue Lepic à ce moment‑là, ses amis voient chez‑lui, épinglés aux murs de sa chambre, des petits bristols avec des noms de personnages, avec quelques lignes qui résument l’action de ces personnages, comme des aide‑mémoires pour un grand roman avec une foule de caractères, une foule de héros. Il montre également à ses amis une grosse liasse de son roman en chantier. Il leur en lit des passages. Il y a même des échos dans la presse qui parle du livre de Levet. Très bien, sauf que personne n’a pris réellement connaissance de l’existence du manuscrit ; est‑ce qu’il a vraiment été écrit, on n’en sait rien ; est‑ce que Levet l’a rêvé, est‑ce qu’il faisait semblant de l’écrire mais qu’il n’arrivait pas à l’écrire, on n’en sait rien. En tout cas, ce qui est certain, c’est que, s’il y avait un manuscrit ou des fragments de manuscrit, tout a disparu. À la mort du poète, ses parents ont tout détruit pour des raisons multiples, ils ne croyaient pas du tout au sérieux de la vie littéraire de leur fils, peut‑être y avait‑il des pages assez choquantes d’après ce que l’on croit savoir dans ce que, en tout cas, racontait Levet de son roman, des histoires de sodomie, de perversion, d’aventures folles. Une chose est sûre : ce livre, écrit ou non‑écrit, va obséder pendant des années et des années tous les amis de Levet et même ceux qui ne l’ont pas connu. Même dans les années ’20, un écrivain comme Paul Morand qui allait faire comme Levet une carrière diplomatique, plus brillante évidemment que celui‑ci, se demande s’il demeure une chance de retrouver L’Express de Bénarès, ce livre qui n’existe pas. C’est pour cette raison que j’ai appelé mon livre, un peu malicieusement, L’Express de Bénarès, parce que ce titre est à la mesure de ce que l’on ne sait pas de Levet. Voilà, L’Express de Bénarès, le secret, le mystère, le concentré de toutes les énigmes qui rôdent autour de cet écrivain.
Je reviens un instant aux voyages imaginaires, aux dix poèmes qui au fond marquent vraiment la singularité, l’originalité de la petite musique de Levet, et qui s’appellent Cartes postales. Il s’agit de vignettes poétiques envoyées de tous les coins du monde, de l’Argentine avec La Plata, à bord de l’Armand‑Béhic, de Nagasaki, de Brazzaville, des Antilles, au large de Port Saïd, etc. Ces cartes postales sont des preuves merveilleuses d’exotisme, de malice, de fascination romanesque, de changement de rythme, ce sont vraiment des poèmes que tous les gens qui les ont lus ne peuvent pas oublier. Ces poèmes sont envoyés, encore une fois, de lieux où il n’a le plus souvent jamais mis les pieds. Les vrais voyages sont des voyages imaginaires, sont des voyages en littérature. Levet, l’homme malheureux, l’homme disgracié, l’homme complexé, aux amours peut‑être interdites ou inavouables, Levet rêve des voyages inaccomplis et écrit ces cartes postales comme une sorte de consolation.
Que peut‑on dire de la fin de sa vie ?
Nous avons déjà évoqué ce sujet de la fin de sa vie qui est extrêmement mélancolique puisque c’est la fin de vie d’un homme qui renonce à la poésie par découragement, sans doute. Personne ne lui a tendu la main, personne ne l’a pris au sérieux comme poète. Seul Valery Larbaud, l’ami de Fargue, a compris leur valeur mais Larbaud n’a jamais rencontré Levet. Les poésies de Barnabooth écrites par Larbaud, par la suite, doivent beaucoup à Levet, il n’en a jamais fait mystère. C’est seulement après sa mort que leur influence se fera sentir. Je pense qu’un Paul Morand lui doit beaucoup dans ses premiers poèmes. Il me semble retrouver son influence chez des poètes comme Paul‑Jean Toulet, Blaise Cendrars, plus tard aussi Louis Brauquier. Dès la première publication de ses œuvres en 1921 chez Adrienne Monnier, rue de l’Odéon, il va être lu par une centaine de lecteurs, d’admirateurs, de générations en générations…
En quoi votre livre – que vous définissez comme un « accusé de réception […] un signe de gratitude » – se reflète‑il dans l’œuvre de ce poète et de cet homme au destin si particulier ?
En dehors de ce que nous venons d’évoquer, ce qui m’a intéressé ce sont deux choses qui sont en parfaite cohérence avec mon livre. C’est d’abord la manière dont, en faisant une enquête sur un poète, je suis amené à parler de moi et me mettre un peu à nu, donc une forme encore une fois d’autobiographie déguisée par allusion en expliquant les raisons de ma fascination et tous les échos personnels, familiaux, intellectuels et affectifs que j’éprouve pour Levet. En lisant ses poésies, je cherche en même temps à comprendre pourquoi cette poésie m’a marqué. Il y a un effet de miroir, quelque chose de très intime dans les rêveries que m’ont inspirées les œuvres de Levet, ce goût de l’imaginaire, de l’exotique, ce côté un peu malheureux et romanesque, quelque chose qui éveille des échos profonds en moi, que j’essaie d’expliquer. Mais bon, ce sera au lecteur de découvrir tout cela à l’intérieur de mon livre, s’il le souhaite !
Nous avons déjà parlé ensemble de la singularité de cette démarche littéraire qui mélange enquête et autobiographie. J’ai essayé de l’approfondir dans ce nouveau livre. D’ailleurs, il me semble que c’est un genre littéraire qui n’a pas vraiment d’équivalent, c’était empirique, c’est arrivé comme ça.
L’Express de Bénarès est le livre qui reprend tous les thèmes de votre écriture : écrire pour se cacher, décrire des êtres touchés par la grandeur des êtres de fiction, s’isoler dans les frontières insulaires pour échapper à la cacophonie du monde, donner de son temps, de sa vie même pour l’écriture, etc. J’ose dire que ce livre est le plus personnel de tous. Êtes‑vous d’accord avec cette affirmation ?
Oui, exactement, parce que le thème de la solitude est aussi le thème de l’insularité, etc. J’ai souvent remarqué que, pour un écrivain qui a une certaine exigence, quel que soit le point de départ, s’il est sincère, il reviendra toujours vers lui, comme une bille qui tourne dans un entonnoir et qui revient au centre de soi‑même. Je crois très profondément à cela. Il peut partir sur n’importe quel sujet. En ce qui me concerne, je ne parle que des sujets qui m’obsèdent. Les critiques que mon livre a suscitées sont bienveillantes, très chaleureuses. Leurs auteurs, que je comprends parfaitement, n’ont pas tort, ils se concentrent sur ce poète, ils racontent sa vie, et négligent, parce que cela leur semble peut-être moins intéressant, cet aspect autobiographique qui est pour moi essentiel et secret. Et pourtant c’est sans doute cela qui me tient le plus à cœur.
Propos recueillis par Dan BURCEA (février 2018)
Frédéric Vitoux de l’Académie française, L’Express de Bénarès, Éditions Fayard, 280 p., 19,00 euros.

