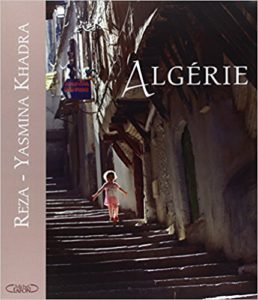«Je veux te faire découvrir mon pays…» C’est avec cette invitation que l’écrivain Yasmina Khadra nous ouvre la porte de ce livre unique dont le titre renferme trois syllabes chères à son cœur «Algérie». Livre publié en 2012 par les Éditions Michel Lafon pour fêter le cinquantenaire de l’indépendance de ce pays, et dont l’élégante beauté est due à l’écriture unique de Yasmina Khadra et à l’art photographique de Reza Deghati, maître incontesté, capable de métamorphoser le regard en frémissement de l’âme et la lumière en poussière de rêve. C’est lui qui déclarait il n’y a pas longtemps qu’«une bonne photographie se prend avec le cœur».
Cher Yasmina Khadra, je vous remercie d’avoir accepté ce dialogue au sujet du livre Algérie, livre qui impressionne doublement, à la fois par la qualité des textes et par celle des images. Comment vous est-elle venue l’idée d’un tel ouvrage ? Et pourquoi la collaboration avec le photographe Reza ?
C’est l’éditeur parisien qui a eu l’idée de consacrer un beau-livre à l’Algérie. Il m’a proposé, comme photographe, Reza. J’ai tout de suite accepté. Reza est une légende itinérante. Il voyage à travers le monde, son appareil en bandoulière. J’aime son regard, sa façon d’immortaliser une impression, une silhouette, une fulgurance. Reza est un humaniste éclairé. Un sage. Dès notre première rencontre, nous avions fusionné. J’aime l’humilité des grands artistes. Pour moi, c’est de la poésie à l’état pur. Ça a été un honneur et un privilège pour moi de travailler avec lui.
Raconter son pays c’est aussi se raconter soi-même, car qui pourrait s’imaginer un seul instant vivre définitivement coupé de son sol natal sans prendre le risque de se mentir à soi-même et de trahir les siens? Parmi ces êtres incontournables, il y a votre père, ce héros absent pour l’enfant que vous étiez: « […] mon père me manquait. Du jour au lendemain, je n’entendais plus sa voix dans la maison et n’entrevoyais plus sa silhouette parmi les ombres dans la rue ».
La patrie est indissociable de la famille. Elle est l’expansion de notre amour filial. Il me suffit de croiser un Algérien n’importe où, au Japon ou bien au Brésil, pour qu’il me restitue l’ensemble de mes repères. Mon père est un acteur privilégié. Il a beau me manquer, il est omniprésent dans mon esprit. Un peu comme l’Algérie. Elle ne me quitte pas d’une semelle. J’ignore à quoi ressemble l’amour que l’on a pour son pays, et ce n’est pas nécessaire de le savoir. Il suffit de le vivre. L’Algérie est une émotion impérissable. Elle est à la fois rêve et délire, espoir et crainte, prière et remords. Son drame m’afflige, sa survivance me ressuscite. Le rapport que j’ai à mon pays dépasse de très loin le cadre du raisonnable. Je suis dans une fébrilité constante, comme un drogué en manque qui se cherche au milieu de ses propres hallucinations.
En lien direct avec la figure paternelle, il y a une longue période de votre vie passée dans l’armée où vous êtes devenu tout simplement « matricule 129 ». Qu’avez-vous gardé de toute cette période ?
Je garde mes amis. Les meilleurs amis du monde. Nous sommes restés très liés, très proches les uns des autres. Certes, la vie n’était pas commode à cette époque. Des enfants de neuf ans enfermés dans une caserne et livrés aux bons soins de caporaux bornés et violents, c’est d’un tel gâchis ! Mais il faut savoir extraire de l’or à partir de la boue, être un alchimiste génial pour supplanter les mauvais souvenirs et recouvrer une part de ses rêves. J’ai beaucoup souffert, mais les épreuves ont forgé mes convictions. S’il m’arrive encore de tenir debout, c’est parce qu’enfant je n’ai pas appris à me mettre à genoux.
Il y a ensuite la rencontre fondatrice pour l’écrivain que vous serez par la suite avec la langue française et avec vos écrivains préférés, dont Albert Camus occupe une place de prédilection et auquel vous ne cessez de rendre hommage. Est-il possible de nous dire en quelques mots ce que vous lie à l’auteur de l’Etranger ?
Je n’ai pas aimé l’Etranger de Camus, j’ai aimé le talent de Camus. Ce roman a été un choc et une révélation pour moi. C’est en finissant de le lire que j’ai choisi de devenir romancier en langue française alors que j’ambitionnais de devenir poète en arabe. Camus était un être écorché, mais aussi un écorcheur impitoyable. Il est centré sur sa personne au point où il ne voyait les choses que selon sa convenance. Son Algérie était aux antipodes de l’Algérie des Algériens, pied-noir et autochtones. Mais son écriture était si belle qu’on pardonnait le reste. Pour moi, Camus demeure une vision opiacée de mon pays. Une vision magnifiée et improbable à la fois, un voyage à travers mille interrogations auxquelles j’essaye de répondre dans mes romans. Je salue en commun son art littéraire. Ce qu’il fut ne m’intéresse pas. On ne demande pas à un écrivain d’être un saint, on attend de lui du talent, et rien d’autre.
Faisons à vos côtés les premiers pas dans ce périple où chaque ville offre en cadeau son visage, un plus beau que l’autre, si l’on en croit le guide que vous êtes. Car ce n’est pas des choses inertes que vous évoquez, mais des villes vivantes, coquettes, aguichantes… C’est l’exemple de la ville d’Alger, pour commencer, ville que vous appelez « Alger la Blanche », à cause de sa générosité. Qu’a-t-elle de si beau, cette ville « pudique » et « philosophe », comme vous la nommez ?
Alger est paradoxale. Elle est capable d’ensorceler et de traumatiser en même temps. Je crois qu’elle n’a pas réussi à digérer l’affront que ses enfants lui ont fait durant la guerre terroriste. Elle, qui pensait avoir triomphé des mauvaises passes sous le joug colonial, elle se surprend à douter d’elle-même une fois rendue à sa liberté. Ce qui chahute les chants d’Alger est le silence de ses poètes disparus. Alger puisait sa magie dans le génie de ses artisans, la générosité de ses femmes, l’humilité de ses érudits. Aujourd’hui, les chants ne racontent plus que le désarroi et le chagrin, la contestation et le déni de soi. Alger ne se reconnaît pas dans le malheur, mais dans la force de le surmonter. Or, le malheur perdure dans les rues et les esprits, et Alger ne sait plus se faire belle devant le miroir, elle lui tourne le dos.
Que dire de la ville d’Oran, ville où vous avez grandi. Albert Camus, dites-vous, la considérait « circulaire » ? Selon vous, la ville n’a rien de circulaire, elle « s’épuise sous le vertige du large ». Et vous rajoutez, en empruntant sa voix : « Je suis une cité sans ambition, mes saints patrons me suffisent. Ces derniers n’étant plus là, je me contente de leurs fantômes ». En fait, vous dressez un portrait assez nostalgique de cette ville qui a perdu l’éclat de son passé. Un passé fait de mélange de cultures et de communion d’esprits, une ville « magique comme mes musiques ». D’où vient cette nostalgie dans l’évocation que vous faites de cette ville déchue de sa splendeur ?
La nostalgie est une escale dans ce qui n’est plus. Elle est triste parfois parce qu’elle nous renvoie à ce qui a bercé notre âme et qui a disparu, nous livrant à des lendemains incertains. Oran fut terriblement séduisante à une époque. Une ville jouissive, festive, heureuse et insoucieuse. Une fille dévergondée aussi, un peu farfelue, qui savait que les belles années de la jeunesse sont les seules consolations d’une vie finissante. Aujourd’hui, Oran redoute chaque matin comme un sortilège. Elle n’a pas confiance et elle ne rêve plus. Ses beaux quartiers se sont délabrés, et la drague, qui donnait de l’entrain aux zazous pommadés, s’est enrobée d’agressivité. On ne sait plus regarder passer une jolie fille dans la rue, on la persécute. Et Oran a horreur des mufleries. C’est la raison pour laquelle elle se laisse aller, elle se néglige et se meurt car on ne sait plus faire la cour aux demoiselles.
Si la mer exerce moins sa fascination pour les espaces infinis, il y a dans la description que vous faites de l’Algérie une autre dimension capable de cette représentation : le désert. Parlant de Tamanrasset, le pays des Touaregs, vous décrivez un pays « plus vaste que l’Univers », qui « se soustrait aux désordres de la terre ». Mais, même dans ce territoire longtemps vierge, vous déplorez aujourd’hui les traces laissées par la folie des hommes.
Comme sur une plage, les traces de pas que l’on laisse sur le sable s’effacent au passage des vagues. Le désert a ses tempêtes pour se laver des traces de l’Homme. Il est un monde intérieur qui s’auto suffit. La folie des hommes l’amuse. Le désert nous plaint. Il nous méprise. Il ne nous aime pas. C’est nous qui essayons de le magnifier pour mériter un soupçon de son estime. Mais si vous êtes un être bienveillant, un chercheur de lumière et de sagesse, le désert vous offre la possibilité d’aller au bout de votre quête. Il vous devient une école et vous permet d’accéder à une certaine maturité. Cependant, si vous le foulez en conquérant, il saura vous prouvez combien vous êtes insignifiant, misérable et stupide. Le désert est une formidable leçon de vie, un regard sans concession sur notre infinitésimale vanité.
Vous ne cessez, tout au long de ce livre, de rendre hommage aux Algériens : « Chez nous, ce ne sont pas les sites qui importent, mais le gens qui gravitent autour. Un clin d’œil, un pouce dressé, un petit salut de la main, et tous les démons sont conjurés ». C’est donc un hymne en hommage à ces hommes et à ces femmes que vous écrivez que ce soit pour ceux qui vivent à Alger, au Nord-Ouest, en Kabylie ou dans le Grand Sud du désert. De ce point de vue humain et personnel, ce livre est-il un cadeau réussi dont la vocation principale est sa capacité de conjurer les démons encore présents dans l’histoire qui les lie au passé?
Ce livre est une invitation au voyage avant d’être un hommage aux Algériens. Tout peuple a ses vieux démons. Cela ne fait pas de lui un démon. Bien au contraire, c’est dans l’adversité que l’on accède à son humanité. L’Algérie est une rédemption possible. Beaucoup d’étrangers, d’aventuriers, de transitaires ont reconnu que mon pays a changé leur mentalité, qu’ils ont le sentiment d’avoir bonifié auprès des Algériens. Nous sommes un peuple fraternel, xénophile et nous aimons rendre service et être agréables avec ceux qui ont la gentillesse de nous rendre visite. Sautez dans un avion et débarquez dans n’importe quelle ville algérienne. A peine arrivé, et vous êtes chez vous ; mieux, vous êtes heureux.
Propos recueillis par Dan Burcea (29/03/2014)
Yasmina Khadra, Reza Deghati, Algérie, Michel Lafon, sept. 2012, 208 pages, 29,95 €