
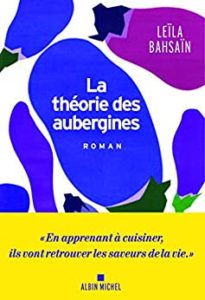 « La théorie des aubergines » est le nouveau roman de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Bahsaïn. Se retrouvant au chômage, Dija Ben, ancienne rédactrice dans une agence de communication est chargée de noter et de rendre compte sous forme littéraire de l’aventure d’un groupe de « marginaux, des cabossés de la vie » sur le chemin de l’insertion dans le monde du travail. Dès lors, une aventure bien particulière attend ceux qui y participent, des personnages bien dessinés prenant place dans un tableau dont le réalisme révèle une fragilité remplie d’humanisme.
« La théorie des aubergines » est le nouveau roman de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Bahsaïn. Se retrouvant au chômage, Dija Ben, ancienne rédactrice dans une agence de communication est chargée de noter et de rendre compte sous forme littéraire de l’aventure d’un groupe de « marginaux, des cabossés de la vie » sur le chemin de l’insertion dans le monde du travail. Dès lors, une aventure bien particulière attend ceux qui y participent, des personnages bien dessinés prenant place dans un tableau dont le réalisme révèle une fragilité remplie d’humanisme.
Bonjour Leïla Bahsaïn, le titre de votre nouveau roman incite à l’interrogation avant même de l’ouvrir. Que font ces fameuses aubergines dans un livre et en plus dans une théorie bien particulière ?
Pour éviter de priver les lecteurs du plaisir de la découverte de cette théorie, je vais user de chicanes pour vous répondre. L’inventeur de cette théorie est le Chef Achour, qui dans une cuisine d’insertion, est chargé d’encadrer une assemblée de « cabossées » de la vie, en leur apprenant à cuisiner. C’est Dija, chargée de communiquer sur cet atelier qui va donner un nom à ce code de conduite très concret et plein de bon sens. Elle la baptise ainsi dans le passage le plus poétique du livre. Ce titre recèle aussi la stratégie qui sous-tend l’écriture de ce roman que j’ai construit avec l’idée d’un trompe-l’œil : « venez, on va passer un moment chaleureux dans cette cuisine, mais on va aussi mettre les pieds dans le plat… ». Un lieu où il se passe plus qu’il n’y paraît en surface.
Entretenez-vous un lien particulier avec l’art culinaire ? Y a-t-il chez-vous, comme chez votre narratrice, un lien organique et culturel avec ce domaine ?
J’aurai pu réunir mes personnages dans un atelier de couture ou une brocante mais la cuisine m’a semblé un prétexte à la hauteur de la magnanimité que je voulais mettre à l’honneur dans ce livre. D’autant plus qu’il me fallait adoucir la brutalité des histoires de vie de ces âmes brisées. Dans une cuisine, on nourrit l’autre, et on se nourrit de lui. Mes personnages ont, à un moment donné de leur parcours, perdu le sens. Et il existe évidement une double acception de ce mot.
Personnellement, j’entretiens un lien fort avec les deux facettes de cette histoire ; celle de l’insertion où j’ai travaillé ; et celle de l’art culinaire qui tient une place importante dans ma vie. Ma grand-mère était une cuisinière et mon père a travaillé toute sa vie dans la restauration d’hôtellerie au Maroc. La cuisine est un langage. C’est peut-être pour cela qu’elle a toujours inspiré les écrivains, Colette, Alexandre Dumas, Proust…. Ma narratrice, Dija, dit que « la cuisine est semblable à l’écriture, elle est capable de majorer l’existence et d’exhumer les scènes, les sensations des jours évadés ». Écrire c’est cuisiner la langue.
Et vos personnages, ces cas sociaux, des « cassos » dans le jargon cruel de l’administration, qui sont-ils ?
Mes personnages, y compris les encadrants du projet d’insertion, ceux en apparence « intégrés socialement » portent des fêlures qui s’expriment aussi dans leur rapport au travail. Ils ont été déclassés, ils ont subi des violences qui bien qu’elles soient différentes selon le profil et le vécu de chacun, les ont fragilisés. Si ce projet est censé leur apprendre un nouveau métier pour vite les remettre dans la course du marché de l’emploi, il va finalement les aider à se reconstruire. Le Chef de cette brigade a une éthique bien particulière et une conception de l’altérité qui vont s’avérer salutaires. Car il y a des contraintes professionnelles plus acceptables et plus engageantes que d’autres. Ils découvrent une nouvelle façon de vivre le travail, plus modeste, mais solidaire et plus saine dans ses objectifs.
Mais si on regarde plus attentivement, le but de votre démarche littéraire dépasse cette « mise en pâture de la vie des gens », pour réussir à « redorer le blason des exclus, leur faire retrouver leur bonheur perdu ». Que pouvez-vous nous dire sur cette double motivation de l’écriture de votre roman ?
Dans le livre, c’est un grand patron qui est à l’origine de ce projet d’insertion. Son ambition est de profiter de ces chômeurs qu’il méprise pour redorer son blason et se faire passer pour un entrepreneur qui a du cœur. C’est une philanthropie viciée. Malgré cela, l’atelier de cuisine fonctionne car ceux qui y sont engagés, qui le font vivre, sont sincères et impliqués. Ils prendront le contrepied des fins de communication mercantiles espérées.
Le mépris est au cœur de la thématique de ce roman. Qu’il s’agisse d’un mépris de race, d’un mépris de classe ou d’âge, tous les mépris fonctionnent de la même manière, ils mésestiment l’autre, le rabaissent puis le disqualifient. Je parle en connaissance de cause. Le roman puise son origine dans mon expérience de travail comme conseillère en insertion. J’accompagnais des personnes qui traversaient des difficultés. Parfois, le regard des autres, au lieu de les aider, les enfonçait, alors même que dans le creux de leurs failles filtrait parfois une grandeur humaine. Ce roman est ma façon de faire un pied de nez à tous les mépris.
Votre narratrice fait partie du lot des victimes de ce système. D’abord, elle se voit écorcher son patronyme, pour être ensuite qualifiée de has been et subir « le marasme » de son licenciement. Parlez-nous de Khadija Ben-Adbelhilalilakbir devenue Dija Ben. A-t-elle emprunté quelques petits traits de celle qui lui a donné vie dans ce roman ?
En effet ! Comme ceux qu’elle accompagne et qui sont étiquetés « cassos », Dija, porte son lot de fêlures. Même si elle avait le statut de cadre, qu’elle est bien intégrée d’après les standards administratifs et sociaux, elle porte en elle les failles de ce qu’on appelle le mépris de race. Les exclus du marché du travail et de la société, ont aussi une démarche d’« intégration » à faire, et qui se rapproche de ce qu’elle a connu pour trouver sa place dans la société française.
Dija emprunte certains de mes traits mais contrairement à elle, mon nom est resté intact. Je n’ai pas eu à subir cette violence. J’en ai rencontré d’autres que je fais vivre parfois à d’autres personnages. Comme Johnny-Bryan, j’ai par exemple travaillé comme commerciale dans les carburants, un travail qui consistait à vérifier les cours du pétrole, acheter au plus bas et vendre au plus fort. Et comme lui, j’ai rendu mon tablier au bout de cinq jours.
Il est vrai qu’en face, tel que vous le décrivez, le monde du travail, de l’efficacité et des conventions, des gens « mindés différemment » fait peur. Dija Ben et tous vos autres personnages peuvent en témoigner.
Je n’ai fait que restituer à travers la fiction ce dont j’ai été témoin. Le tout numérique, la paupérisation langagière, ont fait du tort à Dija. Ça lui a coûté son emploi de rédactrice et bien plus. Elle se sent inadaptée. L’orwellisation, la course effrénée à la performance, et la précarisation de l’emploi, montrent leurs limites. C‘est un secret de polichinelle. Le monde du travail peut générer de la souffrance. Le livre creuse aussi de nouvelles possibilités pour y remédier. Tout n’est pas noir, heureusement. Il y a des possibilités de se réinventer. Cette cuisine en est la démonstration.
À travers l’expérience de vie de Dija Ben entre le Maroc et la France, vous parlez d’une « culture tierce, ni d’ici ni de là-bas ». Pourquoi avoue-t-elle s’être réconciliée avec des opposés qui forment son « identité multiple » et que veut dire le triptyque « mon Maroc, ma France occidentale et ma France orientale » ? Que veut dire pour elle « Je suis les trois, et bien plus encore » ?
Ce n’est pas parce que des cultures sont différentes qu’elles vivent sous cloches et qu’elles ne s’influencent pas mutuellement. En l’occurrence, c’est le cas entre la France et le Maghreb. Ceux qui assignent une identité géographique ou religieuse à l’individu cherchent à le réduire. Dija l’a parfaitement compris. Elle ne veut être « ni corps ni religion ni race ». Elle veut être elle-même, un être dont le propre est de circuler, et se renouveler. On ne peut construire une identité sur un rejet, il faut accepter de cumuler et de modeler son identité à l’envi. C’est une libération quand Dija prend conscience de cela. L’identité est vivante. Elle ne peut être figée. Vouloir l’agréger pour mieux la manipuler conduit aux dérives qui font la Une de l’actualité.
Pour revenir à la formation culinaire que suivent les héros de votre roman, que veulent dire ces phrases prononcées par les Chef Achour et qui pourraient être inscrites sur le frontispice de sa Cuisine : « Cuisiner n’est pas cuisiner. Cuisiner est une entreprise de psychologie. Un altruisme courtois » ?
Le Chef Achour est un personnage à la verve percutante, il partage avec ses apprentis cuisiniers sa philosophie de vie. Un bon sens, une intelligence pleine de simplicité. Sa parole n’est pas pédante et chacun s’approprie ses aphorismes qui incitent à réfléchir. Il y a beaucoup de civisme dans l’acte de cuisiner. Il incarne cette éthique de la simplicité. Achour, donne une place à l’initiative personnelle dans cette cuisine. Il est ouvert aux propositions. Il a roulé sa bosse et a connu des échecs dont il s’est relevé désargenté mais plus humain et perspicace. Cette sagesse populaire est souvent méprisée au profit des « grandes théories ». C’est bien dommage.
Plus encore, le Chef Achour qui ne manque pas de comparaisons pittoresques, parle de la cuisine comme d’un exercice d’équilibriste sur une bicyclette. « La cuisine est un acte tacite », dit-il. Qu’espère-t-il apporter par ces formules à ses apprentis interloqués ?
Le langage a ses limites. Le but du Chef est la transmission. Il a raison d’attirer l’attention sur tout ce qui ne peut être verbalisé. Il y a des apprentissages implicites qu’on ne peut acquérir qu’en mettant la main à la pâte, à ses risques et périls quand il le faut. L’écriture littéraire tente aussi de restituer cette dimension ineffable. Faire dire aux mots davantage que leur sens apparent.
Pour votre narratrice, la cuisine est l’occasion rêvée de replonger dans ses souvenirs d’enfance. Les plats, les goûts et les rites de la table sont pour elle des marqueurs de ses origines. « Manger ainsi est un acte de civilisation », écrit-elle. Que signifie pour elle cette formule ?
Cette phrase, Dija la prononce quand on dénigre sa façon de manger un tagine marocain. Réagir ainsi devant les rites de la table d’autrui est le propre des xénophobes. C’est par la nourriture que ma narratrice se réconcilie avec une part d’elle-même. Les plats qu’elle confectionne, qu’elle partage et qu’elle déguste sont une manière de raviver le lien avec sa terre natale, sa mère. A chacun sa madeleine !
L’histoire que contient votre roman dépasse par sa force l’expérience d’un groupe, d’une catégorie sociale, et plonge par sa thématique dans l’espace intime de chaque personnage. Je dirais que le monde que vous décrivez est une plaidoirie pour une quête de sens de toute une humanité à la dérive. Comment interprétez-vous ces affirmations ?
Je confirme et me réjouis de ces affirmations. Elles me confortent dans ma stratégie narrative de départ. Oui, ce roman concerne une collectivité faite d’individualités secouées par les défaillances, les dysfonctionnements d’un système. « l’Homme de la mondialisation » m’intéresse par sa tendance à croire bonnement en l’époque et son omnipotence. Malgré l’adversité, l’histoire de ces « Gens dans la cuisine » est optimiste. Car l’optimisme n’est pas la naïveté. C’est être lucide sur la réalité et sa difficulté mais faire le choix d’un élan de vie constructif et résilient. Je trouve malheureux de considérer « les bons sentiments » comme un concept niais. Pour moi, l’optimisme est le dernier recours des perdants. Et la littérature, un triomphe pour les méprisés.
Propos recueillis par Dan Burcea
Crédits photo de l’auteure: Amandine Fénix
Leïla Bahsaïn, La théorie des aubergines, Éditions Albin Michel, 2021, 256 pages.

