
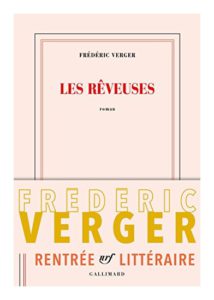 Après nous avoir fait traverser dans « Arden » (Goncourt du Premier roman) un territoire aux frontières du fantastique en compagnie des personnages étranges, pittoresques et inoubliables par leur folie et leur fragilité, Frédéric Verger nous propose dans « Les Rêveuses » des aventures encore plus invraisemblables, nous menant cette fois sur les rives tortueuses de la Moselle où Peter devenu Alexandre nous invite à partager son monde. Sujet inédit ou déclinaison du même thème autour de l’abandon de l’identité dans le rêve et la fantaisie face aux vicissitudes de l’Histoire ? Et que dire de son style condensé qui laisse entendre à peine une respiration tellement dense qu’elle tend vers un exercice presque impossible, à poumons remplis, où les mots doivent tout dire, tout consigner, seconde par seconde, ligne par ligne, dans une visible menace d’extinction qui guetterait la mémoire ? Frédéric Verger nous explique dans un bref échange qui sont ses personnages et pourquoi a-t-il choisi comme décor cet étrange pays de Bray aux frontières traversées par la Moselle.
Après nous avoir fait traverser dans « Arden » (Goncourt du Premier roman) un territoire aux frontières du fantastique en compagnie des personnages étranges, pittoresques et inoubliables par leur folie et leur fragilité, Frédéric Verger nous propose dans « Les Rêveuses » des aventures encore plus invraisemblables, nous menant cette fois sur les rives tortueuses de la Moselle où Peter devenu Alexandre nous invite à partager son monde. Sujet inédit ou déclinaison du même thème autour de l’abandon de l’identité dans le rêve et la fantaisie face aux vicissitudes de l’Histoire ? Et que dire de son style condensé qui laisse entendre à peine une respiration tellement dense qu’elle tend vers un exercice presque impossible, à poumons remplis, où les mots doivent tout dire, tout consigner, seconde par seconde, ligne par ligne, dans une visible menace d’extinction qui guetterait la mémoire ? Frédéric Verger nous explique dans un bref échange qui sont ses personnages et pourquoi a-t-il choisi comme décor cet étrange pays de Bray aux frontières traversées par la Moselle.
Pourquoi un tel sujet pour votre roman et pourquoi cette période de la Seconde guerre et le nord de la Lorraine comme décor ?
Une histoire, d’après moi, doit développer les conséquences tragiques, ironiques, mais toujours logiques d’une situation. Ainsi, si un homme a recours à la ruse d’un changement d’identité, cette ruse doit s’avérer être un piège. C’est cette première situation qui est à l’origine du roman. Si un Allemand se fait passer pour un Français afin d’échapper aux Allemands, il doit se retrouver prisonnier d’un endroit où les Français sont devenus Allemands.
Ce sont ces situations qui exigent la menace (donc la guerre) et l’emplacement en Lorraine annexée.
Où se trouve ce mystérieux pays de Bray avec « ses villages tristes et mornes, dont on distingue à peine, en traversant un brouillard où semble fumer la neige, les façades sales crépies de gris » ?
Le Pays de Bray est un pays imaginaire qui serait situé entre ceux de Sierck, Schengen et Perl. Imaginez la Moselle faisant un coude vers l’est après Sierck dans un pays assez escarpé, farouche et désert, avant de rejoindre son lit réel vers Mondorf. Voilà Bray.
Qui est ce Peter Siderman qui, pour échapper à la mort, prend, par usurpation, l’identité d’Alexandre d’Anderlange ?
Peter Siderman est un jeune allemand de dix-sept ans émigré à Paris et engagé en 1939 dans l’armée française, peut-être par antinazisme, peut-être par désir d’aventure, peut-être parce qu’il croit voir là un défi qu’il faut relever. Son père est juif, réfugié en Suisse, sa mère est morte et il a toujours mené une vie errante.
Que dire de Sofia Evseieva, noble russe déchue, avec sa datcha « traversée de faisceaux scintillants de poussière » ? Et ses filles, les sœurs Hélène et Joséphine ?
Sofia Evseieva est la belle-mère du mort dont il a pris l’identité. Elle le recueille peut-être par bonté, peut-être parce qu’elle a besoin de lui. Hélène et Joséphine sont les cousines du mort, des orphelines sans logis, sans ressources, qui pensent échapper à la misère en trouvant un riche mari. Leur fierté, leur sauvagerie rendent difficile ce projet raisonnable et bourgeois.
Que pouvez-vous nous dire en quelques mots de Victor Van Versterhagen, le « Commandant », ce nostalgique inconditionnel des paysages, des odeurs et des goûts d’antan ?
Le « Commandant », ainsi l’appellent Sofia et les deux cousines, est un vieil officier allemand qui est parvenu à se faire muter à Bray parce qu’il est à la recherche d’un paysage merveilleux au bord de la Moselle au sein duquel il a connu une sorte de moment rousseauiste d’extase près de cinquante ans auparavant. Ce paysage étant une propriété au milieu des vignes, il croit le retrouver en retrouvant le vin qu’il avait gouté. Il fréquente et aide Sofia car elle lui a dit qu’elle possédait une cave aux bouteilles innombrables. C’est par ailleurs un personnage sensuel, égoïste et corrompu.
Les rêveuses d’Ourthières, qui donnent le titre de votre roman, sont des religieuses dont on note les rêves qui sont ensuite cosignés dans des recueils. Qui est Blanche, la cousine énigmatique d’Alexandre et maîtresse dans l’interprétation de ces étranges rêves ?
Blanche est la troisième cousine du mort, sa préférée. Héritière d’une grande fortune, elle est entrée dans un couvent mais il semble qu’elle y soit retenue contre son gré par des gens qui veulent s’emparer de l’héritage.
Peter Siderman dit du journal d’Alexandre (dont il avait usurpé le nom) qu’il « lui semblait l’abrégé d’un roman qu’il aurait vécu », tellement ses deux identités se confondent. Où commence la fiction et où s’arrête le réel dans votre roman ? D’ailleurs, peut-on parler de réel dans votre construction romanesque tellement élaborée et surprenante ?
L’identité est une fiction. Les êtres humains ne peuvent vivre qu’en imaginant des fictions, qu’ils croient réelles la plupart du temps. La tâche du roman est de montrer la réalité de cet enchevêtrement de fictions à la fois sublime et ridicule.
La critique qualifie votre roman d’« énigmatique récit […], follement compliqué, aux longues pages descriptives à l’ancienne, fleurant Balzac et Flaubert, mais aux intrigues si extravagantes qu’elles défient tout réalisme. » Seriez-vous d’accord avec cette remarque ?
L’alliance du réalisme des sensations, des impressions et du caractère étrange, surprenant ou inquiétant des événements me semble en effet une bonne description du livre.
Quel message auriez-vous pour les lecteurs qui vous sont fidèles mais aussi à ceux qui vous découvrent ?
Les lecteurs semblent emportés par le récit. Beaucoup m’ont dit regretter à la fin de devoir quitter le monde de Peter et Blanche, ce qui est bien un merveilleux compliment.
Propos recueillis par Dan Burcea (30 oct. 2017)
Frédéric Verger, « Les Rêveuses », Éditions Gallimard, 2017, 448 p. 21,50 euros.

