
Qui êtes-vous, où êtes-vous née, où habitez-vous ?
Je suis Leïla Bahsaïn et je suis écrivaine. Je suis née au Maroc, à Salé. De mes huit premières années passées au bord de l’Atlantique, j’ai gardé un attachement profond, une tendresse pour la mer qui m’attire souvent vers elle. J’ai ensuite vécu à Marrakech et à Casablanca. Depuis une quinzaine d’années, je vis dans le Doubs près de Besançon. Je m’y sens à ma place, au milieu de la nature ; avec comme voisins, des chamois et des renards … Je crois beaucoup en l’énergie des lieux.
Vivez-vous du métier d’écrivaine ou, sinon, quel métier exercez-vous ?
Ecrivaine, aujourd’hui je peux dire que c’est mon métier. J’organise ma vie autour de cette activité et de mes engagements associatifs, et ponctuellement j’enseigne. Longtemps, l’écriture était présente dans ma vie mais j’exerçais d’autres métiers : conseillère en insertion, consultante en ressources humaines puis directrice d’une agence de communication, un dernier poste que j’ai quitté avec l’idée de ma consacrer entièrement à l’écriture. Mes nombreuses expériences de vie et de travail nourrissent mon écriture.
Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?
Je crois que beaucoup d’enfants savent ce pourquoi ils sont nés, ce qui a du sens pour eux, leur « activité naturelle ». Depuis l’enfance, j’ai toujours su que ma place était là, et que l’écriture représentait ma façon d’être présente au monde. J’avais tôt compris que la vie, jamais ne m’offrirait d’espace de liberté plus grand que celui que m’offre une page blanche que je remplis de mes mots. Mon histoire avec la littérature est celle d’une grande passion qui à ses débuts a été contrariée socialement par la privation.
Dans le Maroc de mon enfance, seuls les enfants de la classe aisée et dominante, qui fréquentaient les écoles de la mission française, avaient facilement accès aux livres. Nous autres, qui avons fréquenté les lycées publics étions réduits à la médiocrité d’un système scolaire défaillant, privés de culture. Je lisais donc les livres qui se présentaient à moi ; et adolescente, je faisais des kilomètres à vélo pour me rendre à la bibliothèque de l’Institut français de Marrakech. Dans mon entourage, la littérature n’était pas une carrière professionnelle envisageable, il fallait s’orienter vers un métier rentable. Une idée qui me rassurait alors était de tout absorber ; vivre, travailler, pour mieux servir l’écriture.
Quel est l’auteur/le livre qui vous ont marqué le plus dans la vie ?
Tous les livres que je lis laissent une trace en moi. A certains moments de ma vie, je peux y puiser une sagesse salutaire. Aujourd’hui, je citerai “Sans famille” de Hector Malot car je l’ai lu quand j’étais enfant, et que j’ai ressenti une empathie absolue pour le personnage de Rémi. “Une Chambre à soi” de Virginia Woolf, “Johnny s’en va-t-en guerre” de Dalton Trmbo, « Gerardo Laïn » de Michel Del Castillo, “Miramar” de Naguib Mahfouz, “Tendre est la nuit” de F.Scott Fitzgerald, …
Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?
La nouvelle, la poésie, et le roman. Par sa géométrie variable et son ampleur, ce dernier genre est capable d’absorber, de donner une place aux deux autres. J’ai d’abord commencé par écrire et publier des nouvelles dans des revues. La nouvelle est pour moi une mise sous la loupe, un arrêt sur image qui offre une puissance rare. Creuser un instant de crise à travers une nouvelle m’intéresse. Le Roman est un engagement dans la durée, et la poésie un jaillissement, avec des mots si libres qu’ils arrivent sans crier gare.
Quand les personnages arrivent, il y a plusieurs doutes sur l’architecture du texte. Le genre littéraire approprié est la seule certitude que j’ai au départ.
Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?
Mes deux romans et la plupart de mes nouvelles sont écrits à la première personne. C’est un « je » qui cherche à fusionner avec l’altérité ; un jeu anti-froussard aussi qui lutte contre les faux-semblants. C’est peut-être ma façon de rejeter la bien-pensance des sociétés dans lesquelles j’ai évolué. Il n’y a rien de ce que mes personnages font que je ne puisse assumer. Un engagement total.
Je n’ai pas de plan quand j’écris, mais je mets du temps à construire mes personnages. Il n’y a pas de règle, chaque texte vous impose ses propres contraintes. Cela vous demande de rester attentif, de vous adapter. Certains textes, parfois certains chapitres, s’écrivent d’un trait ; d’autres, quelques pages plus loin, nécessitent sans cesse des retouches voire une réécriture interminable.
D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?
Les sujets qui m’inspirent sont généralement ceux liés à une aventure humaine ou à une injustice dont j’ai été témoin. C’est une question de loyauté, une sorte « d’éthique » que je m’impose volontairement. Si je ne sens pas frémir la brèche, je me ravise de suite. J’ai peur de m’éloigner si mon engagement émotionnel n’est pas total, que cela sonne faux, ou de commettre une imposture. Camus a écrit qu’il préférait qu’« on témoignât après avoir été égorgé ». Lire cela m’a confortée dans ce choix.
Quand j’écris, je ne compte pas, je ne pense pas au temps. C’est justement cette liberté qui me plaît. L’écriture est une aventure de résistance au temps. On grave la vie dans une éternité. On y inscrit les mots, avec un niveau de langage qui s’accorde à dire l’ineffable, qui va au-delà des usages habituels des mots et de leur caractère périssable.
Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?
Tout dépend. Pour mon premier roman, Le Ciel sous nos pas, le titre s’est imposé à moi dès les premières pages. Peut-être en raison de ce poème que j’ai écrit et qui figure à la dernière page du livre. Le titre a donné le LA au texte. Pour La Théorie des aubergines, le titre est arrivé après. En relisant mon manuscrit, il s’est imposé comme une évidence. Le titre, c’est la partie visible de l’iceberg, il laisse entrevoir le tempo, la nuance dominante.
Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?
Le seul survivant de toute aventure littéraire est le personnage. J’ai écrit une lettre à un personnage que vous avez publiée (cf. Lettres Capitales, 5 juillet 2020). J’y explique la force, l’authenticité de ce rapport.
Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.
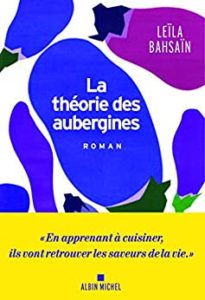 Mon dernier roman, La Théorie des aubergines, est paru au mois de mars de cette année aux éditions Albin Michel. Ce livre-là, raconte l’histoire de Dija, une rédactrice en agence de communication qui suite à un licenciement va rejoindre un projet original. Il s’agit d’une cuisine d’insertion qui réunit un groupe de personnes que la vie a malmenés. L’injonction constante à la performance m’a donné envie de creuser les fêlures personnelles, ce qui se joue aussi sur le plan émotionnel dans nos rapports au travail, et comment la solidarité peut-être une réponse à nos aspirations individuelles. Je l’ai construit avec l’idée d’un trompe-l’œil, des personnages qu’entravent des apparences trompeuses, un lieu où il se passe plus qu’il n’y paraît…
Mon dernier roman, La Théorie des aubergines, est paru au mois de mars de cette année aux éditions Albin Michel. Ce livre-là, raconte l’histoire de Dija, une rédactrice en agence de communication qui suite à un licenciement va rejoindre un projet original. Il s’agit d’une cuisine d’insertion qui réunit un groupe de personnes que la vie a malmenés. L’injonction constante à la performance m’a donné envie de creuser les fêlures personnelles, ce qui se joue aussi sur le plan émotionnel dans nos rapports au travail, et comment la solidarité peut-être une réponse à nos aspirations individuelles. Je l’ai construit avec l’idée d’un trompe-l’œil, des personnages qu’entravent des apparences trompeuses, un lieu où il se passe plus qu’il n’y paraît…
Mes projets : continuer, tout simplement.
Crédits photo de l’auteure : Amandine Fénix

