
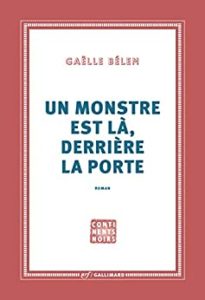 Par la voix de son héroïne dont elle tait le prénom, Gaëlle Bélem nous informe que son roman Un monstre est là, derrière la porte est un « livre-testament » qui retrace l’incroyable aventure des siens, les Dessaintes, dont l’histoire prend des envols assez larges de l’Afrique et jusqu’à Saint-Denis, au nord de l’Île de la Réunion dans les années 1980. Il ne s’agit pas pour cette écrivaine d’un simple exercice de narratrice luttant contre l’ennui ou la fatalité d’une existence qui lui échappe ; son talent est réel et prodigieux, son écriture lumineuse a l’ambition de consigner en lettres irisées l’histoire d’abord d’une jeune fille solitaire et plus tard d’une jeune-femme à la recherche d’une identité qui se dérobe à chaque moment où elle essaie de sortir d’une nuit omniprésente et étouffante. Qui est cette héroïne-narratrice qui a le privilège de raconter la vie de son auteure à la première personne ? Et pourquoi son quartier, comme les autres, d’ailleurs, ne cesse d’être un lieu soumis à des « tyrannies invisibles » ?
Par la voix de son héroïne dont elle tait le prénom, Gaëlle Bélem nous informe que son roman Un monstre est là, derrière la porte est un « livre-testament » qui retrace l’incroyable aventure des siens, les Dessaintes, dont l’histoire prend des envols assez larges de l’Afrique et jusqu’à Saint-Denis, au nord de l’Île de la Réunion dans les années 1980. Il ne s’agit pas pour cette écrivaine d’un simple exercice de narratrice luttant contre l’ennui ou la fatalité d’une existence qui lui échappe ; son talent est réel et prodigieux, son écriture lumineuse a l’ambition de consigner en lettres irisées l’histoire d’abord d’une jeune fille solitaire et plus tard d’une jeune-femme à la recherche d’une identité qui se dérobe à chaque moment où elle essaie de sortir d’une nuit omniprésente et étouffante. Qui est cette héroïne-narratrice qui a le privilège de raconter la vie de son auteure à la première personne ? Et pourquoi son quartier, comme les autres, d’ailleurs, ne cesse d’être un lieu soumis à des « tyrannies invisibles » ?
Nous donnons ici la parole à l’écrivaine réunionnaise, la première à être publiée chez Gallimard.
Vous êtes la première écrivaine réunionnaise éditée chez Gallimard. Que représente cette performance pour vous ?
Être la première femme réunionnaise dont le roman est édité par Gallimard dans la collection « Continents Noirs » dont nous célébrons, de surcroît, les vingt ans en 2020 est évidemment un honneur, une « joie souveraine et parfaite », comme dirait Spinoza. Vous parlez de performance. J’aime votre mot ! On pourrait aussi dire prouesse littéraire, acte de bravoure. Non par vantardise, mais parce qu’il m’a fallu vraiment braver les préjugés, les briseurs de rêves, les paroles décourageantes bien plus que mes propres doutes pour y parvenir. C’est une performance parce que je fais partie des béquillards de la vie, de ces mal partis qui parviennent là où on ne les attend pas à force de travail, de rigueur, et de ténacité.
Lorsque mon manuscrit arrive chez Gallimard, je me sens David allant affronter Goliath, peu armé, marchant vers un combat que les autres considèrent comme perdu d’avance. Je me sens David, oui ! Équipée d’une simple fronde, mon audace franche, et croyant aux dieux de la littérature (les Sénèque, Juvénal, Hesse, Maupassant et alii) qui m’ont tout enseigné.
Lorsque les portes de Gallimard s’ouvrent, que le loquet s’abaisse comme Goliath s’abat sur le sol, je suis heureuse et en même temps intimidée par cet exploit.
Gallimard, c’est un symbole, un signe fort ! Que le travail acharné peut parfois mener à de belles victoires. Labor omnia vincit (le travail vient à bout de tout), Ad augusta per angusta (Vers de grandes choses par des voies étroites), voilà les devises antiques devenues mantras que je me répétais chaque jour.
Cette conquête, c’est enfin un message optimiste, enthousiaste lancé à toutes celles qui n’osent pas : Dépassez-vous ! La fortune sourit aux audacieux ! Maintenant, cette performance se produit à un moment crucial de l’histoire humaine : épidémie mondiale, confinement, crise économique qui se profile. La question est désormais comment l’écrivaine qui vient de naître peut apporter sa pierre et participer à la reconstruction de l’édifice mondial.
Exit la couronne d’olivier, le kotinos du triomphe ! La performance, c’est maintenant bâtir une nouvelle société où l’art a plus de poids que le profit, le capital.
Comment est né votre livre, et comment l’histoire des Dessaintes est devenue pour vous un sujet et une urgence d’écriture ? Votre narratrice le qualifie de livre qui raconte « les atrocités et la splendeur des Dessaintes ».
J’ai l’impression que ce livre était là, en latence, en attente dans mon esprit depuis mes 20 ans. Mais, Paris est une ville, une amante jalouse et possessive qui me prenait toutes mes heures. Quelques temps après mon retour à La Réunion, j’ai eu envie de lire un roman sur les splendeurs et misères des pauvres, mais sans misérabilisme. Faute d’avoir trouvé le bon livre, je l’ai écrit. « La critique est aisée, mais l’art est difficile », écrivait-on déjà au XVIIIe siècle. On ne pourra pas me reprocher de déplorer l’absence d’une satire sociale de La Réunion des années 1980. Désormais, cela existe !
C’était une urgence d’écrire ce roman. Un besoin têtu, une rage obstinée. Je suis éblouie par la violence stylisée que je vois dans Django Unchained de Quentin Tarantino et Mad Max : Fury road de George Miller ; je suis émerveillée par la légèreté et l’onirisme du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. En même temps, il y a la fascinante noirceur d‘un Lautréamont, le fantôme de James Baldwin, le militantisme d’un Césaire. C’est tout cela et ceux-là que je convoque pour faire mon propre roman.
Je suis fatiguée d’entendre parler de La Réunion uniquement comme si l’île n’était qu’une carte postale bon marché : lagon poissonneux, cirques et forêts primaires propices au tourisme vert, savane, volcan hyperactif, rougail de saucisse, maloya et femmes faciles et splendides, letchis et autres fruits tropicaux. Il y a quelque chose de méprisant dans le fait de taire l’existence de 850 000 individualités. Quelque chose manquait à mes yeux ! L’essentiel, peut-être ! Les Réunionnais !
La Réunion est une île où 30 % des habitants et 60 % des jeunes sont au chômage. Mais, c’est aussi une île de gens qui travaillent, qui essaient, qui échouent, qui se relèvent, qui vont d’échec en échec sans perdre leur enthousiasme, comme dirait Churchill. Ces gens méritaient une voix plus forte. Je voulais être la voix des sans voix.
On connaît bien la créolité antillaise grâce à Césaire, Chamoiseau, Confiant, Glissant, Condé, mais la créolité réunionnaise, bien différente, qui la connaît ? Je visite six pays différents chaque année, personne n’a jamais été capable une seule fois de me citer un seul auteur réunionnais ! Il faut que cela change !
Vous prenez le risque de confier à votre héroïne dont vous taisez le prénom le rôle privilégié de narratrice. Ce « je » renvoie le lecteur vers l’auteur du récit, en occurrence à vous-même. Y a-t-il, pour être plus direct, un lien avec votre histoire personnelle ? Peut-on parler dans ce cas d’une autobiographie romanesque ?
Il y a toujours une part d’autobiographie dans un texte. Mais, est-ce si important de savoir si le « je » du texte est le « moi » existant ? Un texte doit être lu pour ce qu’il est, sans savoir qui se cache derrière tel personnage. Cela relève du voyeurisme et non plus de la littérature, autrement. Je fais comme James Baldwin, avec La conversion, une semi-autobiographie si vous voulez.
Flaubert disait « Mme Bovary, c’est moi ». Cette narratrice a un peu de moi évidemment, mais n’est pas entièrement moi. Comme chez Rimbaud, Je est aussi un autre. En vérité, je suis chacun et dans chacun des personnages de ce texte. Ce texte n’est pas tant une transposition de ma vie personnelle que celle d’un milieu, celui des classes populaires réunionnaises entre les années 1980 et 2000.
Ce qui m’importait avant tout, c’était de raconter l’envers méconnu d’une île partiellement paradisiaque seulement. D’ailleurs, pour qui ce paradis ? Pas les 40 % de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Le caractère historique de votre roman est incontestable. Il peut être analysé de plusieurs angles de vue : je vous en propose ici deux d’entre eux. Le premier est l’histoire du 21, rue Descartes. Sans dévoiler les secrets de cet univers où les légendes deviennent vérité et où, malgré tout, votre héroïne passe une enfance heureuse, que pouvez-vous nous dire de cet endroit symbolique ?
Cet endroit est à la fois symbolique et très réaliste. C’est le lieu de l’enfance heureuse, de l’éducation par la terreur, et puis finalement du renoncement à l’éducation. C’est un lieu qui tient à la fois du bonheur et du cauchemar. J’aime cette ambivalence, ce côté « bifrons » (à deux visages), car on sait bien que dans la vie, tout n’est jamais ni noir ni blanc. Les lieux peuvent avoir des connotations très différentes en fonction des époques et des événements qu’on y a vécus.
Le deuxième angle et plus large et concerne l’Histoire majuscule des habitants de l’île. Pourquoi l’avoir inséré dans votre récit et quelle importance a-t-elle dans l’économie de votre roman ?
Les Dessaintes ne sont pas des monades autosuffisantes et solitaires apparus ex nihilo. Ils sont aussi le triste résultat d’une Histoire, d’un passé esclavagiste et d’un système colonial qui ont altéré leur psyché, et qui laissent aujourd’hui encore des séquelles psychologiques lourdes sur les Réunionnais. Il y a un trauma que l’on ne doit plus nier. Insérer l’Histoire avec un grand H permet donc de comprendre l’histoire particulière des Dessaintes. Il y a en effet un lien entre les deux.
Dès lors, les Dessaintes ne deviennent qu’un prétexte pour évoquer avec humour et grincement de dents de nombreux dysfonctionnements de la société réunionnaise.
L’univers enfantin de votre héroïne est tellement riche et coloré que l’on a peur de ne pas trouver les mots justes pour le décrire. Et pourtant, j’ai trouvé une métaphore admirable que tout le monde devrait se mettre dans un coin de sa mémoire. « De mes yeux tombe alors quelque chose comme un sanglot de papillon ». N’est pas ça la plus belle définition de la fragilité enfantine devant le réel souvent surprenant, voire décevant, du monde ?
Oui. Je suis fascinée par les artistes qui ne s’enferment pas dans un genre, par les êtres qui ont plusieurs centres de gravité. J’ai pensé ce roman comme un tableau sociologique de La Réunion des années 1980-2000. Je l’ai aussi pensé aussi comme un texte jalonné de passages poétiques. Avec cela, j’ai voulu un humour décapant, une outrance un peu rabelaisienne. Ajoutons-y une pointe d’Histoire, du fantastique digne de Lovecraft et vous avez ma conception du roman c’est-à-dire un tout, sans pour autant être un fourre-tout !
Comment expliquer que l’on peut se sentir vieux à neuf ans, que l’on se sent rejeté, que l’on est toujours en quête de reconnaissance parentale ou collégiale et que l’on est toujours soumis à une imprécation comme « c’est comme ça, un point c’est tout » ?
On peut même se sentir vieux bien plus jeune i.e. bien avant ses neuf ans. L’âge biologique et la maturité sont deux réalités bien distinctes. J’adore le cinéma, il m’inspire autant que les écrivains. Capharnaüm, film de Nadine Labaki sorti en 2018, retrace justement l’incroyable parcours d’un garçon de 12 ans, Zain, qui intente un procès à ses parents parce qu’ils ne s’occupent pas bien de lui. Cet enfant de 12 ans n’est-il pas très vieux, en vérité, et peut-être même usé à l’intérieur ? En somme, vieillissent précocement tous les mal aimés. Et ils sont très nombreux ces petits êtres qui ne sont plus désirés, que l’on n’a plus envie d’élever, qui sont victimes de maltraitance. La carence affective tue aussi, mais d’une autre manière que la carence alimentaire. Celle-là touche avant tout l’esprit et le cœur, la dernière anéantit le corps entier. Les deux sont détestables. Le message de mon livre, c’est que la résilience existe toutefois.
Faut-il croire que l’amour des livres, l’écriture même peut nous aider à faire face à cette solitude, comme c’est le cas de votre héroïne ? « Pas un jour sans une ligne », dit-elle, comme si elle voulait nous rappeler la fameuse devise de Pline l’Ancien, « Nulla dies sine linea ».
Un livre est bien plus qu’une juxtaposition de feuilles griffonnées, avec une histoire pleine d’émotions destinée à nous faire passer le temps. C’est une porte ouverte sur un écrivain et son monde, un écrivain et sa galerie de personnages. On se reconnaît en eux, ils deviennent des amis autant que des miroirs qui nous aident à nous voir, pour, je l’espère, mieux nous polir notre pierre. Lire et écrire peuvent être des remèdes à la solitude, au désespoir parfois, au suicide même, je n’ai pas peur de le dire ! Mais je n’absolutise pas mes passions. Si pour moi le livre est un ami, pour d’autres cet ami prendra la forme d’un instrument de musique, d’un métal à sculpter, d’une feuille sur laquelle dessiner. Ce qui est certain, c’est que l’homme ne vit pas que de pain, mais aussi de l’art. Même les animaux d’ailleurs y sont sensibles à leur manière.
Comme Fernando Savater, je dirais que « la lecture est la passion de ma vie. […] J’ai écrit, finalement, par fidélité à mon plaisir de lire. »
Une autre phrase accorde une force inédite à l’acte de l’écriture : « J’ai un livre sur ma table de chevet. Parce que je n’ai pas de pistolet ». Peut-on, en guise de conclusion, dire qu’écrire est plus qu’un acte de dévoilement de soi et qu’en fin de compte il peut également contenir cette rage de vivre, de dire que l’on existe ?
Le texte d’un écrivain l’habille autant qu’il le met à nu, et donc le dévoile au monde entier. C’est aussi cette vérité de l’écriture qui m’attire. Enfin, le livre peut être un rempart contre l’autodestruction, un médicament contre la névrose. Il ne guérit pas forcément mais permet d’atténuer le mal. Et puis, il y a le livre-trampoline, celui qui vous fait bondir et vous ramène à la vie ! Pour ma part, c’est certes un poncif, mais j’écris donc je suis ! J’ai dit.
Interview réalisée par Dan Burcea
Crédit photo Ahimsa
Gaëlle Bélem, Un monstre est là, derrière la porte¸ Editions Gallimard, 2020,

