
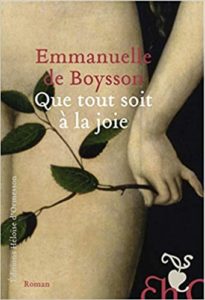 Nous avions quitté Juliette Monin accompagnée de ses rêves et de ses révoltes d’adolescente dans «Les années Solex» (2017), roman qu’Emmanuelle de Boysson qualifiait à sa parution «d’histoire d’amour» et «de fin des illusions» d’une génération post-soixante-huitarde qui assistait résignée à la mort lente mais inexorable de ses idéaux et dont son héroïne se voulait être le modèle. Dans une chronique que j’écrivais à l’époque, je faisais remarquer le pari réussi de l’auteure pour garder «l’équilibre fragile entre le désir d’écriture et la fragilité du monde décrit».
Nous avions quitté Juliette Monin accompagnée de ses rêves et de ses révoltes d’adolescente dans «Les années Solex» (2017), roman qu’Emmanuelle de Boysson qualifiait à sa parution «d’histoire d’amour» et «de fin des illusions» d’une génération post-soixante-huitarde qui assistait résignée à la mort lente mais inexorable de ses idéaux et dont son héroïne se voulait être le modèle. Dans une chronique que j’écrivais à l’époque, je faisais remarquer le pari réussi de l’auteure pour garder «l’équilibre fragile entre le désir d’écriture et la fragilité du monde décrit».
Deux ans plus tard, elle relève avec brio le même défi dans un deuxième volet dont le titre «Que tout soit à la joie» (2019) semble inviter à une vraie explosion d’allégresse, alors que Juliette, son héroïne, se prépare à entrer dans la vie d’adulte. Devrions-nous placer cette promesse sous le signe du conditionnel ? Comme l’affirme la romancière dans une interview accordée à Patrick Simonin, quelque chose de plus grave et de plus inattendu mettra son empreinte sur cette période de l’existence de son personnage. Quelque chose de douloureusement réel, d’une extrême dureté et en même temps de symbolique, ayant pour son héroïne valeur d’acte fondateur de sa personnalité, et qui l’obligera désormais à jouer dans la cour des grands et affronter de face la vie. Il s’agit de la mort dans des conditions controversées de son grand-oncle – le cardinal Paul Dantec, dans le livre – cet homme qui restera pour elle « le plus gentil des hommes ».
Pour Emmanuelle de Boisson, cet homme est avant tout «celui qui m’a encouragé à écrire», comme elle le reconnaît en parlant des carnets qu’elle tient depuis toujours, qu’elle garde précieusement et auxquels elle confère une valeur de journal secret. Ce sont des carnets qui ressemblent à «des coquillages qui contiennent vos désirs». Ce n’est pas étonnant qu’elle finisse par leur accorder le rôle de gardien de la mémoire familiale et dans lesquels Juliette puisera pour reconstruire son récit personnel.
La voici donc prête à franchir le seuil de l’âge adulte et affronter le temps de la construction d’une carrière, d’une famille et de tout ce que l’on appelle avec la plus conventionnelle et commune des expressions, les choses raisonnables de la vie. Sauf que raisonnable est justement le mot le plus dur à définir pour une jeune femme qui se jette dans l’inconnu : études, famille, plus tard, enfants, mari, ennui du quotidien, acceptation de ce rôle d’épouse et de mère. Toutes ces choses demandent beaucoup d’énergie de sa part et surtout un effacement de soi.
Peut-on parler d’une voie toute tracée ? Et, si oui, que veut dire cet étrange syntagme qui dit que sa voie «ressemble à un chemin de traverse» ? Cette phrase, et surtout ce qui suit qui finit par nous offrir la clé essentielle de ce que nous pourrions nommer le chemin de vie de Juliette : «je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas».
Est-il juste de dire de cette jeune-femme qu’elle se construit contre les conventions qu’elle a à affronter ? Quels sont les moyens dont elle dispose pour renverser la courbe du quotidien qui risque de l’absorber complètement ? «Je suis bien plus taillée pour la poésie que pour la politique», écrit-elle à un moment où deux vocations tentent de gagner la première place dans la construction de sa personnalité. Cette déclaration cache sous sa force métaphorique l’indice le plus évident inscrit sur le parchemin qui traverse la vie de Juliette/Emmanuelle, celui du désir irréconciliable d’écrire, qu’elle aime définir comme l’amour, même gratuit, des mots. Écrire devient la raison suprême contre toutes les contraintes : «écrire pour ne pas vieillir, pour ne plus être raisonnable, ne plus séduire, ne plus oublier, pour me nourrir, pour entrer dans le jardin de récréation et jouer à l’élastique ou à la marelle, comme on écoute un coquillage qui contient vos désirs, au diapason du blues, sous une ombrelle ou une tonnelle, avant de s’effacer sous un linceul».
Cette longue citation se suffit à elle-même pour être un art poétique surprenant, un programme accompli du métier d’écrivain. Écrire serait en même temps synonyme de grandir sous l’aura d’un modèle, d’une fondation assez solide, d’un socle. celui du grand-oncle. La mort subite de cet homme qu’elle aime tant mais, surtout la suite des commentaires, des soupçons va obliger sa famille à s’enfermer dans des non-dits et dans un refus de répondre au cortège des nombreuses calomnies.
Dès lors, Juliette endosse un rôle nouveau qui se rajoute à son devoir de consigner la mémoire familiale. Il s’agit du devoir de justice qui passe obligatoirement par le risque d’accéder à une vérité dure, voire inacceptable, mais si nécessaire, et à déclencher par surcroît la colère de sa famille. Elle doit écrire le livre promis au grand-oncle Paul, le livre de sa vie ! S’en suit une longue suite d’enquêtes le concernant, d’enregistrements de témoignages, d’arguments, des lectures approfondies, des démenties de ce que l’on appelle aujourd’hui des fake news qui empoisonnent nos vies. Cette partie du roman est la plus puissante et donne au récit un côté justicier appuyé, graciable, d’une vie qui ne s’explique pas seulement par ses écueils mais qui doit être regardée avec compassion dans son ensemble et surtout dans sa profondeur.
Emmanuelle de Boysson offre à son tour une définition magistrale du rôle majeur de l’écriture, censé nous sauver du réel et de nous-mêmes, du cours trop rapide du temps et, peut-être, pour reprendre ici la définition de Françoise Cloarec, «de sortir de l’enfer».
Dan Burcea
Crédits photo: David Ignaszewski
Emmanuelle de Boysson, « Que tout soit à la joie », Éditions Héloïse d’Ormesson, 240 p.

