
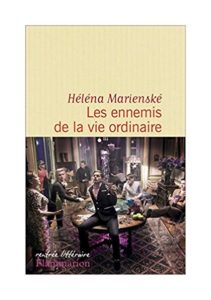 Jeunes ou moins jeunes voyageurs à travers la monotonie ambiante, ne vous laissez pas abattre, il y aura toujours une place pour vous dans le royaume des pieds nickelés d’Héléna Marienské ! Son dernier roman, Les ennemis de la vie ordinaire, nous y invite avec un humour décalé et de toute beauté. Ses personnages sont les fondateurs d’une abbaye de Thélème moderne où la devise rabelaisienne Fais ce que voudras prend des tournures encore plus libertaires. Il faut dire que les temps ont changé, les produits paradisiaques aussi : cocaïne, alcool, sexe, sport, jeux, achats compulsifs. Sous la forme d’un groupe de parole, tout ce beau monde suit, sous la houlette de Clarisse Albéniz, une psy elle-même assez fragile, une thérapie collective qui va se révéler non seulement inopérante, mais porteuse des effets encore plus immodérés. Croyant dur comme fer aux vertus analeptiques de la thérapie par l’excès, ils vont mettre au point une curieuse et paradoxale stratégie curative commune. Héros de la contagion salutaire, ces trouble-fête de «la vie ordinaire» sont loin de se douter où leur aventure va les emmener. Les lecteurs non plus !
Jeunes ou moins jeunes voyageurs à travers la monotonie ambiante, ne vous laissez pas abattre, il y aura toujours une place pour vous dans le royaume des pieds nickelés d’Héléna Marienské ! Son dernier roman, Les ennemis de la vie ordinaire, nous y invite avec un humour décalé et de toute beauté. Ses personnages sont les fondateurs d’une abbaye de Thélème moderne où la devise rabelaisienne Fais ce que voudras prend des tournures encore plus libertaires. Il faut dire que les temps ont changé, les produits paradisiaques aussi : cocaïne, alcool, sexe, sport, jeux, achats compulsifs. Sous la forme d’un groupe de parole, tout ce beau monde suit, sous la houlette de Clarisse Albéniz, une psy elle-même assez fragile, une thérapie collective qui va se révéler non seulement inopérante, mais porteuse des effets encore plus immodérés. Croyant dur comme fer aux vertus analeptiques de la thérapie par l’excès, ils vont mettre au point une curieuse et paradoxale stratégie curative commune. Héros de la contagion salutaire, ces trouble-fête de «la vie ordinaire» sont loin de se douter où leur aventure va les emmener. Les lecteurs non plus !
Bienvenue dans le monde décalé d’Héléna Marienské où souffrance et fragilité de l’être s’unissent pour chanter l’hymne à la servitude de nos faiblesses !
Difficile de résister à la tentation de vous poser d’emblée cette question : mais d’où vous est venue l’idée de ce livre burlesque et tellement décalé ? Y a-t-il un élément déclencheur à la base de ce récit ?
Rien de plus capricieux qu’un roman. On veut l’écrire, on n’y parvient pas. Et il vous vient sous la plume au moment où on s’y attend le moins. J’ai connu une période de panne d’écriture dont je ne voyais pas le bout. Je voulais écrire ce fichu livre que j’avais commencé, et rien à faire. Je passais toutes mes journées devant l’ordinateur, je m’obstinais… Et rien ! Au bout de six mois, je décide de me délasser un peu, histoire de ne pas sombrer dans la folie : me délasser, oui, mais sur mon ordinateur, au cas où surgirait une idée. Pourquoi pas une petite partie de poker en ligne ? Je la gagne, je gagne la suivante, je suis ravie. Je perds la troisième, ce n’est pas grave. Le jour suivant, je joue (non pas trois, mais dix parties). La semaine suivante, je passe des parties gratuites aux parties payantes : je trouve ça beaucoup plus excitant. Mais je perds. Normal, me dis-je, sur Internet, tout est truqué. Je décide donc d’aller jouer au casino. Un soir par semaine, puis presque tous les soirs. Vient un jour où mon mari me demande : tu peux m’expliquer le GROS trou qu’il y a sur notre compte commun ? Mais oui, mon chéri, c’est que je suis en train d’apprendre à jouer. Pour l’instant, je perds, c’est normal, je débute. Patiente un peu. Comme il est patient mais qu’il y a des limites, il m’a suggéré : et si tu écrivais un livre sur l’addiction ? J’avais mon sujet, j’avais mon livre… Et je pouvais m’adonner à mon addiction favorite : l’écriture.
Notons aussi le très beau titre de votre roman. Précisons le contexte : à la page 194 du livre, Mariette écrit dans son journal : «Mylène, c’est une grande, une guerrière. Une ennemie de la vie ordinaire». Tout un programme…
Ce titre est arrivé à la toute fin du processus d’écriture. Le premier titre que j’avais retenu était « les Epaves ». Pour deux raisons : parce que mes personnages se percevaient comme des loques lorsqu’ils étaient réunis par la psychothérapeute, et parce que c’était une allusion à Baudelaire, que je lis souvent, et dont les pièces condamnées des Fleurs du Mal ont finalement été publiées dans les éditions ultérieures en fin de recueil, sous le titre « Les Epaves ». Mais je me suis avisée que le titre ne rendait pas compte de l’évolution des personnages au cours du roman. Après tout, c’est une « success story » qui conduit les épaves du début à une apothéose inattendue ! Je me suis donc mise en quête d’un titre, en me disant que j’allais rester fidèle à Baudelaire. J’ai donc relu les Paradis artificiels, et suis tombée sur une expression qui m’a tout de suite plu. L’ami Charles évoque les amateurs de drogues comme des « ennemis de la vie régulière ». C’était presque ça… J’ai un peu cherché autour de cette idée, et je suis arrivée au résultat que vous connaissez. J’étais ravie, car j’ai compris que ce titre correspondait à tous les personnages que je fais vivre dans mes romans, depuis que j’écris. Tous depuis les énergumènes de Rhésus sont des ennemis de la vie ordinaire… comme moi. C’est dans notre ADN.
La trame narrative repose sur ce que l’on pourrait appeler le protocole de Clarisse, la psy qui se vante d’avoir sauvé de leurs addictions de nombreuses personnes. Sa ligne directrice prévoit de «cesser de cloisonner, d’encager» les patients pour les aider à combler «les failles dans la construction du moi». Ce qui donne naissance au groupe des polyaddicts …
Clarisse, elle est bien gentille, mais tout de même assez naïve. Elle aurait bien pu se douter que ses addicts avaient une nature… addictive ! Et que mis au contact de toxicomanes accros à d’autres substances, ils allaient avoir envie d’expérimenter ce qui les conduit au nirvana. Je n’avais pas prévu ce dérapage, au début de l’écriture. Mais j’aime assez l’idée, dans une société où on nous normalise, on nous coache, on nous intime l’ordre d’aller bien, que la liberté s’enracine dans la transgression de cette nouvelle morale.
Cet espace comparable à une cour des miracles est un vrai huis clos théâtral. Faisons, donc, entrer les protagonistes ! D’abord, les addictions, les unes plus connues et plus inattendues que les autres : le jeu, la drogue, l’achat compulsif, le sexe, l’alcool, le sport. Comment les avez-vous choisies ?
Le jeu s’est imposé, comme vous l’avez compris : mon point de départ. Ensuite, l’alcool et l’héroïne sont des addictions tellement répandues qu’il aurait été difficile de s’en passer. Pour l’addiction au sport, j’y tenais beaucoup, parce que cela m’a permis d’évoquer un problème qu’on ignore souvent : le fait que certaines personnes, pour réparer une faille personnelle (souvent une mauvaise image de soi, quelquefois un épisode de surpoids pendant l’adolescence) pratiquent le sport d’une manière qui va bien au-delà de ce que leur corps, leur entourage, leur vie sociale peuvent supporter. Ils sont vraiment accros, mais le sport est tellement valorisé dans notre société qu’ils restent souvent dans un déni absolu. Pour l’addiction au sexe, j’ai été marquée par le film Shame, avec Michael Fassbender : par le désespoir du personnage, sa solitude, son incapacité à créer un lien amoureux – gros potentiel romanesque, évidemment ! Pour la coke, elle est venue par le choix du personnage. Je voulais qu’un de mes addicts soit un curé. Et il fallait absolument sortir du cliché : le prêtre addict au charme des petits garçons. Cocaïnomane, c’est beaucoup plus drôle. Je ne sais pas pourquoi, je me suis énormément attachée à ce personnage : j’en ai fait la bonté incarnée, associée à un tempérament de filou. Et je lui ai donné le chien que je rêvais d’avoir : un cavalier King Charles, que j’ai appelé Blaise, comme Blaise Pascal. Enfin pour l’addiction au shopping… Eh bien, lorsque je m’observe certains jours de soldes, que je vois cette frénésie absurde qui s’empare de moi… je me dis que je ne suis pas loin d’être une grande malade.
Les séances ne sont pas faciles à vivre au début. Clarisse Albéniz raconte cela dans ses lettres. Il s’agit, sans doute, de ces fameuses failles du moi qui ont du mal à se combler. À quel moment et par quel mécanisme ces barrières vont commencer à tomber permettant aux personnages de devenir solidaires les uns aux autres ? Solidaires est, peut-être, un mot trop faible ou trop fort ?
Au début, les sept protagonistes ont du mal à se livrer. Surtout, l’un d’eux met tout en oeuvre pour que la thérapie échoue. C’est Damien, le sex-addict, brillant professeur de Littérature classique à la Sorbonne, qui méprise ses acolytes, partant du principe qu’ils sont incultes et lui font perdre son temps. Il provoque tout le monde, y compris la thérapeute. Mais lorsque cette dernière aura jeté l’éponge, se sentant incapable de faire face à la rébellion énergique de mes énergumènes, ils vont avoir envie, et même besoin, de continuer à se voir. Jusqu’à vouloir vivre ensemble, dans une sorte de communauté improbable. « Solidaires » n’est pas trop fort : c’est exactement cela. Ils étaient solitaires et deviennent solidaires : c’est tout le parcours du livre. Un livre optimiste, donc !
Une nouvelle dynamique se met doucement en place. Peut-on parler d’une période de résilience par la contagion ?
Il s’agit bien de résilience : je crois que je suis moi-même une résiliente. Je mets en scène cette résilience en lui donnant différents visages, ceux d’Elisabeth ou Mariette, mais aussi ceux de JC, le prêtre sosie du Pape François, ou de Gunter, le joueur dépressif.
Cette nouvelle structure du groupe va donner naissance à une vraie famille, même si les tensions ne vont pas disparaître. Au contraire.
Il y aura des conflits, assez mineurs, et de la part de certains, une certaine réserve : Gunter, par exemple, ne sort jamais de sa solitude. Mais dans l’ensemble, c’est l’entraide qui prévaut. L’impression de ne plus être seul – alors que tous crevaient de leur solitude. La certitude de pouvoir compter les uns sur les autres. La découverte de l’amitié, de l’amour pour certains… C’est une sorte de famille qu’ils se sont choisie. J’aime bien cette idée : et si on pouvait choisir sa famille ? Cela éviterait bien des névroses.
Et puis, tout s’emballe, permettant aux personnages de construire une stratégie de combat.
La faute à qui ? A Monseigneur Soixante-Six, archevêque de Paris ! Il n’a pas trop aimé que Jean-Charles détourne les fonds qu’il lui avait fait allouer par les Monuments Historiques pour qu’il refasse la toiture de son église. 250 000 euros, tout de même ! Alors, il a sévi : JC se retrouve à la Santé, et son chien est kidnappé. Il ne sera restitué à son propriétaire qu’à la condition expresse que le grand pécheur restitue les deniers du culte. Là, il faut bien trouver une stratégie. Le romanesque devient rocambolesque : choix de la comédie pour traiter d’un sujet grave…
Comment gagner très vite une somme pareille ? En fait, la stratégie fonctionne si bien que la petite équipe va gagner beaucoup plus qu’il n’était nécessaire.
Cela coïncide avec le retrait soudain de l’espace narratif de Clarisse. Pourquoi l’avoir fait disparaître soudainement du récit ?
Parce qu’il faut savoir escamoter un personnage, parfois, pour amorcer une nouvelle dynamique narrative. Clarisse était pleine de bonnes intentions, mais se contentait d’appliquer des protocoles. Butée, elle n’a pas su comprendre ni entendre ses patients. Lorsqu’elle s’efface du récit, une autre femme prend le relais : Elisabeth, celle qui dans le groupe allait le plus mal. Elle prend son destin en main, et dans un même élan, celui de tout le groupe. Dans un roman, tout est possible ! C’est ce que j’aime dans l’écriture romanesque : les personnages sont pris dans un élan narratif qui fait pièce aux pesanteurs de la « vraie vie ». Je voudrais vivre dans un roman.
Peut-on parler à la fin d’une victoire de ces pieds nickelés modernes ? Et, si oui, une victoire contre qui : contre leurs addictions ou contre toutes les conventions auxquelles ils ne cessent de tourner le dos ?
Une victoire contre leurs peurs, contre leurs blessures de l’enfance, contre leur solitude, contre leur malheur, contre la fatalité. Je mets toute mon énergie à rendre mes personnages heureux.
Vous avez déclaré récemment que votre livre peut être lu comme un récit de résurrection, comme d’ailleurs plusieurs de vos livres. Écrire c’est aussi soigner, surtout les souffrances extrêmes, selon vous ?
Oui, je me suis aperçue que j’écrivais des histoires de résurrection. Pour moi, c’est vital. Je vais souvent très mal, ce que personne n’imagine parce que je garde un visage souriant. Mais la réalité est tout autre. Souvent, je touche le fond. C’est fini : je n’ai plus envie de vivre, je n’en ai plus la force. Et puis, je rebondis. L’écriture est l’espace où je transcris ce processus, où je l’amplifie et où je le stylise.
Propos recueillis par Dan Burcea
Héléna Marienské, Les ennemis de la vie ordinaire, Éditions Flammarion, 2015, 322 p., 19 euros.

