
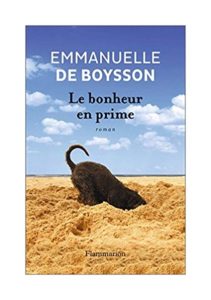 Alors qu’elle est en pleine campagne de promotion de son livre « Le bonheur en prime », Emmanuelle de Boysson vient de recevoir le prix Simone Veil pour son précédent roman, « Oublier Marquise ». Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on vient d’apprendre que « Le bonheur en prime » va être adapté pour la télévision. C’est dire à quel point la récompense du talent littéraire doit compter dans la vie de cette romancière et critique littéraire, présidente du Prix de la Closerie des Lilas ! C’est dire également l’importance qu’occupent dans sa vie l’écriture et le théâtre, des passions qui la motivent et nourrissent son attachement à ces deux expressions artistiques.
Alors qu’elle est en pleine campagne de promotion de son livre « Le bonheur en prime », Emmanuelle de Boysson vient de recevoir le prix Simone Veil pour son précédent roman, « Oublier Marquise ». Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on vient d’apprendre que « Le bonheur en prime » va être adapté pour la télévision. C’est dire à quel point la récompense du talent littéraire doit compter dans la vie de cette romancière et critique littéraire, présidente du Prix de la Closerie des Lilas ! C’est dire également l’importance qu’occupent dans sa vie l’écriture et le théâtre, des passions qui la motivent et nourrissent son attachement à ces deux expressions artistiques.
Derrière tout ce décor, très souvent traître, Emmanuelle de Boysson affirme son attachement aux valeurs humanistes qu’elle met en scène dans ces romans, et nous dévoile une partie de ses secrets d’écrivaine et de journaliste.
Comment se sent la romancière Emmanuelle de Boysson devant toutes ces bonnes nouvelles ? La rareté de ces événements ne rende-elle pas ces occasions d’autant plus précieuses ?
Très bien. Je suis surtout très touchée par les réactions de mes lecteurs, des libraires, des critiques et des bloggeurs qui ont eu la gentillesse de lire Le bonheur en prime. Je sais combien ils sont assaillis de livres. J’ai été agréablement surprise de leurs compliments sur mon style et des réflexions que suscitent ce roman qui, je l’espère, est plus profond qu’il n’en a l’air. Le genre est délicat. Et j’ai tenté de dire des choses graves avec légèreté, de parler du jeu des apparences, des masques, de la difficulté d’être heureux, de la peur de réussir, de l’argent, du désir de rendre les autres heureux, de l’adultère, de la jalousie. Je me réjouis aussi qu’il soit en voie d’adaptation pour la télévision. Une belle aventure qui commence.
Comment vous est venue l’idée d’écrire ce roman? Y a-t-il derrière cette expérience littéraire une expérience de vie qui sert de support à votre narration?
Dans une autre vie, j’ai été comédienne. J’ai joué Tchekhov, Brecht, Marivaux… Et puis j’ai adapté Le Rouge et le Noir au théâtre du Lucernaire. J’y interprétais le rôle de Louise de Rénal – cette expérience me sert beaucoup. J’essaie toujours de trouver « mes équivalences » pour nourrir mes personnages. Depuis longtemps, j’avais envie d’écrire un roman sur le bonheur. J’ai toujours pensé que l’important, c’est d’évoluer, de réaliser ses rêves – j’ai aussi été formatrice en relations humaines. Je m’interrogeais sur cette quête qui me semble parfois illusoire. Je voulais écrire un roman qui allie tragique et comique. Un après-midi, en juin dernier, au café du marché, boulevard Raspail, mon ami Pierre Canavaggio, 85 ans, critique littéraire réputé qui a connu Cocteau, Boris Vian, Morand et tant d’autres, m’a suggéré de lire la pièce d’Evreïnoff, La comédie du bonheur, représentée pour la première fois le 9 novembre 1926 au théâtre de l’Atelier. J’ai été emballée. Evreïnoff y associe le théâtre et le bonheur. Le docteur Frégoli, joué par Charles Dullin, se déguise en cartomancienne qui dit l’avenir à des différents personnages. J’ai aussi vu la libre adaptation de la pièce au cinéma par Marcel L’Herbier en 1943. J’en ai gardé l’idée, la substantifique moelle : comme chez Pirandello ou Marivaux, le jeu est illusion, tromperie à l’image de la vie. Il est aussi thérapeutique. Sans aller jusqu’au psychodrame, il suffit d’assigner à cette illusion du bonheur un rôle positif. Grâce à elle, en effet, le sujet reprend confiance en ses propres capacités et devient à son tour créateur de bonheur. Je tenais mon sujet. Me restait à tout imaginer. J’ai crée Berlingault en m’inspirant de mon ami Pierre. J’avais envie de créer un valet, un Scapin, un Sganarelle. Sans doute parce que j’ai évoqué Molière et sa troupe dans La revanche de Blanche, un des romans de ma trilogie historique. Il y a un peu de moi dans chacun de mes personnages.
Quelles sont les œuvres littéraires qui vous ont servi de modèle ?
La série des Jeeves de P. G. Wodehouse et Good bye Mr Chips, de James Hilton, un merveilleux roman qui raconte l’histoire d’un vieux professeur plein de bonté.
Parlons de votre personnage Jules Berlingault, cet homme loufoque pour qui vous avez beaucoup de sympathie, une tendresse à peine dissimulée.
Ce vieux baron veuf d’Eglantine, amateur de vins, de cigares, de bonne chair, farceur et loufoque, a fait fortune dans le bonbon (il possède un château à Uzès, une villa à Moustique, un yacht, trois maisons à l’île de Ré). Il a développé la petite entreprise familiale d’Uzès dans le monde (j’ai trouvé cette idée quand j’ai vu que les bonbons Haribo venaient de là). Il a donc les moyens d’être généreux mais il veut faire le bonheur autour de lui. Son bon plaisir. Alors, il dilapide son argent, il offre un de ses tableaux, un Matisse, à une œuvre d’handicapés. Son neveu le menace de le mettre sous tutelle… J’adore Berlingault ! A 90 ans, il est resté très jeune d’esprit, il n’a plus rien à perdre, s’amuse, mais surtout, il est très bienveillant, tendre, encourageant. Incorrigible optimiste, il va être le révélateur des passions enfouies de ses quatre voisins au bout du rouleau. Tantôt colérique, exigeant, tantôt boudeur, joueur, il sait où il va. Il est persuadé qu’il gagnera son pari. Il est le grand-père, l’ami rêvé. La générosité incarnée dans ce qu’elle a de plus délicieux : la capacité d’exprimer ses sentiments, d’aimer, de donner aux autres les moyens de réussir. De croire en eux. Tout est dans son regard sur chacun.
Que dire du pauvre majordome Gaspard, malmené tout au long du roman, personnage trouble, vieux garçon en manque de tendresse, héritier probable, condamné à jouer les rabats joie dans une comédie d’où il se sent exclu ?
J’avoue que je ne sais pas comment j’ai pu engendrer une telle créature. Sans doute la part d’ombre de ma personnalité. Mon côté timide, frileux, parfois jaloux, vachard. Gaspard m’échappe et m’est familier. Il est pourtant le narrateur, le personnage principal. Elevé à Abeilhan, près de Béziers, village de mon grand-père, l’avocat Georges Izard, il a souffert d’une mère très dure. Il travaillait à la ferme, élevait des chèvres, jusqu’à ce qu’il rencontre Violette, son grand amour, le drame de sa vie. Son histoire est le fruit de mon imagination. Mais je le comprends tellement ! Il aime Berlingault d’un amour filial, il espère hériter – ce ne serait que justice après trente ans de bons et loyaux services ! Et patatras ! Ces voisins risquent non seulement de lui voler son bien mais surtout l’affection de Berlingault. L’héritage, c’est d’abord une affaire de cœur. Chaque souvenir, chaque cuillère à café prend de la valeur. Alors, il se durcit, il ne supporte plus ces intrus. Il m’est arrivé de ressentir la même chose que lui lorsque ma maison de l’île de Ré était envahie. Comme moi, il tient son journal depuis l’âge de douze ans. Nous avons finalement beaucoup de points communs.
Dans le beau monde qui peuple l’univers de votre roman, il y a aussi les personnages féminins. Luna, femme sensible, perdue dans les couloirs d’un monde trop dur pour elle, et Rose qui «fait partie de ces gens qui jouissent de leur malheur».
Vous avez raison. Rose incarne les gens qui se complaisent dans le malheur. Elle doute d’elle, elle n’arrive pas à s’opposer à son mari, à prendre des décisions, manque d’autorité, se laisse déborder par ses enfants. Elle n’a pas réussi à réaliser son rêve : devenir une couturière créative, se contente de copier des modèles. Elle cherche toujours à faire plaisir aux autres, s’oublie et se sent frustrée. C’est mon Emma Bovary, en moins vénale. Elle vit dans son monde romanesque, en quête du grand amour. Quant à Luna, 25 ans, c’est ma Scarlett et en même temps ma Cosette. Elle vit dans une chambre de bonne avec son chat Essuie-Plume, du nom d’un des chats de Bernard Frank. Fière et solitaire, elle n’est pas facile. Elle rabroue les autres, s’angoisse. Son licenciement la rend malade. Mais, au-delà de tout, elle est déçue par son ami, Laurent. Son « chef » qui n’a pas eu un geste d’amitié envers elle. Elle se dévalorise, déprime, fait une tentative de suicide. Berlingault sera son Pygmalion, elle retrouvera confiance en elle, mais ce sera long et elle n’est pas disposée à l’amour… jusqu’à la fin du roman.
Oser écrire un roman plein d’humour par les temps maussades qui courent n’est-il pas un acte de courage, une entorse à une certaine tendance de pensée artistique unique ? Pour vous, roman populaire, comédie ou fantaisie littéraire riment-ils avec littérature dépourvue de valeur ?
Merci ! Ma seule crainte était qu’on classe le bonheur dans la catégorie « feel good », ces romans à « bons sentiments » que les critiques méprisent. La couverture pourrait y faire penser mais j’ai voulu détourner la comédie, en faire presque un pastiche pour écrire une histoire grinçante, avec des situations parfois terribles. Mais même le jour où Luna veut se suicider, j’ai ajouté des détails qui permettent d’en sourire. Si mon roman est populaire tant mieux. Je m’inscris dans la tradition de Pagnol, de Gogol, de Tchekhov, de ceux qui ont sur allier la légèreté et la profondeur.
Au-delà de tout détachement ou de besoin d’introspection, l’œuvre littéraire vit également de l’écho qu’elle fait résonner dans les consciences de ses lecteurs. Quelle place accordez-vous à la valeur éthique de la littérature ? Sans prétendre changer radicalement le monde, a-t-elle de nos jours l’audience nécessaire pour rendre les gens plus tolérants, voire plus beaux ?
Le genre littéraire varie : poésie, chroniques, romans…. Le roman date du 17 e siècle avec ceux de madame de La Fayette, de Melle de Scudéry. Mais c’est Diderot qui a inventé la libre conversation dans le récit si figé à l’époque. Il suffit de lire Jacques le Fataliste. Roman et philosophie allaient de pair. Au 19 e siècle, le roman est balzacien, hugolien, zolien. Aujourd’hui, il a d’autres valeurs éthiques et esthétiques, mais je ne crois pas qu’il faille limiter la littérature à un rôle précis, moral. Elle n’a pas forcément de « message » à délivrer. Comme celui de changer le monde. L’essentiel est le style, la musique de chaque écrivain. Et aussi, l’histoire qui vous emporte. J’ai relu Le choix de Sophie de Styron, un chef d’œuvre. Tous les soirs, je reprends mon Proust et ne m’en lasse jamais.
L’adaptation de votre roman à la télévision est prévue pour la prochaine saison ? Comment préparez-vous cet événement ?
Je fais confiance à la productrice. Le roman vivra sa vie, autrement.
Propos recueillis par Dan Burcea
Emmanuelle de Boysson, Le bonheur en prime, Editions Flammarion, 2014, 304 p, 18 euros

