
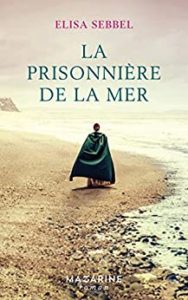 L’Histoire, on le sait, est d’ordinaire oublieuse et tourne facilement le dos à ses capitulations, surtout lorsqu’elle n’est écrite que par les vainqueurs, ce qui est souvent le cas. À tel point que le questionnement de la mémoire et des archives devient impératif comme une nécessaire réparation et que, pour sa réécriture, fut‑elle romancée, dramatique ou sous forme d’épopée des oubliés, aucune autre forme n’est plus à même de lui rendre raison que celle de la littérature. C’est ce que réussit à faire brillamment Élisa Sebbel dans son roman « La prisonnière de la mer » publié en ce début d’année aux Éditions Mazarine. Il faut dire que le sujet choisi s’y prête par sa nature romanesque résumée ainsi sur sa couverture : « 1809, une île déserte, 5000 hommes, 21 femmes – Le destin bouleversant d’Héloïse ». De quoi s’agit‑il et quelle est l’étendue romanesque de cette exploration mémorielle ? Pour en savoir plus, nous donnons la parole à Élisa Sebbel, docteur en littérature française qui vit à Majorque et enseigne dans une université espagnole, pour répondre à nos questions.
L’Histoire, on le sait, est d’ordinaire oublieuse et tourne facilement le dos à ses capitulations, surtout lorsqu’elle n’est écrite que par les vainqueurs, ce qui est souvent le cas. À tel point que le questionnement de la mémoire et des archives devient impératif comme une nécessaire réparation et que, pour sa réécriture, fut‑elle romancée, dramatique ou sous forme d’épopée des oubliés, aucune autre forme n’est plus à même de lui rendre raison que celle de la littérature. C’est ce que réussit à faire brillamment Élisa Sebbel dans son roman « La prisonnière de la mer » publié en ce début d’année aux Éditions Mazarine. Il faut dire que le sujet choisi s’y prête par sa nature romanesque résumée ainsi sur sa couverture : « 1809, une île déserte, 5000 hommes, 21 femmes – Le destin bouleversant d’Héloïse ». De quoi s’agit‑il et quelle est l’étendue romanesque de cette exploration mémorielle ? Pour en savoir plus, nous donnons la parole à Élisa Sebbel, docteur en littérature française qui vit à Majorque et enseigne dans une université espagnole, pour répondre à nos questions.
Par l’histoire que vous relatez, le lecteur est plongé en pleine guerre napoléonienne d’Espagne et plus précisément dans le temps qui suit la reddition de Baylen. Pourquoi avoir choisi cet événement comme cadre pour votre roman ?
En 2008, je ne me suis retrouvée dans un groupe de recherches organisé par le Parc National de l’Archipel de Cabrera à l’occasion du bicentenaire de l’ouverture du camp. Un historien suisse, Geisendorf des Gouttes s’était intéressé au début du XXème siècle au sort de ces prisonniers et mentionnait déjà la présence de femmes. L’historien canadien Denis Smith reparlait d’elles en 2005 mais d’un point de vue assez biaisé (celui d’un seul officier Charles Frossard). En lisant les mémoires, je découvrais d’autres vérités, assez contradictoires avec celles relatées par Charles Frossard. J’ai donc voulu rétablir la vérité ou du moins donner une perspective bien différente du sujet. J’ai tout d’abord écrit un article historique sur le thème puis, avec le temps, j’en ai fait le sujet d’un roman.
La conséquence de cette reddition est l’exil de 5000 hommes qui se retrouvent prisonniers sur la petite l’île de Cabrera dans les Baléares. De quoi s’agit-il, qui décide et quelle est la raison militaire ou politique de ce débarquement ?
À la suite de la défaite de la bataille de Baylen, le 22 juillet 1808, une convention est signée entre le général français Dupont de l’Étang et le général espagnol Castaños. Elle stipule le rapatriement des troupes françaises (environ 16.000 personnes). Les généraux sont transportés par bateaux à Marseille et Toulon pendant que la troupe est acheminée vers Cadix. Incitée par l’Angleterre, la junte de Cadix refuse de ratifier les articles signés à la convention d’Andújar. Au lieu d’embarquer sur des frégates pour rejoindre la France, les perdants sont enfermés sur des pontons (le reste des bâtiments rescapés de la bataille de Trafalgar) au large de Cadix. Répondre à votre question sur les raisons militaires et politiques est très épineux et n’étant pas spécialiste du sujet, je ne m’y risquerai pas. De plus, les points de vue sont mitigés à ce sujet, que l’on soit Français, Espagnol ou Anglais. L’objectivité en histoire, vous savez, est très difficile. Quant aux faits, les voici. L’absence de condition hygiénique sur les pontons favorisait le typhus entre autres qui emportait rapidement les hommes. Les cadavres étaient jetés par-dessus bord et finissaient souvent sur les plages de Cadix. Pour protéger la population du risque d’épidémie, il fallait déplacer les prisonniers. Et puis sur la péninsule, il y avait toujours le risque que Napoléon envoie des troupes pour les libérer. La solution trouvée fut d’envoyer les captifs loin de la péninsule, donc dans les îles (Canaries et Baléares). La junte de Majorque prit la nouvelle assez mal. Pourquoi leur envoyait-on ces pestiférés ? Comment allaient-ils subvenir aux besoins de ces milliers de prisonniers ? La junte de Cadix allait-elle payer les frais ? Où les enfermer ? La condition stipulée par la junte de Majorque fut que si l’on découvrait un seul cas d’épidémie, ils ne les accueilleraient pas sur leur île. Les Espagnols auraient-ils respecté la convention si les Anglais n’avaient pas fait pression pour que l’on ne rende pas ses troupes à Napoléon ? Peut-être. L’historien Denis Smith a voulu parler de la part de responsabilité des Anglais. Les Anglais qui étaient en possession de l’île de Minorque, ne voyait pas non plus d’un bon œil ce débarquement à Majorque. Mais une petite île déserte était parfaite. Les officiers furent donc accueillis à Majorque et les sous-officiers et simples soldats déposés sur l’île déserte de Cabrera. De 1809 à 1814, Cabrera servit de prison à de nombreuses troupes napoléoniennes faites prisonnières en Espagne. Selon Denis Smith, environ 11.000 soldats passèrent par cette prison à ciel ouvert.
Vu ce nombre impressionnant de prisonniers, croyez-vous que le mot « déportation » serait approprié dans ce cas ?
À nouveau, une question délicate. Il faut d’abord savoir ce que l’on entend par le mot « déportation ». Si l’on s’en tient à la définition stricte du mot « déportation », on ne peut pas l’appliquer ici. Il ne s’agit que d’une captivité de prisonniers de guerre, de soldats qui avaient envahi un autre pays. La déportation implique une volonté politique de déplacer toute une catégorie de personnes de leur lieu d’origine (territoire ou pays). Or dans leur cas, ce n’était pas leur « habitat » et même tout au contraire, une terre qu’ils essayaient de conquérir.
Aux côtés de ces officiers et soldats il y a « le personnel de service » et, parmi eux, les femmes – des vivandières et des blanchisseuses – « des citoyennes de bonnes manières », comme vous les appelez. Qui sont-elles ?
Dans la plupart des cas, les vivandières ou les blanchisseuses était de pauvres jeunes filles qui voulaient suivre leur tout jeune mari à la guerre. Il faut se rappeler que la plupart du temps, les soldats n’étaient que de jeunes conscrits. Ou parfois les filles de vieux soldats. Pour éviter l’immoralité dans ses troupes et se débarrasser des services des filles de joie qui suivaient les troupes, Napoléon avait voulu réglementer le nombre de femmes par bataillon (4) ou escadron (2). Elles recevaient une patente, une carte de sécurité et devaient porter une médaille réglementaire. Mais elles ne recevaient aucune solde ni distribution et vivaient uniquement de leur commerce de vivres ou de boissons. Elles devaient être présentes à l’appel du commandant de la colonne comme le reste de la troupe. Leur principale activité était de fournir de l’eau de vie aux soldats durant les batailles et il leur arrivait même quelquefois de secourir les blessés. On disait qu’elles servaient aussi un peu de mère à ces jeunes soldats de vingt ans.
C’est à ces femmes oubliées que vous dédiez d’ailleurs votre roman. Qu’incarnent-elles pour la mémoire et les guerres de cette époque ?
Oui, ce sont à elles que je dédie mon roman. J’ai voulu leur donner la parole. Alors que tous les mémoires des campagnes napoléoniennes sont écrits par des soldats, la plupart du temps des officiers, Héloïse est une vivandière qui écrit ses mémoires. D’ailleurs, certaines vivandières, comme Catherine Balland, reçurent la légion d’honneur sous Napoléon Ier. Vous savez, c’est étrange, mais presque personne aujourd’hui ne sait ce qu’est une vivandière. C’est un mot désuet que l’on a tout à fait oublié. On me pose souvent la question. D’une certaine façon, c’est un peu comme si l’histoire contée aujourd’hui à l’école avait effacé la présence et le soutien des femmes pendant les guerres napoléoniennes et je trouve cela assez dérangeant. Comme si l’importance des femmes dans les guerres avait commencé avec les infirmières de la Première guerre mondiale. Mais c’est peut-être une idée que je me fais.
Le quotidien des prisonniers devient rapidement invivable, dangereux, voire effrayant. Pouvez-vous nous décrire le quotidien de ces prisonniers ?
Je ne vous le dévoilerai pas ici. Pour cela, il faut lire La prisonnière de la mer. Tout y est très précisément décrit.
Dans ce monde de tous les dangers, brille Héloïse Delage, une jeune vivandière de 18 ans qui est votre personnage central. Cette jeune femme dont la force de caractère et la sensibilité sont à la mesure des épreuves de sa vie. Qui est-elle ?
Une simple paysanne de Senlis, qui a suivi son tout jeune mari à la guerre. C’est un personnage de pure invention. Sa mère et sa grand-mère sont au service d’une baronne. Elle a décidé de se marier avec un métayer alors que sa mère aurait voulu la marier à un petit paysan propriétaire. Elle a un peu du caractère de ma grand-mère qui a choisi son propre mari contre les avis de sa famille. Mais aussi, si Héloïse s’appelle Delage, c’est parce qu’elle n’a pas d’âge et que malheureusement encore aujourd’hui dans le monde, il y a des Héloïses qui luttent pour leur vie dans d’effroyables guerres.
Dans ce huit clos à l’immensité de toute une société qui tente de s’organiser malgré les privations et l’enfermement, Héloïse se retrouvera sous la protection de Henri, officier chirurgien. Est-ce une exception sachant que d’autres femmes deviennent souvent des marchandises échangées ou vendues pour peu ? Incarne-t-elle une exception sur ce fond de guerre et de perte de repères ?
Je voudrais bien croire le contraire. Je pense que l’honneur faisait que l’on respectait les femmes des autres et surtout les femmes des gradés. Le problème était quand elles se retrouvaient seules ou que leur propre mari désespéré finissait par les vendre. Peut-être que ces dernières acceptaient aussi l’échange pour sauver leur bien-aimé. Qu’en sait-on ? C’est rassurant pour moi d’imaginer cette version des choses. Mais la réalité décrite dans les souvenirs de guerre est qu’elles passaient souvent de mains en mains, achetées par le meilleur acquéreur. On y utilise des termes comme « commerce infâme » ou « ces malheureuses ». On a qu’à regarder autour de nous aujourd’hui pour voir que les femmes sont encore trop souvent objet de ce genre de commerce en temps de guerre et que le viol est toujours une arme de répression. N’est-ce pas la raison pour laquelle Kahdafi distribuait du viagra à ses soldats ?
«J’ai essayé de vous faire vivre avec Héloïse Delage la captivité de l’intérieur» – écrivez-vous. Cette liberté d’aimer, ne devient-elle une force plus grande que l’enfermement ? Sans dévoiler le dénouement de votre roman, ne peut-on pas dire qu’en suivant librement l’appel de son cœur, Héloïse rapporte sa plus grande victoire sur sa condition de prisonnière et de femme ?
Héloïse est une femme libre et qui a le libre arbitre comme nous l’avons tous dans nos vies. Elle fait des choix, ses choix et les assume. Elle est libre car elle est fidèle à elle-même. Pour moi, c’est ça la véritable liberté. S’écouter, écouter ce que nous dicte nos entrailles. La tête et la peur parfois nous trompent. C’est une leçon que j’ai appris avec les années. Et puis, on peut enfermer nos corps mais jamais nos esprits. Oui, on peut dire qu’en suivant son cœur, elle rapporte sa plus grande victoire sur sa condition de prisonnière et peut-être aussi sur celui de femme.
« La prisonnière de la mer » est votre premier roman. Comment vivez-vous ce moment de rencontre avec le public ? Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Je suis enchantée et surprise par le bon accueil fait à mon premier roman et j’en remercie vivement tous les lecteurs et lectrices. J’ai évidemment un nouveau projet d’écriture et une nouvelle recherche historique en marche. Ce sera la suite de la prisonnière. Vous verrez, on va y découvrir une nouvelle culture et un nouveau continent. C’est passionnant.
Interview réalisée par Dan Burcea
Élisa Sebbel, « La prisonnière de la mer », Éditions Mazarine, 2019, 304p. 18 euros.
Crédits photo: © Miquel Frontera Serra

