
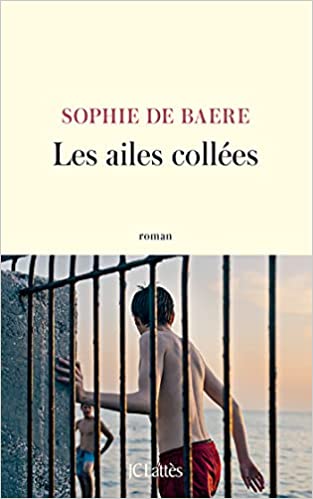 Sophie De Baere publie Les ailes collées, un roman haletant sur les souffrances de Paul, un adolescent enfermé dans l’espace d’un monde « que l’on doit dissimuler » sans ciel, un monde qui n’est pas prêt dans cette période des années ’80 de comprendre et d’accepter sa liaison amoureuse avec Joseph. Plus tard, à l’âge adulte, Paul devra choisir entre cette relation de jeunesse et Ana et son fils Noé. En scrutant le destin de ce héros souffrant, Sophie De Baere explore en même temps le naufrage de toute une famille incapable d’aimer ou tout du moins de dire aux moments cruciaux un amour nécessaire et lénifiant.
Sophie De Baere publie Les ailes collées, un roman haletant sur les souffrances de Paul, un adolescent enfermé dans l’espace d’un monde « que l’on doit dissimuler » sans ciel, un monde qui n’est pas prêt dans cette période des années ’80 de comprendre et d’accepter sa liaison amoureuse avec Joseph. Plus tard, à l’âge adulte, Paul devra choisir entre cette relation de jeunesse et Ana et son fils Noé. En scrutant le destin de ce héros souffrant, Sophie De Baere explore en même temps le naufrage de toute une famille incapable d’aimer ou tout du moins de dire aux moments cruciaux un amour nécessaire et lénifiant.
Le titre de votre roman, Les ailes collées, est sans conteste porteur d’une image d’entrave à la liberté qui condamne Paul, votre personnage principal, à se terrer dans une intimité douloureuse. D’où vient cette douleur et de quoi est-elle le nom, surtout lorsqu’on constate qu’autour de lui s’installe un vide criant d’amour dans le sein même de sa propre famille ? Ne dites-vous pas de lui qu’il est « un être coupé en deux […] refluant la honte et le chagrin » ?
Le titre du roman est bien le synonyme d’une entrave à la liberté. Il est le symbole de l’envol empêché de Paul par rapport à sa mère, à son père mais aussi à sa sœur qu’il se doit de protéger des démons parentaux. Les ailes de Paul sont collées à ce titre mais également au titre de sa sexualité, vécue comme honteuse, interdite. Mon personnage est coupé en deux car partagé entre son envie de s’émanciper et de quitter un foyer maltraitant et celle de continuer malgré tout de porter à bout de bras sa mère et sa petite sœur bien aimées. La douleur naît autant du manque d’amour dont Paul est victime que de ce conflit intérieur qui le mine.
En partant de ce constat de profonde détresse intérieure de votre personnage, pourriez-vous nous préciser quelle a été la source d’inspiration de votre roman et quels ont été les outils qui vous ont permis de passer de cette réalité de vie à la mise en fiction et à l’écriture de votre roman ?
Pour répondre à votre question, la principale source d’inspiration de mon roman est née d’un besoin d’explorer certaines obsessions intimes. C’est quoi aimer ? Qu’est-ce qui est capable de transcender les êtres ? Qu’est-ce qui fait le couple ? La famille ? La filiation ? Comment se reconstruire après un drame qui nous fracasse ? Qu’est-ce qui permet le changement voire la métamorphose d’un être ? Écrire cette histoire correspondait à la nécessité d’épouser certains éléments de ma réalité et de les explorer à travers un personnage, un autre moi-même.
Sur le plan structurel, vous ordonnez votre récit en deux parties qui ont une délimitation temporelle 1983-1984 et 2003-2004 et invoquent, chacune, un titre de chanson. Pourquoi avoir opté pour cette partition périodique et symbolique à la fois dans le développement de votre histoire ?
Ces vingt années d’écart pourraient être considérées comme un siècle tant la société a évolué entre ces deux étés-là ! Paul est un personnage entièrement traversé par ces deux époques. Le Paul de 1983 est l’adolescent d’un temps où l’on s’ennuie, où l’on passe des heures à rêvasser, à se chercher. C’est l’époque du temps long, de celui qui laisse les pensées adolescentes s’entrechoquer, de ce temps où on s’aime encore du bout des mots, en s’écrivant des lettres, en se téléphonant des heures sur un téléphone en bakélite. C’est aussi celui où on se donne rendez-vous sur des petits chemins loin du village, dans des coins sombres, à l’abri des regards : la sexualité adolescente y est vécue très différemment. En effet, le monde de Paul se limite à sa famille, à son collège, à son quartier, à sa ville. Ce n’est pas le monde des années 2000, avec son accès illimité à la connaissance. Paul aime un garçon et ce n’est pas la même chose d’aimer un garçon dans une petite ville en 1983 qu’aujourd’hui. Il n’a pas d’exemples autour de lui. Ni dans sa famille, ni chez ses amis, ni même à la télévision ou au cinéma. Et puis c’est encore bien souvent une sexualité condamnée. J’ai donc voulu mettre ces deux époques en perspective : cet âge des possibles vécu par Paul dans les années 80 et son regard d’adulte vingt ans plus tard, au sein d’une époque bien différente. Qu’a-t-il gardé de cette jeunesse ? En quoi celle-ci a-t-elle façonné l’adulte qu’il est devenu ? Ce sont ces questions qui notamment ont guidé ma réflexion.
Arrêtons-nous d’abord sur la personne de Paul Daumas adolescent, dont nous apprenons qu’il est « ce garçon trop sensible et freluquet que le père et ses amis trouvaient au mieux insignifiant et au pire dérangeant ». Son père n’hésite pas à le qualifier de « Daumas dénaturé. Une anomalie. » Pourriez-vous crayonner son portrait ?
Paul est un adolescent qui a grandi au sein d’une famille qu’on qualifierait aujourd’hui de dysfonctionnelle. Il tente d’exister entre un père taiseux et adultère et une mère qui souffrant de ne plus être aimée, néglige ses enfants et noie son chagrin dans l’alcool. Heureusement, pour égayer le quotidien de sa petite sœur Cécile, il crée un monde imaginaire dans lequel il s’évade avec elle. Ce monde, il l’agrémente de sa passion pour la danse et le piano. Paul aimerait à la fois devenir un John Travolta et un grand pianiste international. Bègue depuis sa petite enfance, ces deux passions l’aident à tenir et lui servent d’exutoire. Chez Paul, la musique et la danse anesthésient la douleur et constituent son refuge. Elles sont le peau à peau qu’il n’a pas eu avec sa mère. Ou encore le lien avec le monde extérieur dont son père refuse d’être le relai. Sa sensibilité et sa douceur font de Paul « une anomalie » au sein de cette famille bourgeoise très codifiée. Et particulièrement pour Charles, le père qui, de par son histoire, se doit d’être un homme dur et lointain avec ses enfants.
Avant d’aborder le thème central de votre roman, j’aimerais soumettre à votre attention un mot qui décrit, selon moi, le fond, la fondation-même de votre fil narratif. Ce mot est le naufrage affectif entre amour et désamour du couple de Charles et Blanche Daumas, les parents de Paul, incapables de s’aimer et de répercuter ainsi l’amour ô combien nécessaire à leurs enfants Paul et Cécile. Êtes-vous d’accord avec ce constat et peut-on l’étendre – avec toutes les précautions nécessaires – à toute une génération de cette période charnière des années ’80 ?
Le couple des parents de Paul est assez symptomatique de cette époque. Le père a des maîtresses, la mère boit et s’abrutit de feuilletons sirupeux mais ils restent ensemble, tentant de faire illusion durant de nombreuses années. Le père au nom d’un idéal bourgeois et moral. La mère au nom d’un idéal romantique et aussi parce qu’elle dépend complètement de son mari, pas seulement financièrement mais aussi psychologiquement : Blanche attend que tout vienne de Charles et d’ailleurs Charles est tout pour elle. Charles est celui qui est tourné vers l’extérieur, qui détient le pouvoir : il ramène l’argent du foyer, participe à la vie municipale de sa ville, part à la chasse entre hommes tous les dimanches, trompe sa femme. Blanche, elle, n’a d’autre choix que de demeurer à l’intérieur du foyer : elle ne travaille pas, doit s’occuper de ses enfants, de sa maison, de son jardin, subir les cancans du quartier et préserver coûte que coûte la réputation de sa famille. Les deux personnages sont malheureux ensemble mais ils vont pourtant attendre des années avant de se séparer et s’autoriser enfin à vivre une existence différente. Et ce mal-être conjugal va avoir des répercussions tragiques sur Paul et Cécile. Trop englués dans leurs problèmes de couple, centrés sur leurs frustrations du moment, ils vont en oublier d’aimer leurs propres enfants. Ou plutôt, ils vont les aimer mal. Dans cette France des années 80, combien de couples sont ainsi restés mariés par peur et par conformisme et ont, de fait, imposé à leurs enfants le triste spectacle d’un homme et d’une femme finissant par s’étioler totalement ?
Considéré par lui-même comme un accident – tellement l’histoire amoureuse qui se noue entre lui et Joseph lui fait peur et le secoue en même temps – cette relation s’inscrit dans un rituel qui défie l’ordre établi. Ella va déclencher de la part des collègues de Paul une avalanche d’insultes verbales et physiques d’une violence inouïe. À ce sujet, permettez-moi de citer ces phrases tirées de votre roman : « La jeunesse peut être une guerre silencieuse, un champ de bataille où des enfants d’à peine quinze ans sont capables de tuer à bout portant leurs camarades. Et cela, sous les yeux des adultes qui sont censés les protéger ». Que pouvez-vous nous dire de ce drame qui se déroule impunément sous les yeux de tout le monde ?
Je voulais parler de ce drame, de cette cruauté vécue encore aujourd’hui par de trop nombreux adolescents. Parce que j’en ai moi-même été victime mais aussi et surtout parce que j’en ai été le témoin, à plusieurs reprises. Mais j’ai 44 ans et il y a trente ans, on n’en parlait pas. C’était normal, presque « formateur », voire un passage obligé. Il fallait faire avec, serrer les dents. Il n’y a qu’à lire les livres classiques sur le sujet. Le petit chose, Poil de carotte, Le grand Meaulnes, Sa Majesté des mouches, Le petit Nicolas, Les désarrois de l’élève Torless regorgent d’exemples où l’enfant, le collégien est raillé, moqué, où les plus forts s’allient contre les plus faibles. Dans les années 80/90, beaucoup étaient encore dans ce schéma-là. Cette maltraitance faisait presque partie des apprentissages. La jeune victime avait honte, n’en parlait pas ou très peu. En 1983, le statut de l’enfant et de l’adolescent n’était pas le même qu’aujourd’hui, notamment au sein des familles. On était bien loin de l’enfant roi ! Dans cette France rurale des années 80, l’amour entre un père et son fils était généralement taiseux, pudique. La parole était bien plus avare. Il s’avérait donc difficile pour un adolescent de se confier à ses parents au sujet de brimades, et encore plus compliqué pour lui de leur parler de sa sexualité.
Même les mots – sans parler donc de la force physique – manquent à Paul qui souffre de bégaiement, surtout dans ses moments d’angoisse et de solitude. Impossible pour lui de répondre aux insultes de ses collègues. « Quand on n’a plus les mots, on ne possède plus rien », pense-t-il. Quelle importance a selon vous cette parole dans ce genre de situations de détresse à la fois pour se la dire à soi-même et pour l’entendre dire de la part de son entourage ?
Ce roman est le roman des silences, de ceux qui enferment, qui empêchent l’envol, qui font mal et peuvent même faire d’une vie une tragédie. Paul est bègue et cette privation de mots , ce silence forcé, le condamnent à bien des égards. Comme vous l’évoquez si justement, son bégaiement l’empêche de se dire, de se défendre de la violence dont il est victime. Mais cette difficulté d’expression est aussi paradoxalement une richesse car elle va conduire Paul à extérioriser autrement ses émotions. A travers la danse et la musique, le silence va être transfiguré par le mouvement, la beauté d’un geste ou d’une note. L’émotion peut passer par le corps de Paul, par sa musique. D’ailleurs, c’est uniquement par la danse que le jeune homme parvient à communiquer avec Blanche. Et c’est très beau. Le silence a également ses vertus puisqu’il va faire de Paul un adolescent puis un adulte particulièrement empathique, sensible et riche de bien d’autres choses.
Plus tard, à l’âge adulte Paul trouvera un équilibre précaire dans l’amour d’Ana et dans la venue au monde de leur fils Noé, prénom ô combien annonciateur d’un monde renouvelé. Est-ce que cette perspective de vie nouvelle est pour lui un signe de résilience ? Dans quelle mesure la présence de ces êtres chers est-elle nécessaire pour l’aider à guérir, à « rejoindre une vie qui attend et faire table rase de sa propre histoire », comme il le dit lui-même ?
Ana et Noé sont les deux personnes qui vont en effet permettre à Paul de véritablement se construire un socle à partir duquel il pourra enfin déployer ses ailes. Leur amour inconditionnel va le défaire des croyances limitantes qui le tenaillaient depuis l’enfance et ainsi l’aider à achever sa résilience.
N’oublions pas d’évoquer la figure lumineuse d’Ana, une personne « honnête, loyale et généreuse ». À travers elle, Paul espère retrouver « un irrésistible cocon » et mettre fin au passé de « petit garçon élevé dans les égoïsme et les errements conjugaux de ses parents ». Quel regard jetez-vous sur cette présence féminine ?
Ana est cette personne qui va le rassurer, lui offrir ce qu’il n’a pas eu durant l’enfance : une épaule protectrice, une véritable attention, des certitudes affectives. Cette femme joue d’ailleurs un rôle central dans la libération de Paul mais aussi dans le chemin de pardon et de réconciliation qu’il va construire puis emprunter avec sa famille et qui vont l’amener à être « vrai ».
Pour finir, accrochons-nous aux paroles d’Ana « Il faut croire que tout peut toujours recommencer ». Loin d’exprimer une convention vide de sens, ces mots renvoie dans l’esprit de cette jeune-femme la lumière d’un espoir renouvelé dans la dignité humaine. Confirmez-vous que cette formule pourrait être la conclusion de votre bouleversant roman ?
Ce roman est d’abord un roman sur les liens, de ceux qui abîment bien sûr mais aussi de ceux qui sauvent et poussent à pardonner, à se réinventer. Vous avez donc raison : Les Ailes collées est d’abord un texte d’espérance.
Propos recueillis par Dan Burcea
Sophie de Baere, Les ailes collées, Éditions JC Lattès, 2022, 384 pages.

