
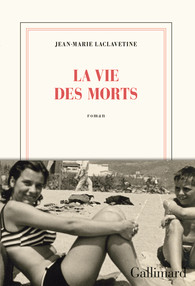 La vie des morts de Jean-Marie Laclavetine fait partie de ces livres qui se nourrissent de la sève d’une souche portée déjà par le tuteur d’un ouvrage publié 2 ans auparavant sous le titre Une amie de la famille. Les deux parlent d’Annie, disparue accidentellement le 1er novembre 1968, emportée par une vague sur une plage de Biarritz. Cinquante ans après ce drame, l’auteur tente de redonner vie aux souvenirs d’une époque qui n’appartient plus qu’à un « tombeau de silence » où gît désormais cette grande sœur absente. Arrivera-t-il à lever cette malédiction et prononcer enfin son nom ? C’est tout le sens de ce récit plein d’émotion sous l’empreinte d’une présence qui n’ose s’écrire qu’avec une timide plume par le petit frère qu’est Jean-Marie Laclavetine.
La vie des morts de Jean-Marie Laclavetine fait partie de ces livres qui se nourrissent de la sève d’une souche portée déjà par le tuteur d’un ouvrage publié 2 ans auparavant sous le titre Une amie de la famille. Les deux parlent d’Annie, disparue accidentellement le 1er novembre 1968, emportée par une vague sur une plage de Biarritz. Cinquante ans après ce drame, l’auteur tente de redonner vie aux souvenirs d’une époque qui n’appartient plus qu’à un « tombeau de silence » où gît désormais cette grande sœur absente. Arrivera-t-il à lever cette malédiction et prononcer enfin son nom ? C’est tout le sens de ce récit plein d’émotion sous l’empreinte d’une présence qui n’ose s’écrire qu’avec une timide plume par le petit frère qu’est Jean-Marie Laclavetine.
En 2019, vous écriviez dans Un amie de la famille cette phrase qui renvoie au mécanisme de la mémoire : « Que reste-t-il du passé, que pouvons-nous récupérer en pêchant au petit bonheur dans l’eau profonde des souvenirs ?» Deux ans plus tard, dans votre deuxième récit, La vie de morts, vous continuez cette recherche mémorielle pour tenter de sauver de l’oubli ce que vous appelez, en vous adressant à Annie, votre sœur, « la persistance de ton image sur nos rétines ». Doit-on comprendre que le moteur de l’écriture de ces deux livres a été cette même nécessité criante de donner forme à ce souvenir ?
Ce souvenir particulier – la mort accidentelle de ma sœur et le silence prodigieux qui a enseveli la famille pendant un demi-siècle – a été, sans que j’en aie conscience, le puissant moteur de l’écriture de chacun de mes livres. Il y avait là un mystère indicible, fascinant, une béance vers laquelle je retournais constamment par le biais de l’écriture. Il m’était impossible de nommer ce mystère et de l’affronter tant que mes parents étaient vivants. Leur mort a rendu possible cette rencontre pacifique avec le passé : je n’avais plus à craindre le spectacle de leur immense douleur dès que l’on prononçait le prénom d’Annie.
Diriez-vous que vos deux livres se suivent comme deux tomes d’un même ouvrage, même si les deux récits n’ont pas les mêmes perspectives narratives ni le même type de discours ?
Ces deux livres sont pour moi indissociables. Le premier raconte l’invention, au sens archéologique du terme, d’un événement, d’une personne, d’une époque. Le second décrit les effets inattendus de cette publication : tout ce que la littérature a permis, ce partage, ces rencontres, ces correspondances, ces retrouvailles. C’est bien le travail de la littérature qui est au cœur des deux livres, comme un moteur à double carburation.
Que pouvez-vous nous dire de votre état d’esprit au début et pendant l’écriture de ce second livre dont vous affirmez qu’il s’est écrit « dans une joie tranquille » et, en même temps, avec « le besoin de tout dévorer » ?
La vie des morts m’a apaisé, en effet. Il m’a permis de rassembler les souvenirs joyeux de tous ceux que j’ai aimés et qui se sont écartés. Il m’a fait toucher du doigt la proximité de ceux que l’on nomme à tort des « disparus ». Leur présence est effective, chaleureuse, obstinée, réconfortante.
Pour donner le titre de votre livre vous reprenez la formule La vie des morts que votre père, dites-vous, la murmurait « en laissant errer son regard parmi les nuages ». Pourquoi avoir choisi cet oxymore pour nommer votre récit ?
Le titre s’est imposé comme une évidence. Cette formule souvent reprise par mon père est simple et profonde. Il ne s’agit pas d’une croyance mystique, d’un recours désespéré à l’irrationnel pour compenser la perte. Les morts sont avec nous, en nous, autant ou presque que les vivants, présents aussi comme tous les personnages de la littérature qui nous ont accompagnés et façonnés tout au long de nos existences.
« L’écriture aurait-elle le pouvoir de ressusciter les morts ? », vous posez-vous la question. Vous touchez ainsi un aspect essentiel de la condition de l’écrivain. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette mission que vous vous appropriez afin de rendre compte « du sens de notre présence au monde » ?
La littérature permet ce miracle : non pas de ressusciter les morts, mais d’abolir les frontières entre le présent et le passé, entre les vivants et les morts, entre les classes sociales, les langues, les pays. Elle est un prodigieux outil de connaissance de l’univers.
Quelque pages plus loin, vous qualifiez la littérature de « force silencieuse » capable de favoriser la propagation des souvenirs que vous matérialisez par une longue liste d’amis disparus. En ce sens, est-ce que votre livre pourrait être lu comme une litanie des amis disparus, « ces fantômes errants », ce « panthéon portatif » abritant des gens comme Guy, Michel-Jean, Georges Lambrichs et tant d’autres dont la mémoire les fait déjà rentrer dans la légende ?
Oui, j’ai eu envie de convoquer ce petit cénacle tendre et souriant, de rassembler tous ces êtres aimés pour les faire connaître à ma sœur, en quelque sorte. Une réunion de famille élargie aux amis : parce que la vie, pour finir, est toujours victorieuse…
Une autre image qui offre toute sa force à la présence de la figure protectrice de la grande sœur disparue est celle de l’appel incessant qu’elle vous adresse de l’au-delà. Vous écrivez : « C’est toi qui vis, et moi qui suis mort, prêt enfin à ressusciter par la force du verbe – et de quelques adjectifs ». Comment interpréter cette inversion des rôles qui efface les frontières entre la vie et la mort ? Pensez-vous que tout serait perdu sans les mots pour le dire ?
Les mots sont le flux vital essentiel qui circule entre les vivants. Ils se perdent dans le sable du réel quotidien, seule la littérature a le pouvoir de leur faire traverser le temps.
Figure symbolique de l’absence inconsolable, Annie devient selon un lecteur « le visage universel de nos douloureuses absences ». Pensez-vous que la perte de l’être cher engendre en même temps une perte de nous-mêmes ?
Rien ne se perd vraiment. La mort d’un être cher nous arrache une partie de nous-mêmes, mais elle permet aussi une renaissance, et nous fait naître à ce que nous ignorions de nous, elle nous permet de trouver des forces là où ne serions pas allés les chercher.
Marraine, votre grand-mère, dit que nous portons en nous « nos propres cimetières ». Peut-on parler dans ce cas d’un deuil impossible ? D’ailleurs, le mot deuil est quasi inexistant dans votre récit. Comment expliquer cette omission ?
Cette omission n’est pas délibérée ! Mais votre remarque m’intéresse… Je suis méfiant vis-à-vis de cette notion de deuil, qui semble suggérer une réparation possible, on « fait son deuil » et la page est tournée… Or ce n’est pas ainsi que cela se passe. La mort continue de travailler en nous, et c’est aussi un bien, une richesse, une ouverture. Les cimetières en nous sont un poids de souffrance, mais pas seulement : car c’est aussi la souffrance qui nous rappelle à la vie, qui nous évite l’anesthésie commune.
Enfin, une dernière question pour reprendre ici l’image de ceux que vous appelez « des frontaliers ». À vous entendre, ce fil est ce qui nous lie plus à la vie qu’à la mort. Est-ce qu’aujourd’hui vous sentez-vous par ce livre réconcilié avec cet équilibre nécessaire entre ces deux réalités ?
Réconcilié, non, parce que je n’ai jamais été en guerre. La mort ne me révolte pas, je ne la trouve pas « scandaleuse », comme on entend souvent dire. Je me sens plus ouvert à cette dimension particulière de la vie qui est la mort.
Propos recueillis par Dan Burcea
Photo de Jean-Marie Laclavetine, © Jean-Luc Chapin
Jean-Marie Laclavetine, La vie des morts, Éditions Gallimard, mars, 2021, 208 pages.

