
Qui êtes-vous, où êtes-vous née, où habitez-vous ?
Je suis écrivaine française d’origine indienne. Je suis née à Calcutta. Après avoir vécu dix-huit ans à Paris, je vis désormais en Bretagne.
Vivez-vous du métier d’écrivain ou, sinon, quel métier exercez-vous ?
Oui, depuis 2016 je vis de mon métier d’écrivaine.
Auparavant, j’ai été professeure d’anglais contractuelle dans des lycées et collèges dans la région parisienne, traductrice et interprète pour les demandeurs d’asile bangladais.
Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?
J’ai grandi dans des bibliothèques. Celle de chez moi, celle de mon lycée.
Mes parents étaient professeurs, ma mère enseignait les mathématiques dans un lycée (où j’ai été élève par la suite) et mon père, marxiste, économiste, enseignait l’économie dans un organisme comparable à Sciences Po de Paris. Nous n’étions aucunement riches mais mes parents achetaient beaucoup de livres, non seulement la littérature bengalie et indienne, mais du monde : russe, américaine, africaine, française, espagnole, italienne, chinoise, en traduction anglaise et bengalie.
Nous voyagions aussi beaucoup à travers l’Inde chaque année. Découvrir la diversité linguistique, culturelle, religieuse dans mon pays natal a été le fondement de mon éducation.
Comme certains commencent à nager, à jouer au foot ou au violon très tôt dans leur enfance, j’ai commencé à écrire, en bengali, très jeune, vers sept ou huit ans, poussée par une irrépressible envie d’imitation. Une mécanique s’est installée à l’intérieur de mon corps et a commencé à fonctionner. Mes doigts étaient impatients et heureux de manier les mots.
Écrire d’abord des poèmes, puis des nouvelles, tenir un journal intime, publier un premier poème à quatorze ans dans le journal Ganashakti, comparable à l’Humanité du Bengale occidental, recevoir le prix du meilleur jeune poète dans un concours régional… commencé ainsi, plus tard j’ai écrit des poèmes en prose, publié dans des revues littéraires, jusqu’à vingt-cinq, vingt-six ans.
À l’âge de vingt-deux ans, j’ai commencé à apprendre le français. J’ai complété le programme de trois ans de l’Alliance française, puis une maîtrise en littérature et linguistique françaises.
À vingt-huit ans je suis arrivée à Paris, invitée par l’ambassade de France en Inde en tant qu’assistant d’anglais dans des collèges dans la région parisienne.
Les trois années suivantes j’ai complété une autre maîtrise et un DEA (Master2 recherches) en Lettres modernes de Paris-4 Sorbonne, traduit et publié trois anthologies de poésie française et bengalie contemporaine en collaboration avec mon ex-mari, poète, Lionel Ray.
En 2008, à trente-cinq ans, j’ai publié mon premier roman, plutôt un récit, en français. Depuis, écrire en français est devenu mon mode vie, ma façon d’être et ma raison d’être.
Quel est l’auteur/le livre qui vous ont marqué le plus dans la vie ?
Très difficile de choisir un seul auteur. Je dirais Tagore, Gorki (Sa trilogie autobiographique : Enfance, En gagnant mon pain, Mes universités), Le Fer de Nicolaï Ostrovski, Stendhal (Le Rouge et le Noir), Apollinaire, le poète bengali Joy Goswami …
Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?
J’écris des romans. Je suis un poète raté. Mais je viens de la poésie, tout ce que je ne sais pas dire sous la forme poétique reste comme le sédiment dans mes romans, irrigue mes romans comme des rivières souterraines.
Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?
Mis à part mon premier roman/récit, tous les autres, cinq au total, je les ai écrits d’un trait. Les séances de travail durent des heures, toute la journée, souvent toute la nuit, après trois jours de travail suivant ce rythme, le quatrième jour je dois me reposer. Puis ça reprend.
Mon premier roman, je l’ai écrit à la première personne. Les autres, à la troisième. Ou en inversant les rôles : me glissant dans la peau des personnages composés de part réel et de part fictive, et les présenter à la première personne ; et le personnage féminin qui me ressemble, par besoin d’une autre perspective, je l’ai présenté à la troisième.
D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?
Mes romans sont tous inspirés largement et librement de la réalité environnante, de l’Histoire politique de mon pays natal, de la condition socio-politique de la France. Mais je n’écris pas dans la continuité de la réalité et propose une version altérée du réel.
Je parle de moi pour parler du monde. Je prête mon corps et mes souvenirs, j’y ajoute des parcelles inventées pour composer un personnage romanesque, pour tisser le lien entre l’intime et la mémoire collective. Pareil pour les autres personnages de mes romans, certains sont totalement fictifs, d’autres sont des recompositions.
Un romancier est aussi un peu un archiviste, un historien, qui conserve dans son livre les événements historiques, politiques, sociaux, et les altère, les vulgarise, les transcende. Un roman ancré dans le contexte historico-politique porte en lui les éléments d’une uchronie partielle, fragmentée.
Aussitôt après avoir bouclé un texte, soumis à l’éditeur, je commence un nouveau projet. L’écriture dure entre huit et dix mois.
« …ce n’est pas avec des idées qu’on fait des vers, mais avec des mots. » La déclaration de Stéphane Mallarmé au sujet de la poésie est valable aussi pour l’art romanesque.
Les idées me trottent déjà dans la tête depuis un moment, mais c’est en écrivant que je découvre ce que j’ai à écrire. Le sujet est un prétexte, un point de départ, pour aller ailleurs, pour explorer autre chose, ce que seulement les mots écrits peuvent proposer.
Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?
Non, je trouve le titre à la fin de l’écriture ! Seulement pour Apatride et pour mon nouveau récit soumis à mon éditeur, j’avais déjà le titre, longtemps avant de commencer l’écriture.
Le titre est très important, il annonce, résume, attire l’attention. Comme cela était le cas pour Assommons les pauvres, emprunté du poème en prose de Baudelaire. Le testament russe : évidemment j’ai pensé au chef-d’œuvre d’Andreï Makine : Le testament français.
Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?
Dans mes romans je vais à la rencontre des personnages, je les suis dans leur trajectoire. Même si un personnage central féminin qui me ressemble est présent dans tous mes romans, autour d’elle se gravitent de nombreux personnages de composition, tissés de part réelle et de part fictive. Aucun de ces personnages, y compris le personnage central féminin, n’est ni complètement bon, ni complètement mauvais. Ils gardent tous leur part d’ombre, de doute, de faille, de fissure. Tous terriblement humains. C’est-ce qui m’intéresse dans mon travail romanesque : trouver le point de jonction entre l’obscurité et la lumière.
Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.
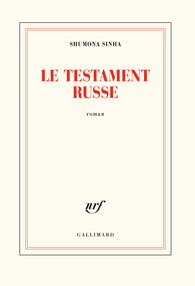 Mon dernier roman est Le testament russe (Gallimard/Blanche, mars 2020)
Mon dernier roman est Le testament russe (Gallimard/Blanche, mars 2020)
J’ai un amour étouffé pour la Russie. Les vieux exemplaires abîmés des livres russes m’accompagnent depuis que je vis en France. Ils représentent les totems de mon enfance.
Ce n’est pas si exceptionnel, vu que le Bengale occidental a été gouverné par le parti communiste pendant trente-quatre ans, vu que la littérature russe et soviétique a été largement traduite dans plus de cinquante langues, dont bengali et d’autres langues indiennes et a été diffusée dans le monde entier.
Je voulais rendre hommage à cet héritage littéraire, à cette relation affectueuse entre le Bengale et la Russie. Ainsi, je suis partie à la recherche des écrivains et éditeurs juifs russes de la littérature de jeunesse sous le régime soviétique et j’ai découvert une très brève notice biographique de Lev Moisevitch Kliatchko, éditeur et fondateur des Éditions Raduga dans les années 1920. J’ai été bouleversée par son destin tragique.
Ce roman est la rencontre imaginaire entre Tania qui me ressemble, qui a vécu dans les années 1980, 1990 à Calcutta, et Adel, fille de Lev Moisevitch Kliatchko.
J’ai mené une quête sans fin, addictive, obsessionnelle dans les archives, journaux, revues, sur Internet, films, documentaires, chansons, principalement russes, un peu américains.
Puis je m’en suis éloignée. À part quelques faits réels, j’ai réinventé le personnage de Lev Moisevitch Kliatchko et celui d’Adel, leur état d’âme, leurs pensées et leur souffle.
Un récit sur ma francophonie sera publié prochainement, édité par mon éditeur Jean-Marie Laclavetine.
Et je viens de commencer un nouveau roman, de la pure fiction, mais la pureté existe-elle ? Ou encore, devrait-elle exister ?
Photo de Shumona Sinha : ©Patrice Normand

