
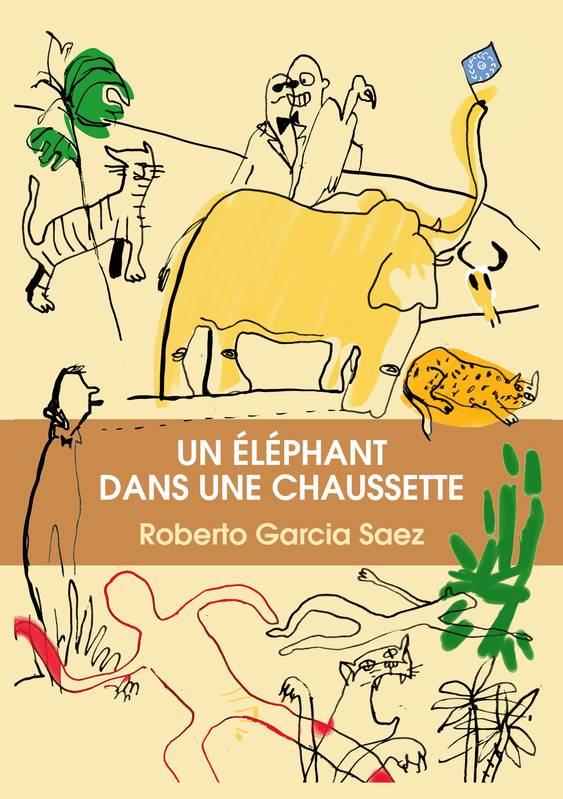 Comment mettre un éléphant dans une chaussette, surtout lorsque celle-ci devient « une camisole de force », dans un environnement où « tout le monde se méfie de tout le monde et personne ne veut prendre le moindre risque » ? Résumée ainsi, la métaphore de la différence entre le contenant (le bas en tissu) et le contenu (le pachyderme) semble signifier ce qu’il y a de plus inconfortable, voire d’impossible.
Comment mettre un éléphant dans une chaussette, surtout lorsque celle-ci devient « une camisole de force », dans un environnement où « tout le monde se méfie de tout le monde et personne ne veut prendre le moindre risque » ? Résumée ainsi, la métaphore de la différence entre le contenant (le bas en tissu) et le contenu (le pachyderme) semble signifier ce qu’il y a de plus inconfortable, voire d’impossible.
Et pourtant, Patrick Roméro, le personnage du roman Un éléphant dans une chaussette (Ed. Atramenta) de Roberto Garcia Saez, est convaincu d’arriver à résoudre cette équation impossible. Dans quel contexte ? Comment ? Avec quelles conséquences ?
Faisons connaissance avec cet auteur qui occupa pendant longtemps des postes de fonctionnaire international dans différentes institutions.
Un éléphant dans une chaussette est en réalité la première partie d’un diptyque narratif, la seconde partie portant le titre de Dee Dee Paradize. Comment sont nés ces romans ? Quelles ont été vos sources d’inspiration et pourquoi dites-vous qu’il s’agit d’une « œuvre de fiction inspirée d’une histoire vraie ».
Dans le premier volet, tout est presque vrai et dans le second, tout est faux (ou presque)… J’ai fabriqué l’histoire du premier et le personnage principal de Roméro à partir de mon expérience dans le monde du développement et en particulier dans les coulisses des Nations-Unies. Dans ce que j’appelle la « Maison bleue», j’ai été confronté à des discours merveilleux, des ambitions généreuses, des idéaux beaux à pleurer et, dans le même temps, parfois incarnés dans une même personne, à des trésors de pinailleries bureaucratiques. Parfois pire d’ailleurs, à une sorte de stalinisme inquisiteur et destructeur pour mettre au pas sinon éliminer ceux qui sortent du crédo des sacro-saintes procédures.
La communauté internationale a donné à l’ONU pour mission de faire le bien, d’en finir avec les guerres, la discrimination, la pauvreté, les maladies, etc., – oui, rien que ça – et l’inonde pour cela de milliards de dollars en exigeant une transparence totale appelée « tolérance zéro ». D’où des procédures alambiquées de contrôle, lesquels dans certains cas, paralysent les projets de développement et peuvent entrainer des catastrophes humaines. C’est que j’appelle la dictature de la transparence et le premier volet du dyptique, qui a eu d’abord pour titre « Onu soit qui mal y pense », est né de ma colère contre cette pratique.
Mais attention, qu’on ne se méprenne pas : je ne suis pas hostile au multilatéralisme qui est l’ADN de l’ONU. Bien au contraire, et je vais le dire sans détour, les souverainismes étriqués et les nationalismes énervés ont conduit l’humanité, et la conduiront s’ils triomphent, à la catastrophe. Dans le domaine sanitaire, la lutte contre les pandémies comme le sida, le paludisme, le Covid-19, etc. illustre on ne peut mieux la nécessité d’un travail en concert.
Donc, dans le premier livre, il est d’abord question de faire la peau à un multilatéralisme qui marche mal parce qu’il a peur de son ombre car il se sait sous la surveillance de tous ceux qui rêvent de le liquider pour qu’ils puissent faire tourner le monde comme ils l’entendent sans avoir à se soucier des pauvres et de la misère des autres.
J’ai donc créé ce Roméro, avec ses grandes envolées idéalistes et ses petits états d’âmes de bobo qui veut qu’on l’aime, pour porter ce combat dans le premier livre et pour qu’il le gagne. Cela en fait-il un héros positif, un chevalier blanc ? Se battre pour le bien fait-il de quelqu’un un homme bien ? C’est pour explorer cette voie que le deuxième livre s’est imposé presque naturellement. J’ai dit que dans le premier tout était vrai ou presque et que dans le second tout était faux ou presque. Mais en en fait cela revient au même. Tout individu est, littéralement, un personnage de roman dont la survie nécessite une part de mensonge.
Un éléphant dans une chaussette est une réédition du livre ONU soit qui mal y pense publié en 2011 aux Éditions des Étoiles. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette évolution éditoriale et sur les éventuels changements opérés ?
Il s’est passé presque 10 ans entre les deux éditions et pour faire Un Eléphant dans une chaussette…, j’ai en quelque sorte dégraissé le mammouth. Je l’ai voulu moins didactique que son premier jet, qu’on entende moins le fonctionnaire international que j’étais et davantage le grain de folie qui habite les personnages.
Revenons, si vous le permettez, à votre roman Un éléphant dans une chaussette et parlons de son héros, Patrick Roméro, quadragénaire, travaillant pour une agence de l’ONU en Afrique. Un vrai téméraire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, que pouvez-vous nous dire de ce personnage ? Quel est son modèle dans le monde réel qui semble vous avoir inspiré ?
Il est de ces gens dont on se dit qu’ils sont trop bons, trop beaux, pour être honnêtes même si ils le sont vraiment et c’est son drame et le drame de ceux qu’il séduit ou horripile. Il n’a pas vraiment de modèle dans la vie réelle. Un bout de Tapie, un grain de Kouchner, un doigt de DSK, un zeste de James Dean, voilà ce que donnerait probablement son autopsie. C’est un mâle, blanc, qui se débrouille plutôt pas mal dans la vie et qui a au moins une qualité : il n’a pas l’indécence de trop geindre sur son propre sort comme beaucoup de ses contemporains au profil semblable.
Le thème central de votre roman est, à mon sens, digne de l’intrigue d’une pièce de théâtre : la confrontation entre deux attitudes opposées, conflictuelles, entre la volonté d’agir pour un but honorable et la méfiance usurpatrice, abusive. « Tous les chiens sont lâchés » contre votre héros, écrivez-vous. Seriez-vous d’accord avec cette perspective et, si oui, que pouvez-vous nous dire de cette vision manichéiste qu’inspire votre roman ?
La nature humaine est complexe et le bon et le mauvais cohabitent en chacun, selon des dosages variables. Mais j’ai souvent envie de jeter le relativisme ambiant par la fenêtre. Les intégristes religieux, dehors ! Les racistes, qu’ils soient blancs, noirs, jaunes ou autres, dehors ! Les nationalistes belliqueux, dehors ! Et la liste n’est pas exhaustive de ces tordus qui empoisonnent l’humanité. J’assume une vision manichéiste qui juge les autres à partir de ce qu’ils font vraiment dans leur vie pour le bien commun de l’humanité toute entière et pas d’une portion de l’humanité. Les pires bourreaux agissent au nom du bien. Le plus dramatique – et peut-être désespérant – est que le travail mémoriel fait autour des horreurs qu’a connues l’humanité du fait des humains eux-mêmes n’a pas de prise sur ces gens-là. Cela ne doit pas empêcher d’agir pour endiguer leur capacité de nuisance. Dans la vraie vie comme dans la fiction.
Quelle est donc cette mission confiée à Patrick Roméro en République démocratique du Congo, et pourquoi l’appelle-t-il « mettre un éléphant dans une chaussette », ce qui donne le titre de votre roman ?
Le livre se déroule à une époque où la pandémie du sida faisait rage en particulier dans les pays en développement. Les millions venus des pays riches pleuvent sur les pays pauvres pour y éteindre cette pandémie, seul moyen pour les premiers de s’en protéger. Patrick Roméro se voit donc confier un budget colossal de 250 millions de dollars pour bâtir un programme onusien d’élimination du sida au Congo, gigantesque pays où rien ne va parce que toute la planète veut le dépecer de ses richesses faramineuses avec la complicité de potentats locaux. Pour parvenir à ses objectifs dans ce contexte marécageux, Roméro sait qu’il en bavera autant que s’il devait faire rentrer un éléphant dans une chaussette. Il y est prêt quitte à tordre le cou aux procédures habituelles de la maison bleue dont le respect pointilleux se paierait en vie humaines. Un flic pointilleux en est persuadé, ce type la en croque, et il le traque.
L’humanitaire ne peut se faire, selon Roméro, que si l’on comprend l’urgence d’agir pour sauver des vies. Ce n’est pas l’avis des procéduriers de l’ONU. Ne s’agit-il pas en fait du nœud de cette problématique qui consiste à négocier le travail de terrain et les contraintes d’un « immobilisme assassin » ?
Je vais faire court et brutal. Cela ne se discute pas : dans l’action humanitaire, les procédures doivent être au service de l’urgence.
En parlant de l’urgence de sauver des vies, vous créez un personnages inoubliable dont la souffrance traverse votre roman. Il s’agit de Kymia, vrai symbole de toute une population pour laquelle se bat Roméro. Pouvez-vous nous parler de ce personnage ?
La vie est ainsi faite que certains naissent pauvres et dans des endroits hostiles, que ce soit du fait de la nature ou de l’action humaine. Faut-il leur dénier le droit à la dignité humaine ? D’autres, qui ont eu la chance de « bien » naitre, ont l’audace de faire aux pauvres un procès en responsabilité. Que ceux-là sortent de leur confort et de leur arrogance et qu’ils se taisent. Kymia, comme l’immense majorité de ceux qui ont besoin de l’aide humanitaire, n’a pas choisi sa situation et ne demande pas la charité. Elle demande seulement l’accès à des services que l’on considère ailleurs comme le minimum vital en-dessous duquel la dignité est bafouée. Un droit ici n’en serait pas un là ?
Patrick Romero n’est pas seulement touché par les pauvres comme Kymia mais aussi par ceux et celles frappées de discrimination et/ou écorchées par la vie. Le personnage de Dee Dee en est l’incarnation. Gay, noir, congolais, il se bagarre pour exister librement, ce qui fascine notre héros, et, d’une certaine façon aussi, l’auteur que je suis. Des lecteurs se sont montrés énervés que je choisisse un personnage avec un tel profil pour en faire une victime. Sous-entendu : les blancs-hétérosexuels peuvent aussi être victimes de discrimination alors arrêtez de vous soumettre à la dictature des soi-disant minorités comme les LGBT. Encore un bel exemple du relativisme de la pensée dans lequel les réseaux sociaux nous embourbent.
Entre en scène le policier Paul Harrisson. Selon lui, la manière d’agir de Roméro mène vers des malversations, surtout qu’il s’agit de sommes faramineuses d’argent. Il suffit de lire ses conclusions (p. 177) suite « à un laborieux travail d’analyse et de documents administratifs et financiers ». Vous créez un personnage qui agit plus sur ses convictions personnelles que sur la réalité. De quoi ou de qui, ce Paul Harrisson est-il le nom ?
Paul Harrisson représente l’ordre placé entre les mains de gens qui se gargarisent de leurs bonnes intentions mais dont le jugement est altéré par ce qu’ils appellent faussement « le bon sens » et/ou, pire, par la jalousie et l’aigreur. C’est avec le sourire, la conscience tranquille et le sentiment du devoir accompli qu’ils vous envoient à la guillotine. Et ce sont généralement de bons pères de familles qui feront des grands-pères attendrissants. Malheureusement, leur existence ne relève pas de la fiction.
Un autre personnage qui impressionne par son humanité et sa sagesse est le Résident Ismaël Ousmanne Diallo. Je ne peux pas m’empêcher de vous demander si cet homme existe-t-il en réalité ou seulement dans la fiction, tellement il est juste et digne ? Avez-vous bénéficié d’un modèle pour le créer ?
Peu de temps avant que j’ouvre le chantier de ce livre, le président français Sarkozy avait prononcé à Dakar un discours retentissant qui en avait estomaqué plus d’un, dont moi. Il y avait dit ceci :
« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain (…), ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès. »
Le personnage du résident Diallo vient en contrepoint de cette affirmation tout bonnement raciste. Il y a du Nelson Mandela et du Kofi Annan en lui, deux hommes qui, plus que bien d’autres, ont contribué positivement à l’aventure humaine et à l’idée de progrès.
Enfin, une dernière question liée à cette phrase de Roméro, à la fin de votre livre : « Quand on innove on fait des envieux prêts à vous envoyer au tapis à la première occasion ». Quelle serait d’après vous la définition de la réussite et quelles qualités exigerait-elle au-delà de cette endurance ? Je pense surtout aux valeurs humaines de compassion et de dévouement, par exemple. Il y en a certainement d’autres.
Mieux vaut « réussir sa vie », l’inventer tant que faire se peut, plutôt que de « réussir dans la vie ». On réussit sa vie quand on aide les autres à réussir la leur, non ? Et, si on ne le peut pas ou qu’on ne le veut pas, au moins on la boucle.
Propos recueillis par Dan Burcea
Roberto Garcia Saez, Un éléphant dans une chaussette, Éditions Atramenta, 2021, 234 pages.

