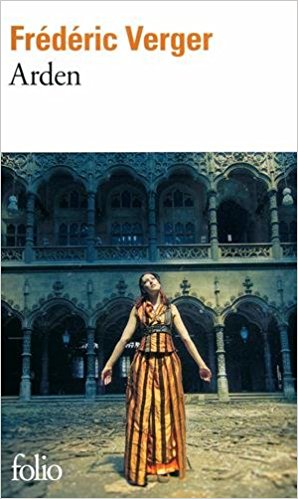
Après avoir figuré sur toutes les listes des plus importants prix littéraires et surtout sur celle du dernier carré de la sélection du Prix Goncourt de l’année dernière, le roman Arden, de Frédéric Verger, avait dû céder la première place, pour deux voix seulement, à Pierre Lemaître, l’heureux gagnant avec le roman Au revoir là-haut. Entre temps, il a fait son petit bonhomme de chemin vers l’admiration des lecteurs et vers la reconnaissance des jurys, étant récompensé, depuis, par Le Prix Thyde Monnier 2013, de la Société des Gens de Lettres et le Prix Mémoire Albert Cohen.
Le couronnement, le 4 mars dernier, par le Goncourt du premier roman, n’est donc que justice pour ce livre inattendu d’originalité et de force, décrit dans des termes élogieux dès la réception de sa version manuscrite par Jean-Marie Laclavetine des Éditions Gallimard : «Ce manuscrit avait toutes les qualités pour être remarqué. J’ai aimé la faculté d’invention de cet écrivain, la façon dont il sait mener un récit de façon vivante et parfois drôle tout en situant l’histoire dans un contexte de tragédie. Son style est très riche avec un art de la métaphore affirmé.» Les critiques ultérieures n’ont fait que confirmer la justesse de cette présentation préalable et ont parlé d’un «très étonnant premier roman, burlesque et tragique à la fois, érudit et ironique […] foisonnant récit pseudo-historique, admirablement maîtrisé», (Fabienne Pascaud, Télérama du 28.09.2013[1]) dont l’auteur, avec une plume précise, «conjugue le lyrisme et l’ironie sombre, excelle dans l’art du portrait, de la description de la nature» (AFP, Le Parisien du 24.09.2013[2]).
Concises, élogieuses, prometteuses et, finalement, judicieuses recommandations pour – ne l’oublions pas – un premier roman d’un écrivain inconnu jusque-là, qui débute tard, à l’âge de 55 ans.
Comment expliquer le succès fulgurant de ce livre si ce n’est par l’extraordinaire force qu’il exerce sur le lecteur qui, une fois passé le seuil de ces plus de quatre cent pages de pure littérature, est happé par une impressionnante aventure romanesque. Le style riche en métaphores, le caractère inattendu des personnages, le monde invraisemblable qui puise sa beauté dans un imaginaire de vaudeville, tout cela surprend et enchante en même temps. «Tout est inventé et j’y ai pris beaucoup de plaisir, même si j’ai mis cinq longues années à l’écrire», déclare Frédéric Verger lors de son interview dans Le Parisien. À une autre occasion, répondant à une question de Laurence Houot[3]sur sa première rencontre avec le livre qui a changé sa vie – il s’agit, en occurrence, de Madame Bovary –il parle de sa surprenante rencontre avec la «façon de penser la vie» dont le roman détient le secret, et qui dépasse «la chose explicite» du texte littéraire, en ouvrant l’accès à la«sensibilité» et à «l’affect», une manière «d’appréhender la réalité par les mots».
Ce dernier syntagme qui fait référence au rapport que la littérature entretient avec le réel – et qui a ici valeur d’ars scribendi – n’exonère pas Frédéric Verger de l’obligation d’un ancrage indéniable dans une historicité concrète, sans le priver pour autant d’un accès garanti au territoire de l’imaginaire qui prend une importance toute aussi grande dans l’économie du roman.
Or, c’est justement sur cet exercice que s’affirme son art, en choisissant l’allégorie pour habiller le sens premier d’une réalité violente et d’un désastre qui hante l’Histoire. De ce point de vue, le roman Arden peut être qualifié de livre/livret, mélange inattendu de narration transfigurée et de canevas faisant recours avec élégance au quiproquo, aux rebondissements et aux détours dans un imaginaire créé pour sublimer un réel que l’Histoire abhorre. L’auteur tente de comprendre et d’expliquer les grandes leçons de l’Histoire par un schéma utilisant une perspective située à la hauteur des hommes qui ont fait le siècle, à l’échelle de leurs convictions, de leurs doutes et de leurs souffrances mais aussi de leur capacité à rêver et à espérer.
C’est un monde qui vit dans une sorte d’incrédulité allant jusqu’à la négation du pire et qui va faire qu’une incurable résignation va gagner tout un peuple, y compris devant les assassinats des gardes noires. Cette incrédulité naît d’une stupeur si soudaine qu’elle devient irréelle, d’un besoin de croire qu’après tout, ce mauvais rêve va s’arrêter sans dégâts ni blessures : «Mais ils se disaient que ces grondements terrifiants annonçaient sans doute la fin du cauchemar, comme sur le grand huit des fêtes foraines le vacarme atroce des crémaillères précède la douce coulée au long du quai». Ou encore dans cette fragile confiance dans une improbable clémence de l’Histoire : «Ils crurent longtemps que le conflit les avait oublié, comme si au moment où les peuples européens avaient jeté autour d’eux leurs habits avant de s’entre-tuer un paletot était tombé sur la Marsovie pour la dissimuler aux regards».
Marsovie est un pays inventé, un pays imaginaire dont le nom est inspiré du livret de l’opérette La veuve joyeuse de Franz Lehar,écrit par Victor Léon et Leo Stein d’après la comédie d’Henri Meilhac, L’Attaché d’ambassade (1861). Mais, si pour le compositeur allemand cette minuscule contrée est associé à la principauté de Monténégro, dans le roman de Frédéric Verger elle est situé à la frontière entre la Hongrie, la Roumanie et l’Ukraine. Ce choix n’a rien d’aléatoire, sa Marsovie est un carrefour symbolique d’une Europe cosmopolite, véritable laboratoire de multiculturalisme et de multilinguisme où les gens vivent en harmonie. Chernovitz, la ville de Paul Celan, n’est pas loin, et la mémoire des déportations hante encore aujourd’hui les mémoires. Les liens qui règnent sur la vie quotidienne des Marsoviens vont s’effriter sous le poids du racisme et de l’antisémitisme et c’est justement dans ce droit de chaque communauté d’avoir accès à son identité et à sa langue que va se jouer le dénouement du roman.
Pour l’instant nous ne sommes qu’au tout début de la narration : l’auteur puise sa source d’inspiration dans l’univers mystérieux de l’enfance («Lorsque nous étions enfants, il arrivait souvent…»), ce qui permet une plongée dans une ambiance tendre, nostalgique, proche d’une vision clownesque des personnages comme, par exemple, la figure excentrique d’une tante «aux cheveux couleur cendre, mal tenus par des épingles s’ébouriffaient comme la paille d’un nid», bonifiée par sa manière particulière de parler, en utilisant des expressions bizarres que les enfants prennent pour «les étincelles d’un cerveau quelque peu grésillant».
Dans ce coin perdu de contrée fictive s’érige le Grand Hôtel Arden, ancien sanatorium, construit dans le pur style Art déco, géré de 1927 jusqu’en 1944 par l’oncle Alexandre et tante Irena Rocoule, un«paradis construit sur les ruines d’une patrie perdue», comme aiment le nommer les Rocoule.
L’oncle Alexandre règne en maître sur les lieux. Sa réputation de personnage excentrique en dit long sur ce «prince en exil […] sorti des films Paramount», «un Jupiter hôtelier qui ne concevait pas volupté plus grande que de se glisser dans l’enveloppe d’un personnage jailli de son imagination», «un flâneur de la vie» qui «avait continué à se promener dans l’existence comme dans un bal». Cet homme éternellement amoureux, amateur inconditionnel d’opérette, compositeur un peu raté sur les bords, éternel rêveur, est le prototype légendaire du créateur biscornu, perdu à jamais dans le monde de ses rêveries.
Son épouse, tante Irena, couronne d’une manière plaisante l’excentricité de ce couple. Son regard condescendent posé sur le talent de compositeur de son mari et l’indifférence quant aux écarts de celui-ci à la fidélité du couple finissent par la pousser à se réfugier dans un monde peuplé de souvenirs et de délires chiromanciens.
Car le vrai complice de l’oncle Alexandre est son ami Salomon Lenguyel, lui aussi musicien du dimanche et couturier raté tenant avec peu de talent l’atelier hérité de son père. Vivant au début des années ’43, dans une sorte de «mélancolie voluptueuse» où «le temps semble suspendu», il ne tardera pas à comprendre, à ses risques et périls, le danger de la montée de l’antisémitisme, ce qui va le plonger rapidement dans l’angoisse, voire dans un cauchemar : «Assis sur son lit, le cœur battant, Salomon éprouva à coup sûr la certitude absolue qu’il ne verrait jamais la fin de cette guerre et qu’une nuit semblable à celle-ci on viendrait le chercher pour le faire mourir». Plus tard, se regardant dans la glace d’une cabine d’essayage de son atelier, il aperçoit sa silhouette, et est brutalement frappé de stupeur : «avec ses cheveux blancs ébouriffés et son costume marron froissé, on aurait dit la figure en cire de foire, un barbon d’opéra ou de jeu de massacre». Son portrait emprunte, dès lors, les traits d’un clown égaré parmi les personnages d’un triste spectacle qui se joue sur la scène de sa propre existence.
Doit-on pour autant y voir dans leur incorrigible naïveté la raison de leur refus d’aposer la dernière réplique d’une sentence irrévocable de l’histoire qui se déroule sous leurs yeux? Quoi qu’il en soit, on comprend pourquoi les deux compères-musiciens n’atteignent jamais le point final de leurs opérettes, se contentant juste de faire de l’écriture une fête perpétuelle, comme une jetée de confetti sortis «de la poche d’un fêtard quand il tire son mouchoir».
Mais, si rien ne semble troubler la vie calme de ce coin de paradis autour de l’Hôtel Arden, où les jours se succèdent pour le bonheur des convives habituels de l’oncle Alexandre, les horreurs de la guerre, du nazisme, des gardes noires et du pogrome ne tardent pas à atteindre aussi la Marsovie et, implicitement, la vie tranquille du Grand Hôtel Arden. Alexandre Rocoule n’hésite pas à cacher dans la cave de l’hôtel son ami Salomon et sa fille, Esther, dont il tombe follement amoureux. Après d’incroyables péripéties, un orchestre juif va se réfugier à son tour dans les couloirs secrets du souterrain du même bâtiment.
Pour les sauver, notre maître d’hôtel-compositeur va imaginer une solution encore plus invraisemblable qui dépasse toute imagination. Comme la présence des officiers allemands se fait de plus en plus visible à l’Hôtel Arden, et comme les gardes noires sèment la peur en ville par leurs perquisitions et leurs assassinats, l’oncle Alexandre compte utiliser un stratagème, une idée qu’il qualifie de «simple et logique». En réalité il n’y a que lui qui comprend quelque chose à ce galimatias : les faire passer pour des faux Juifs déguisés en Juifs pour cacher leur vraie origine juive, en les faisant jouer dans une des opérettes écrite avec Samuel, Café tzigane, où il remplacerait les Tziganes par des Juifs et les ferait jouer dans la grande salle de l’hôtel où Esther serait soliste et passerait pour une nièce venue de Budapest. Avouons que l’imagination de l’oncle Alexandre avoisine ici le pur délire.
Conscient de ce tournant et maîtrisant la tension narrative de l’ensemble, Frédéric Verger charge cette deuxième moitié du roman en dramatisme, ce qui est aussi bien construit que le comique et l’invraisemblable de la première partie, sans réduire pour autant sa touche humaniste. Même si sa vision sur l’Histoire puise ses sources, comme nous l’avons déjà dit, dans l’imaginaire, l’auteur ne perd pas pour autant de vue son réalisme saisissant. Le grand défi du roman est de trouver une réponse à la question fondamentale liée aux modalités de représentation du réel avec les moyens de la littérature et à l’humanisation de cet espace détruit par la bestialité de la guerre.
Sans devenir pour autant un décor en carton, le monde qui tourne autour de l’hôtel Arden tente de se convaincre jusqu’au dernier moment que le mauvais sort de la guerre va le contourner, qu’il suffit de s’accrocher à cet espoir, à cette illusion pour écarter et vaincre cette espèce d’ordalie barbare, comme dans un scénario qui ignore sa fin. De ce point de vue, l’écriture devient pour Frédéric Verger un baume apaisant sur les blessures de l’Histoire, faisant de l’écrivain la seule personne capable d’accéder, par le biais de l’invention littéraire, à une nécessaire thérapie salvatrice.
C’est la raison d’être d’un monde où le passage constant d’un registre à l’autre, de la violence et de l’omniprésence de la haine à la rêverie contagieuse, au marivaudage finit par s’imposer comme une solution à cette rupture, justement en gommant la folie par une image en miroir, qui ne fait que sublimer le procédé de l’allégorie.
«Puisque le monde est fou, ne faut-il pas que nous aussi nous devenions fous ?», s’interrogent à l’unisson Pleskine et Prokosh, deux des personnages du roman.
Le mythe d’Orphée retrouve ici toute son actualité.
Vu de cet angle, Arden est un roman qui tente de réenchanter le monde. Malgré un sentiment d’impuissance qui le traverse, il frappe sans cesse aux portes de notre mémoire pour tenir en éveil à bout de bras notre humanité somnolente.
Dan Burcea
Frédéric Verger, Arden, Gallimard, août 2013, 480 pages, 21,50 €

