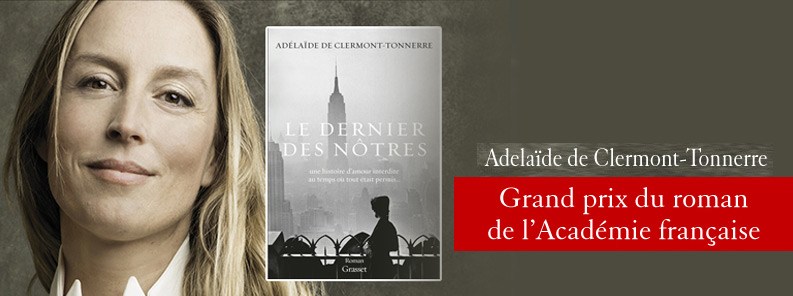
Lors de la publication de son premier roman, Fourrure (Stock, 2010), Adélaïde de Clermont-Tonnerre avait surpris la critique par «une fiction autorisant toutes les audaces» (Bernard Pivot, le JDD) et par «une jubilation dans son écriture décomplexée» (Aurélie Raya, Paris Match). Ce ne fut donc pas un hasard que le roman s’imposât comme une des révélations de la rentrée littéraire de l’époque et reçût de nombreuses récompenses, comme le prix Maison de la presse, le Prix Françoise-Sagan, le prix Bel Ami, le Prix du Premier Roman de Femme et l’un des Prix littéraires Les Lauriers Verts 2010, en catégorie révélation, étant aussi finaliste du Prix Goncourt du premier roman et sur la liste d’été du prix Renaud. Inspiré par la vie tumultueuse de Zita Chalitzine, fille de Madame Claude dans le Paris des années 1970, le roman avait surtout dévoilé l’étonnante capacité d’introspection dont la jeune journaliste-romancière faisait preuve pour sonder une réalité qui osait franchir la frontière de l’intime de ses personnages. Cette liberté de se dévoiler en optant pour l’écriture de soi, était alors pour ces personnages le meilleur alibi romanesque car, comme le dit Pierre, un d’entre eux, «on a rarement accès à une personne aussi intimement qu’en lisant ses mémoires».
Et c’est avec la même parfaite maîtrise du discours narratif et avec la même soif de sonder en profondeur l’âme humaine qu’Adélaïde de Clermont-Tonnerre signe Le dernier des nôtres, (Grasset, 2016), un deuxième roman encore plus bouleversant, à la fois par l’intensité avec laquelle elle arrive à traiter une thématique davantage plus riche que celle de sa première narration et par la capacité de le faire bénéficier d’un espace narratif plus ample, plus romanesque et faisant place à une intrigue tout aussi dense que déconcertante. Nous pénétrons cette fois par les portes de la Grande Histoire sur des chemins qui nous conduisent de l’Allemagne agonisante des années 1945, en allant des ruines de Dresde et jusqu’à Los Alamos à l’aide de l’opération Paperclip qui eut comme but de soustraire l’équipe de recherches des missiles V2 dirigée par Werner von Braun et jusqu’à la ville de New York des années ’70 où la nouvelle génération des seventies rêve de reconstruire une société encore plus prospère et plus décomplexée. Arrivera-t-elle, cette génération volontaire et insouciante, à combler l’espace fait de dislocations irréconciliables avec le passé et d’absence de toute promesse d’héritage et de mémoire ? Peut-on, sinon, se construire sans ce lien ancestral, reliant l’individu à ses géniteurs et bâtissant le seul socle capable de mettre des mots sur notre histoire personnelle ? Et que faire si le passé qui resurgit sans crier garde menace de secouer, voire de détruire l’entier édifice de nos vies ?
Ce sont ces quelques interrogations, mais pas les seules, qui s’insinuent très rapidement dans le fil narratif de ce roman bouleversant dont il faut aussi remarquer le caractère énigmatique du titre qui nous invite par son énoncée à une vraie stratégie de recherche de son sens caché. Et c’est la même sensation de jubilation qui illumine la prose d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, avec en prime, selon nous, une attention particulière à accorder à la manière dont la narration s’ouvre à une thématique riche, tout en cédant un espace suffisant à l’éclosion d’une humanité bouleversante, empreinte à la fois de profondeur et d’insouciance. Et c’est sous cet angle qu’il faut regarder dès le début l’improbable relation amoureuse, vraie «explosion de contradictions», entre le jeune Werner Zilch et «l’impérieuse et soumise, douce et passionnée» Rebecca Lynch. Adopté par une famille de la classe moyenne américaine, le jeune Werner croit «au pouvoir infini de la volonté», étant résolu «à se forger un monde à la force du poignet». D’autant plus que son courage et sa détermination sans faille peuvent se réjouir d’une liberté en rien redevable à son passé. «J’étais libre de tout héritage – nous dit-il – de tout passé, je me sentais maître de mon avenir ». La beauté de Rebecca, ses yeux «d’un violet profond, pailletés d’intelligence et de sensibilité» le subjuguent. Très rapidement, en revanche, il va être confronté à un autre trait du visage de Rebecca, «un mélange d’arrogance et de doute déconcertant». Cette dichotomie si nettement tranchée sur laquelle se construit le caractère de la jeune artiste s’explique à la fois par son statut social d’enfant gâté – «sa famille lui avait ôté toute inquiétude quant à son statut social» – et par l’interrogation incessante sur sa valeur personnelle qui traverse à tout moment sa condition d’artiste. Cet être énigmatique déstabilise le jeune et ambitieux Werner et installe leur relation dans une période faite de séparations et de réconciliations soudaines et presque permanentes.
Dès le deuxième chapitre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre nous plonge dans l’atmosphère pesante de l’Allemagne des années 1945, à Dresde pendant les bombardements qui détruiront cette ville. Grièvement blessée par les bombardements, Luisa survivra le temps de donner naissance à un garçon. Avant de mourir, elle laissera, comme une sorte de testament, ces paroles qui accompagneront pour toujours son fils : «Il s’appelle Werner. Werner Zilch. Ne changez pas son nom. Il est le dernier des nôtres ». Le lecteur est ainsi mis devant une vérité qu’il devra à son tour porter comme une confidence tout au long de la narration, comme un secret dont il devra trouver par la suite la réponse épique et chercher au fil des pages le dénouement.
Roman construit à l’aide du croisement de deux plans narratifs complémentaires qui alimentent la tension narrative de l’ensemble, «Le dernier des nôtres» retrace ainsi avec la complicité du lecteur, le parcours d’une lignée brisée par la tragédie de l’Histoire, afin de trouver une réponse possible sur les différentes blessures qu’elle a pu laisser sur l’identité de ces protagonistes. Désormais, l’ombre d’une fragilité saisissante va se refléter sur l’image de l’impétueux Werner pour le faire descendre de son piédestal de super-héros et de faire de lui un homme aussi fragile que sa bien-aimée. Rebecca ne tardera pas d’ailleurs à nous livrer sa propre histoire. Une histoire profondément ancrée dans celle de Judith, sa mère, née en 1929 à Budapest, arrêtée le 30 mars 1944, puis envoyée à Auschwitz-Birkenau, au bloc 24. Elle n’a que 15 ans. Le regard qu’Adélaïde de Clermont-Tonnerre projette sur la Shoah et sur le drame qui a poursuivi des années durant Judith est juste, à la fois par la fidélité du discours sur ces terribles événements et par la lucidité d’en juger les conséquences et en dévoiler les responsabilités. La narratrice entretien un rapport de vérité avec l’Histoire et appelle sans mansuétude à la barre les vrais coupables des drames (le pluriel a ici son importance) qui se jouent au fil des pages. Dans la gallérie des personnages du roman, Judith occupe ainsi la place réservée à la souffrance la plus profonde mais aussi la plus discrète afin d’éviter tout excès qui pourrait l’amoindrir ou effacer son dramatisme. Portrait de la beauté féminine défigurée par la violence des hommes (un des thèmes de prédilection de notre romancière), Judith détient en fait la clé de l’intrigue du roman qu’elle délivrera avec une volonté et une soif de vérité glaçantes par leur lucidité et la souffrance tellement profonde qu’elles laissent jaillir.
Ces vérités qui éclatent en rafale déclenchent une avalanche de questionnements, emportant les héros dans une confrontation douloureuse avec leurs propres histoires. En cela, le roman prend des allures de tragédie grecque où les personnages marchent sans nulle possibilité de s’échapper dans les couloirs déjà tracés par leurs destins. Cet exercice aboutit à construire dans l’économie du roman, une intrigue complexe, ouverte à une multiplicité de clés de lecture. Ce n’est qu’en suivant ce fil zigzaguant entre les deux plan narratifs que l’on pourra refaire le trajet des Zilch frappés par la tragédie de Dresde, du groupe de von Braun et de leur trajet des montagnes bavaroises jusque dans le New Jersey et à Los Alamos, et arriver enfin à comprendre l’histoire du jeune Werner, de son adoption, ou, enfin, à redécouvrir l’existence de Marthe de Dresde à La Nouvelle Orléans et au Bâton rouge.
Impossible de dévoiler ici toutes les clés de lecture contenues dans le roman d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, sans trahir sa substance et son intrigue. Arrêtons-nous à deux d’entre elles qui nous semblent être les plus pertinentes.
La première concerne le personnage de Werner, illustrée par son besoin impérieux d’avoir accès à l’histoire vraie de son passé. D’où, l’avalanche de questions qui l’envahit : «Tout a défilé. […] Ma différence. Ma solitude. Le trou noir qu’avaient été ma petite enfance et les années terribles de mon adolescence. Ce temps passé à chercher, à imaginer sans relâche et sans succès pourquoi mes parents m’avaient abandonné».
La seconde émane de l’attitude de Rebecca qui veut sauver sa relation avec Werner, malgré l’aversion de leurs deux histoires où tout semble les séparer. Seul un amour plus fort que la haine peut sauver leur histoire. Cette formule n’a rien d’artificiel pour Rebecca qui est loin de fréquenter les lieux communs du discours pathétique. Elle connait les sacrifices que ce geste lui impose. «Des mois durant j’étais brisée, mais quand je me suis relevée, dès que j’ai pu, je suis venue te retrouver. Ces choses, j’ai voulu les ignorer. J’ai cru que nous pourrions faire semblant, comme avant, quand nous ne soupçonnions pas ce qui nous attirait si violemment l’un vers l’autre […] Werner, si nos chemins se sont croisés, c’est parce que cette faute existe et que nous devons, toi et moi, la réparer.» Ainsi, «Le dernier des nôtres» s’impose comme un roman polyphonique qui, sans tomber dans le manichéisme, poursuit un canevas narratif qui jongle avec lucidité entre réalité historique et introspection. Son rythme haletant invite à une lecture soutenue, dont la longueur est vite récompensée par un dénouement surprenant et un optimisme qui nous raccrochent à la vie et à l’amour.
Arrivé à la fin du roman, Werner se plaît encore à croire qu’il a réussi à écrire sa vie comme «sur une page blanche, [comme] une histoire absolument neuve». Les révélations surgies du passé contrediront cette chancelante certitude et affaibliront «la patiente architecture» qu’il croyait infaillible. Saisissante image d’un paradis à tout jamais perdu, cette page blanche soumise à la fatalité d’une progressive obscuration ne cessera de l’interroger et d’interroger nos propres vies.
Un vrai régal qui promet à Adélaïde de Clermont-Tonnerre de se retrouver encore une fois dans les premiers rangs dans la course aux récompenses de cette rentrée littéraire.
Dan Burcea (28/08/2016)
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Le Dernier des nôtres, Grasset, août 2016, 496 pages, 22 euros.

