
Qui êtes-vous, où êtes-vous née, où habitez-vous ?
Je suis née à Boston, et j’habite à Paris depuis l’âge de treize ans. Pourtant, ma famille n’avait aucun lien au départ avec les États-Unis ou la France, mais une suite de nécessités, inextricablement mêlées à autant de hasards, peut l’expliquer.
Mes grands-parents ont fui leurs shtetls d’Europe de l’Est (Pologne et Roumanie) dans les années trente, pour un des pays qui ouvrait ses portes à l’immigration, l’Argentine. Mes parents sont nés à Buenos Aires, où j’ai passé une grande partie de mon enfance. Le reste de mes voyages tient au métier de chercheur scientifique de mon père (le premier de la famille à avoir fait des études supérieures). Je suis née lorsqu’il bénéficiait d’une bourse pour son post-doctorat à Harvard, et la famille a suivi son parcours, qui nous a menés en France.
Vivez-vous du métier d’écrivain, sinon, quel métier exercez-vous ?
Non, je suis médecin, spécialisée en radiologie, et je travaille dans un centre anticancéreux depuis presque vingt ans. Cette indépendance est importante pour moi à plus d’un titre.
Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?
Je ne saurais dire comment elle est née. Peut-être de la même manière qu’il est impossible de se souvenir du moment où l’on s’endort (et on entre, ainsi, dans une autre dimension, propice aux rêves). J’aimais beaucoup au lycée les cours de littérature, et ce goût n’a fait que croître avec le temps. Il me semblait, parfois, que « quelque chose voulait sortir » pour m’exprimer crûment. Mais je trouvais que c’était ridicule : moi, écrire ? Pour commencer, je n’avais pas, à proprement parler, de langue maternelle. Et le français, où je me sentais le plus à l’aise, je l’avais appris en dernier, à l’âge de treize ans.
Après le bac je me suis inscrite dans de nombreuses filières (prépa HEC, hypokhâgne S, droit et médecine si mes souvenirs sont bons, à l’époque c’était possible). J’ai commencé en septembre par l’hypokhâgne S (une sorte de compromis alliant littérature, mathématiques et économie), mais après deux ou trois semaines de cours j’ai compris que je n’aimais pas l’économie, ni d’ailleurs le rythme scolaire. Je suis donc allée en médecine en octobre, j’ai trouvé les cours intéressants, et j’ai continué. Mais je lisais de plus en plus et cela prenait une importance croissante pour moi. Chaque année je me posais la même question : devais-je arrêter médecine et étudier littérature ?
Après des années de tergiversations et d’hésitations, un jour, alors que j’étais en cinquième année et préparais le concours d’internat, j’étais assise dans le bus et en un instant j’ai pris la décision : je m’arrêterais une année pour faire ce que j’aimais. J’ai réussi à obtenir une équivalence pour m’inscrire en licence de lettres mais la semaine de cours à laquelle j’ai assistée m’a déçue, et j’ai décidé de faire mon propre programme de lectures, que j’ai suivi.
Et j’ai commencé à écrire, malgré moi je dirais, et à ma propre surprise. J’ai écrit ma première nouvelle, Une appendicite aiguë, en une semaine jours et nuits confondus, dans une extraordinaire euphorie (malgré le caractère tragique du sujet). Si d’un cas médical – sorte de pierre brute – je pouvais extraire beauté et émotion, si je pouvais en faire une œuvre d’art (aussi infime soit-elle), quelle preuve ce serait ! D’autres textes ont suivi.
J’ai pu rencontrer un critique littéraire. Après en avoir lu quelques-uns, il m’a dit «Dans vos nouvelles il y a 90% d’émotion et 10% d’action. La personne qui vous lit dans le métro veut le contraire, 90% d’action et 10% d’émotion. » Ma fierté et ma sensibilité ont réagi sans tarder : je ne sais pas si ce que j’écris vaut quelque chose, mais pour moi cette personne n’est pas un juge valable, et je dois protéger ce qui est, pour moi, précieux et encore fragile. C’est absolument nécessaire que je sois indépendante. J’ai donc décidé de reprendre médecine, ce qui n’a pas été facile. Pendant plusieurs années (internat, clinicat), je n’ai quasiment pas écrit. Je croyais que c’était fini, mais je me trompais.
Quel est l’auteur, quel est le livre qui vous a le plus marqué dans la vie ?
Il y en a beaucoup, et chaque auteur que j’aime élargit mon univers. En deuxième année (de médecine) j’ai lu et adoré Schopenhauer (Le monde comme volonté et comme représentation), en troisième année j’ai découvert Proust avec un bonheur extraordinaire. Il y a eu aussi Flaubert, Nabokov, Tchekhov, Woolf, et bien d’autres. C’est pour moi une chance inégalée de découvrir un auteur que j’aime, et de me dire que j’ai toute une œuvre qui m’attend. En poésie, je citerais Philippe Jaccottet, les haïkus (Issa notamment), Yehuda Amichaï, et en philosophie Clément Rosset. Mes choix ont été à la fois le résultat d’errances dans les librairies et bibliothèques et de livres dont mes auteurs préférés parlaient, mais j’ai d’immenses lacunes.
Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?
J’ai surtout écrit des nouvelles, et mon dernier texte est un court roman. C’est le même genre, je dirais, la différence étant la longueur, variable selon le sujet. Une nouvelle d’une page est aussi différente d’une nouvelle de vingt pages que cette dernière d’un roman de cent cinquante. La longueur dépend de chaque texte, je l’accepte tel qu’il vient.
Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?
Je prends des notes, et je dois beaucoup retravailler pour arriver à la précision souhaitée. En général je préfère écrire à la troisième personne, mais il y a des exceptions. En tout cas ce n’est pas moi en tant que personne qui parle, j’écris des fictions.
D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?
Les sujets naissent parfois d’un rêve. Parfois une sensation particulière (une nostalgie, l’incompréhension, une joie, un chagrin) prend corps sous forme d’une courte histoire. Je crois que dans notre vie quotidienne on emmagasine des images, des émotions, des pensées, des scènes, et dans notre « four interne » ça monte, allez savoir comment.
Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?
En général je pense au titre à la fin. Dans certains cas il est important, et je ne voudrais pas le changer (Une appendicite aiguë devait être le titre, car le lecteur sait ainsi dès le début que la menace plane, même si les personnages ne le savent pas). Le titre d’un de mes textes très courts, Incognito, m’a été suggéré par mon compagnon : je n’aurais pas pu faire mieux ! Dans d’autres cas je mets un titre simple (comme Aude, du prénom du personnage principal dans mon dernier texte).
Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?
Les nouvelles sont plutôt comme des instantanés, on creuse un moment plus que l’étendue de vie d’un personnage (en tout cas, il en est ainsi pour moi). Je ne peux pas vraiment dire que j’entretiens un rapport avec mes personnages. Ce sont des projections, des créations imaginaires, qui se font à mon avis de manière fort mystérieuse pour l’auteur.
Parlez-nous de votre dernier ouvrage et des vos projets.
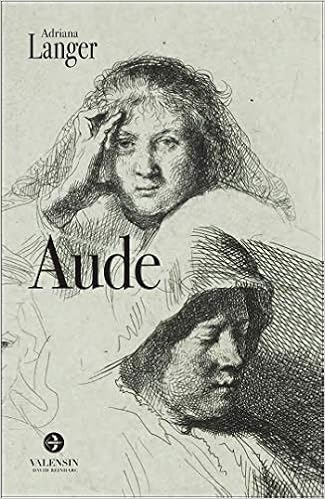 Mon dernier texte est un court roman. Aude est une étudiante en médecine qui découvre à l’hôpital divers aspects, terribles et insoupçonnés, de la vie, mais aussi l’amour et l’art. J’évoque, à travers ce personnage, le conflit entre un regard scientifique, actif, et un autre plus contemplatif.
Mon dernier texte est un court roman. Aude est une étudiante en médecine qui découvre à l’hôpital divers aspects, terribles et insoupçonnés, de la vie, mais aussi l’amour et l’art. J’évoque, à travers ce personnage, le conflit entre un regard scientifique, actif, et un autre plus contemplatif.
Actuellement je travaille sur un texte (longue nouvelle, court roman ?) dont le sujet est l’amitié entre deux étudiantes de lettres qui deviendront femmes et mères, leurs pensées, leurs joies, leurs déceptions.
Crédit photo de l’auteure : Véronique Durruty

