
Par quel miracle et à quel prix gagne-t-on sa victoire contre les tempêtes et les naufrages de la vie ? Existe-t-il un chemin – et lequel ? – qui mène vers ce que Dominique Deblaine appelle dans son dernier roman La rumeur des rives « une féerie invraisemblable de désirs simples » ? Pour mieux déchiffrer les nuances de cette métaphore multicolore, reproduisons-en son inventaire que Josèphe, son héroïne, nous livre par ces mots : « vivre des nuits et des jours sans se demander ni pourquoi ni comment, ne plus faire ce qui a déjà été fait, changer de cap, virer, remonter le vent, se 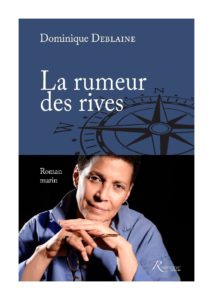 mettre à la cape quand tout paraît insoutenable, et puis déserter les violences, les mépris, les moqueries et la suffisance ». Vaste programme ! Sauf qu’ici, nous n’avons pas affaire à une quelconque thérapie qui mettrait en sourdine une subjectivité craintive, altérée et inconsolable. Nous sommes dans un roman et, en cela, la littérature a le droit de tout bousculer et de faire trembler toute perspective sous l’exigence d’une liberté qui réclame la démesure d’un « vivre en hurlant de joie ». Un élan de vie, donc, qui relève plutôt de la révolte et du battement des ailes, d’une attitude qui exalte l’aventure, la confrontation avec les éléments pour mieux dompter l’orage qui la traverse.
mettre à la cape quand tout paraît insoutenable, et puis déserter les violences, les mépris, les moqueries et la suffisance ». Vaste programme ! Sauf qu’ici, nous n’avons pas affaire à une quelconque thérapie qui mettrait en sourdine une subjectivité craintive, altérée et inconsolable. Nous sommes dans un roman et, en cela, la littérature a le droit de tout bousculer et de faire trembler toute perspective sous l’exigence d’une liberté qui réclame la démesure d’un « vivre en hurlant de joie ». Un élan de vie, donc, qui relève plutôt de la révolte et du battement des ailes, d’une attitude qui exalte l’aventure, la confrontation avec les éléments pour mieux dompter l’orage qui la traverse.
Faut-il encore le rappeler – pour mieux comprendre cette obsession de l’adversité et cette soif du lointain – que l’origine et l’univers narratif de la guadeloupéenne Dominique Deblaine sont tous les deux insulaires et qu’elle nous avait déjà enchantés par son acuité au « rythme glapissant des bords marins » à laquelle elle nous invitait dans son précédent roman, Le Raconteur (2014)[1] ? Son nouvel opus quitte cette fois les impasses pour se confronter aux péripéties du large et obtenir, par la victoire sur les éléments, un baume capable de consoler ses peines. Inutile d’expliquer donc que les bourrasques, les vagues, la solitude et la peur ne sont pas seulement des réalités extérieures, mais qu’il s’agit des entités ayant élu domicile à l’intérieur de son être peuplé par une obsessionnelle interrogation sur la complexité du monde et sur le sens de la vie. « Je voudrais atteindre une paix durable – nous dit Josèphe, la navigatrice téméraire – avoir des pensées justes, mais refusant de me soumettre à la fatalité et tout en rêvant d’une autre vie […] ». Est-il possible d’y arriver, se demande-t-elle, tout en reconnaissant « je parcourais des océans pour fuir le monde » ?
Prise en étau entre le désir de fuir la réalité et le devoir de l’affronter, l’héroïne deblainienne subit le poids des nombreuses contradictions auxquelles l’oblige ce « clan des vociférateurs » qui sont les hommes. Nous voici ainsi tout près du secret du cœur blessé de Josèphe, celui d’une « folie amoureuse » où elle se retrouve victime, « plus épuisée qu’une bête de somme creusant des sillons » ayant plongé « dans des bas-fonds sidérants ». L’emprise d’un homme, de l’homme aimé, qui est pour elle « mon pilote et mon pirate » est tellement déstabilisante qu’au moment d’apprendre la vérité sur ses trahisons, celle-ci provoque un orage d’insultes et de penchants « à lui péter la gueule », pour reproduire ici le langage cru de cette femme blessée, « exilée du territoire amoureux ». Chassée de ce paradis matrimonial, elle ressent cet événement comme un naufrage et les comparaisons avec la réalité marine inondent son langage, à la fois dans l’évocation d’un temps heureux que de celui douloureux de la séparation. Ainsi, la vie heureuse à deux lui semble comme l’embarquement sur « une frégate au long cours » où, comme passagère, elle aurait droit à tous les délices, surtout ceux « de ses paroles comparables à un nectar coulant sous le soleil torride ». La tête plongée « dans les égarements de l’amour », elle avait été jusque-là incapable d’apercevoir la trahison.
Que reste-t-il à une âme trahie et désespérée comme la sienne, lorsqu’elle apprend la révélation? La dimension thérapeutique de son discours est ici fortement affirmée, le voyage étant pour Josèphe le seul remède pour libérer son être des plaintes et des angoisses qui prennent le dessus sur la défaite de son bonheur. Reste à savoir quel type de voyage va-t-elle entreprendre, car, du sens qu’elle donnera à ce besoin d’aventure, dépendra la subtile signification dont la narratrice chargera son récit : voyage comme libération par l’oubli, aventure comme une confrontation à l’inconnu, « fuite, lâcheté et futilité » devant la dureté de la vie, ou ultime voyage vers « des lieux si agréables que j’aurais pu y prendre racine – nous dit-elle – et y mourir sereinement ». Ce sentiment d’abandon est contraire à la joie issue de l’évocation de l’enfance où « sauter, chanter, rire, croire que la vie était éternelle et que le soleil à midi venait de se lever, avoir l’impression, presque la certitude [c’est moi qui souligne], de posséder des pouvoirs de fées, la puissance des mers en furie, et la volonté de tous les habitants de cette terre ».
Nous arrivons ici à toucher de près le plus profond de l’énigme du récit de Dominique Deblaine : trompeusement innocent, furtif et se voulant délesté de tout équivoque par sa timide mais ô combien insidieuse lueur, l’adverbe de quantité presque accolé au nom crucial de certitude en dit long sur le destin amputé de Josèphe, comme une sorte de blessure mortelle, comme une approximation funeste, comme un talon d’Achille. Elle ira jusqu’à renier son premier prénom et préférer le deuxième, Paule, qu’elle adopte le jour de ses vingt ans, plus encore, à ne jamais se sentir chez elle, à vouloir se justifier sans cesse, allant jusqu’au besoin de braver sans cesse les dangers des mers à bord de son bateau au nom si bien choisi pour l’occasion, Épicure.
D’autres interrogations tout aussi douloureuses traversent l’esprit de cette femme prométhéenne, partie en guerre contre les éléments et contre les habitants de ces terres où le paraître est roi, des blessures encore plus profondes renfermées depuis son enfance dans les secrets de sa famille.
Laissons aux lecteurs le plaisir de les découvrir dans ce récit envoûtant.
Retenons plutôt ici le fait que Dominique Deblaine définit son livre comme un « roman marin » et que son titre, La rumeur des rives, résonne comme un appel odysséen vers un retour difficilement atteignable et comme la négation d’une condamnation définitive ou celle d’une ultime parole du destin. C’est dans ce sens que nous devons interpréter sa vocation lénifiante et les solutions allopathiques qu’elle propose, non pas comme un refus de la réalité, mais comme un espoir à jamais acquis contre les approximations qui nous empêchent d’accéder au bonheur absolu. Car quoi de plus urgent lorsque l’on se rend compte que l’on est « dans une mauvaise barque, sur une mer démontée et que les rivages [sont] incertains » que de panser ses blessures et de reprendre le large et de se réveiller « avec une odeur sucrée de miel et deux chansons en tête […] qui assurent qu’il faut savoir se contenter de ce que l’on est et accepter qui l’on est » ? Le récit puise sa force dans cette équation simple, et tellement humaine, capable de mettre en harmonie le regard juste et l’image de soi, tout en faisant de la contemplation le meilleur moyen d’ancrer son navire près des rivages d’un bonheur capable de transcender les rumeurs des rives et les vents contraires.
Dan Burcea
Crédits photo :© Paul Robin
Dominique Deblaine, « La rumeur des rives », Riveneuve Éditions, 2017, 150 p., 15 euros.
[1] Voir ma chronique : https://lettrescapitales.com/eloge-de-nitescence-raconteur-roman-de-dominique-deblaine/

